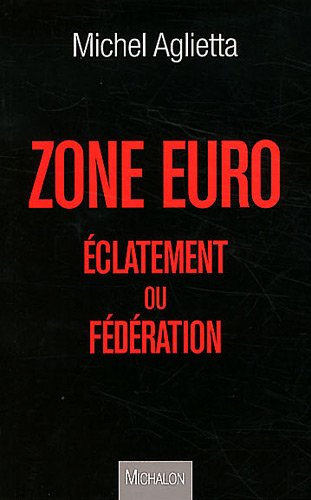Comment en sommes-nous arrivés là ? « Espace de compromis politiques laborieux et tortueux, l’Europe est la championne des demi-mesures. Le conservatisme mou et le compromis médiocre est un mode de gouvernance dépassé quand la tempête se lève ». Après nous en avoir expliqué les mécanismes (La crise, pourquoi en est-on arrivé là ?) et envisagé comment s’en sortir (La crise, les voies de la sortie), le dernier opus de Michel Aglietta place les Européens devant leurs responsabilités.
Seule une transformation politique du continent permet d’envisager une croissance durable et une sortie progressive de la crise de la dette. Accusés, les responsables nationaux, d’avoir bâti une monnaie certes accélérateur d’échanges, mais en gardant le frein à main sur la politique monétaire. Accusés, les produits bancaires qui nourrissent la finance d’une spéculation qu’aucune économie réelle ne peut soutenir. Accusé, l’inefficace culte de la notation. Accusée, la peur inflationniste allemande légitimant l’orthodoxie monétaire. Accusée, la frilosité française à bâtir une fédération économique.
Nous traversons depuis cinq ans une crise généralisée du capitalisme. Le coût de la dette est celui de ses intérêts. Durant les Trente Glorieuses, elle se réduisait parce que la croissance était plus forte que les taux d’intérêt. Aujourd’hui, un État est contraint de dégager un excédent. Si la crise trouve son origine dans le surendettement du secteur privé (ménages et institutions financières), la grande différence avec 1929 est que les États interviennent et que de nombreux stabilisateurs (fiscalité, assurances sociales) sont intégrés à l’économie capitaliste. L’action publique massive est devenue indispensable : les années Thatcher réduisant le rôle des pouvoirs publics sont bien terminées. Or, et c’est bien le drame de la période 2008-2011, et ce même dans les pays dits vertueux, le gonflement volontaire de la dette publique (stimulation budgétaire) n’a pas permis de résorber la dette privée.
Contrairement aux Américains, les Européens n’ont pas recapitalisé leurs banques. Aucun établissement n’a utilisé ses profits pour consolider suffisamment son capital. Dividendes et bonus extravagants continuent de fleurir.
L’heure est donc grave et les réponses sont faibles. Si la conjoncture paraît, début 2012, plus favorable, la dimension de la crise actuelle demeure systémique. Le récent accord sur la dette grecque est ambitieux, mais le traité intergouvernemental (issu de l’accord du 9 décembre 2011) ne suffira pas à empêcher la contagion à d’autres pays. Quant aux plans d’austérité, ils signent la fin d’une croissance rapide. Les politiques publiques européennes depuis vingt ans se révèlent désastreuses. Aujourd’hui, l’éclatement de la zone euro n’est plus improbable alors qu’une fédération européenne semble utopique. Alors, que faire ? M. Aglietta appelle à choisir entre l’acceptation d’un délitement lent de la zone euro ou celle d’un partage progressif de la souveraineté budgétaire.
La création de l’euro a en effet exacerbé l’absence de coordination économique. Lancer une monnaie unique n’allait pas de soi. La relance de l’Europe par Jacques Delors, suivie de la réunification allemande, ont légitimement accéléré le projet. L’euro permettait aux Français d’accepter la nouvelle Allemagne, elle-même maintenue dans l’Europe de l’après-guerre. Mais ce projet monétaire ne prenait sens qu’à condition de l’unité politique et d’un dynamisme bruxellois, qui déclinèrent, alors que le big bang du 31 décembre 2001 approchait. « Toute la construction monétaire européenne repose sur une conception étroite et donc erronée de la monnaie, appelée monétariste. Selon cette conception, la monnaie est neutre vis-à-vis des phénomènes économiques réels » explique M. Aglietta. Il en résulte que, pour tous les pays, l’euro est une monnaie étrangère, pour ainsi dire. C’est cette doctrine qui légitime l’indépendance de la banque centrale. Du jamais vu dans l’histoire économique. Dès le départ, il n’existe aucune possibilité que la zone euro ait une régulation macroéconomique (politique budgétaire et monétaire). Seul le pacte de stabilité hier, comme le futur traité de discipline budgétaire aujourd’hui, fixent un ersatz de convergence. La crise de l’euro signe donc l’incohérence de l’intégrisme libéral, puisque la stabilité des prix (une monnaie forte pour lutter contre l’inflation) n’implique pas la stabilité financière. Or, monnaie et dette publique sont liées.
Le livre est volontairement dur avec l’Allemagne pour illustrer cette insuffisance politique européenne. Berlin a imposé sa doctrine monétaire, tout en se refusant à exercer un « leadership bienveillant » sur la zone euro en tant que pays dominant. L’Allemagne s’est battue seule pour retrouver son niveau de compétitivité perdu lors de la réunification. Tout en adoptant un modèle de croissance basé sur l’export avec comme principaux clients… les pays européens. Aujourd’hui, les milieux officiels allemands refusent de maintenir la zone euro à n’importe quel prix et maintiennent leur lecture moralisatrice de faire payer l’irresponsabilité. Résultat : chaque intervention de la BCE réveille la peur inflationniste. Cette rigueur s’appuie également sur une culture méfiante à l’égard des marchés et hostile envers l’innovation financière anglo-saxonne. Des règles, oui. Un régulateur interventionniste, non. Mais chaque gouvernement en Europe n’est-il pas pris entre sa volonté de mettre de l’ordre dans la finance et son souci de ne pas affaiblir les banques de son pays ? La politique des petits pas individuels, mais pas la grande marche commune.
Le cas de la Grèce en concentre les conséquences. Une vague intégration sur des principes philosophiques (pour ne pas « laisser Platon en deuxième division ») sans surveillance ni régulation. Tant que l’expansion financière fleurissait, personne ne se souciait des risques réels. Pourquoi les agences de notation, aujourd’hui si dures avec les États, ont-elles qualifié la dette grecque des dernières années ? Quel crédit accorder à Goldman Sachs qui a aidé les gouvernements grecs à camoufler le surendettement de leur pays ? Aujourd’hui, c’est l’ensemble des banques européennes qui sont sous-capitalisées. Quand on pense que les stress tests de la fin 2010 ont éludé, sous pression du lobby bancaire, le risque de défaut grec, il y a de quoi être inquiet pour le système.
M. Aglietta prend donc le taureau crétois par les cornes : il faut admettre que la Grèce est insolvable. Mais peut-on choisir entre le défaut organisé à l’intérieur de la zone euro et la sortie unilatérale ? Le premier est le scénario japonais, jugé impraticable. M. Aglietta fustige la politique des petits pas consistant à accumuler des plans d’austérité en attendant le retour de la confiance des investisseurs. Certes, l’accord de février 2012 est qualifié d’historique par les économistes libéraux. Mais on est très loin d’un plan d’investissements massifs et structurants à la hauteur de la gravité de la situation. La politique d’austérité actuelle sacrifie en effet la croissance de long terme qui elle-même réduit les leviers de croissance (employabilité de la main d’œuvre, recherche-développement…). L’autre voie ressemble au pari argentin, catastrophique à court terme (effondrement des échanges), mais qui permet de retrouver à moyenne échéance des gains de productivité (retour des investissements et exportations). Dans tous les cas, il est indispensable que la Banque centrale européenne (BCE) joue à plein son rôle de prêteur et dernier ressort. Car si la Grèce sort de l’euro, il faudra un acteur autrement plus puissant que le Fonds de stabilité actuel pour éviter la contagion.
Il s’agit donc de refonder la politique monétaire européenne. « La perte de confiance a atteint un point où c’est le démantèlement de la zone euro qui est une éventualité inscrite dans la baisse des prix des dettes publiques ». La modification de la doctrine monétaire de la BCE est incontournable, « en mettant sans délai son taux directeur à zéro et en déclarant qu’il y sera maintenu tant que les taux longs ne seront pas descendus à des niveaux où les politiques de consolidation budgétaire des États deviennent utiles pour mettre les dettes sur des trajectoires soutenables ». Balayant fermement le risque inflationniste à la suite d’injection de liquidité par la banque centrale (« un fantasme »), M. Aglietta rappelle que le premier danger est au contraire la déflation (chute des prix sur une longue période).
Il y a en effet quatre modes d’actions face au surendettement : l’hyper inflation, la destruction de capital, la stagnation et la croissance. Les deux premiers sont inenvisageables. Le troisième est le chemin pris. Mais c’est le dernier qu’il faut défendre. Il s’agit moins de faire croire qu’on remboursera que d’arriver volontairement à un niveau de dette acceptable, sachant qu’un État est postulé immortel en économie. L’enjeu est donc de concevoir une stratégie de trajectoire crédible des finances publiques. La rigueur n’est pas l’austérité et une politique budgétaire doit être tournée sur le long terme. C’est là que devrait intervenir une réforme de la gouvernance : la zone euro doit se doter d’une autorité de surveillance des politiques budgétaires nationales, en dialogue avec la BCE pour un policy mix. C’est sur cette base que pourront être émis des Eurobonds.
Loin d’être un plan d’urgence, l’ouvrage résume un véritable choix politique qui tourne le dos à l’idéologie libérale qui a abouti en Europe « au fiasco de la stratégie de Lisbonne » et « va provoquer un désastre encore pire avec la combinaison d’austérité budgétaire et de politiques structurelles » inadaptées. En jeu, les conditions d’une croissance durable, seule réponse à la crise de la dette. Car l’union budgétaire et la formation d’un marché financier stable et unifié par les eurobonds ne suffiront même pas. « Pour que la zone euro ait un avenir, il faut un projet de développement et d’innovation sur l’ensemble des activités économiques, porté par des dirigeants politiques dotés d’une vision à long terme et capables de mobiliser les populations dans ce sens ».
Écrit à partir d’entretiens avec Richard Robert, ancien rédacteur en chef de Cadres CFDT, le livre pose les jalons d’une mobilisation très ambitieuse, mais réaliste. La crise financière est bien un défi posé à nos systèmes démocratiques. Elle a mis un terme à l’illusion d’une économie financière porteuse de la croissance. L’exigence de la dette aujourd’hui est moins de rembourser l’intégralité que d’être en mesure de dépasser les intérêts individuels immédiats. La soutenabilité est un processus de très long terme. L’Europe sortirait ainsi renforcée sur le plan mondial en participant à la stabilité monétaire internationale.