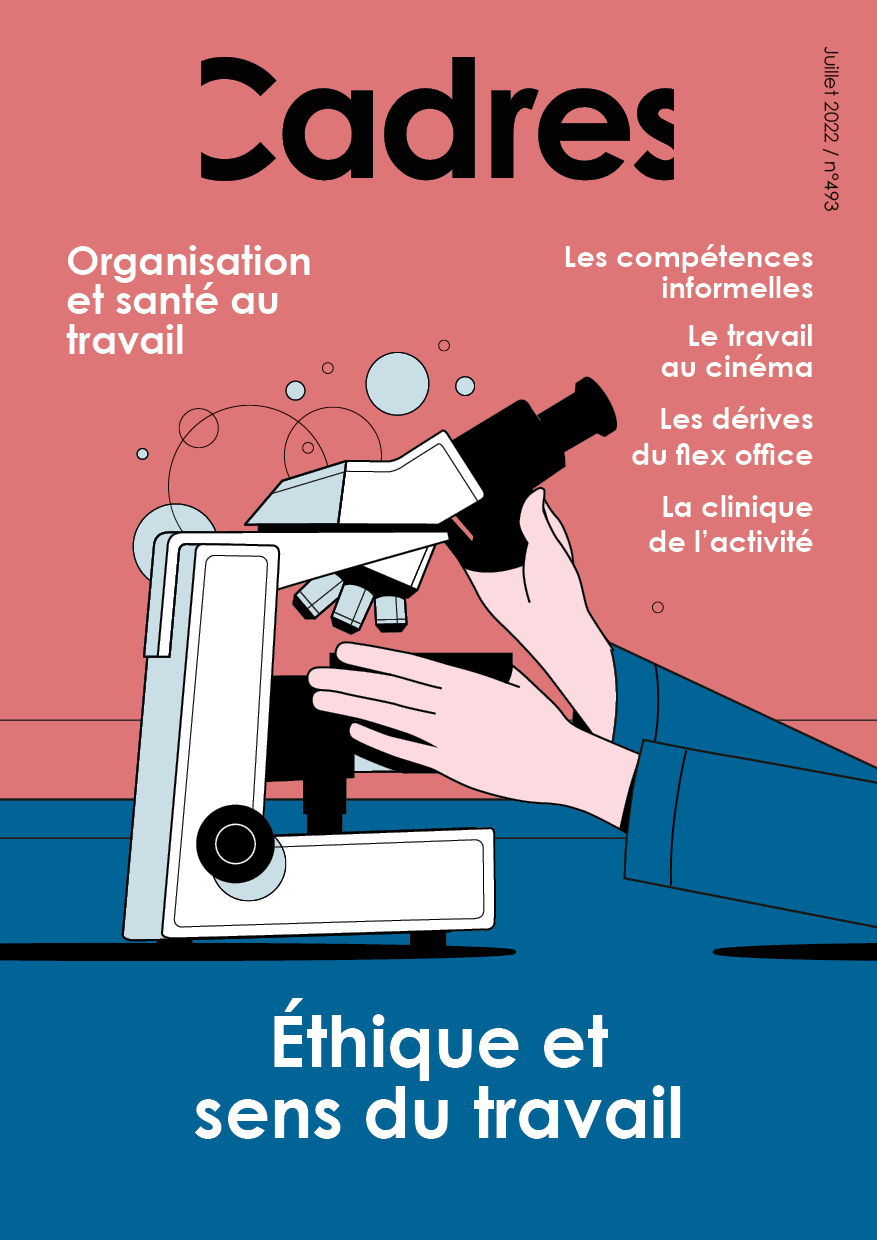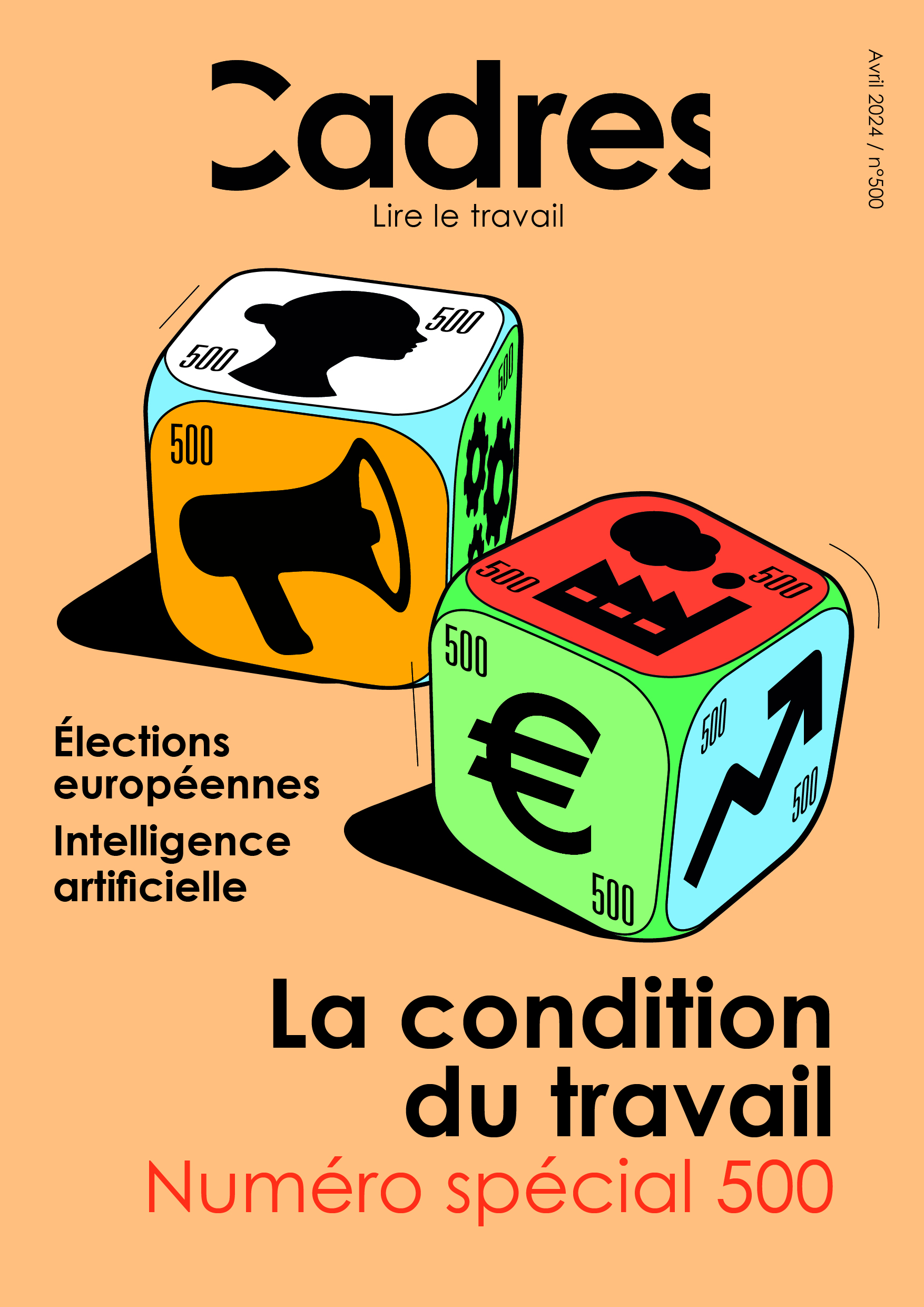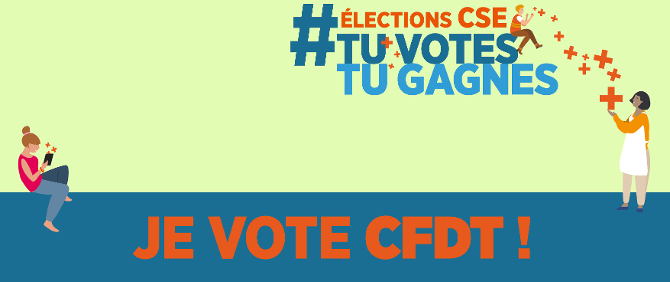En 2005, avec Laurent Falque, nous présentions dans Pratiques de la décision[1] une synthèse des méthodes classiques de la décision (identifiées par les sciences de gestion) et des trois principaux pièges guettant les décideurs, avant d’exposer le processus de discernement selon la finalité, processus inspiré des Exercices spirituels[2] du théologien Ignace de Loyola. En 2020, avec Apprendre à choisir. Une méthode pour décider seul ou à plusieurs (Dunod), reprenant le schéma de nos livres précédents, nous montrons comment s’articulent nécessairement discernement individuel et discernement collectif. Ce faisant, nous sont apparus bien des obstacles à la pratique d’un discernement collectif permettant un consensus véritablement partagé. Cet article évoque quelques-uns des obstacles qu’il faut dépasser pour atteindre un tel consensus.
La décision collective et ses ambiguïtés
Les promoteurs de la décision collective – comme Howard Rheingold, dont le livre Smart Mobs[3] a rencontré un grand succès aux États-Unis – présupposent que les membres d’un groupe, au regard de leurs compétences et de leurs expériences propres, seraient en mesure de mieux cerner le problème à résoudre, d’imaginer davantage de solutions et de choisir la meilleure alternative. Toutefois, l’observation en psychologie sociale ne confirme pas toujours cette perspective optimiste. De nombreux obstacles s’y opposent[4]. Ainsi, en France, si Christian Morel, connu pour ses travaux sur Les décisions absurdes[5], dénonce vigoureusement les processus de décision de type autoritaire[6], il se montre critique à l’égard de bien des décisions collectives : « L’intelligence collective produit régulièrement des décisions complètement erronées ou stupides, par exemple l’autorisation en 1986 de lancer la navette Challenger, alors que les décideurs savent qu’elle souffre d’un grave défaut et que certains d’entre eux sont convaincus qu’elle va s’écraser. Pourtant ces décisions ont fait préalablement l’objet de nombreuses délibérations entre personnes haut placées dont le rang est en phase avec les capacités intellectuelles. Elles sont prises dans le cadre d’organisations structurées et ont été alimentées par une grande quantité d’informations. Or, ces trois éléments – les délibérations, l’organisation et l’information – sont susceptibles d’être affectés par de puissants dysfonctionnements, qui vont égarer collectivement des acteurs individuellement rationnels[7].»
Management des organisations et décision collective
Si la question de la participation des salariés aux décisions qui les concernent est ancienne, les dirigeants d’entreprises, en France tout au moins, se sont généralement montrés plutôt frileux dans la promotion de cette participation de leurs collaborateurs à la vie de l’entreprise. En effet, « la participation des salariés aux décisions de l’entreprise fait l’objet de peu d’obligations légales, et elles sont assez récentes », constate un groupe d’employeurs[8]. Ces dernières décennies, au-delà de la consultation obligatoire du comité d’entreprise, de nombreux courants managériaux ont fleuri où la question de la participation aux décisions des collaborateurs de l’organisation[9] est largement mise en avant : entreprise libérée, holocratie, sociocratie, entreprise opale autogérée, coopérative en gouvernance partagée…
Quel que soit le modèle d’organisation retenu, l’équilibre dans la participation aux décisions semble se jouer entre la part faite à la contribution stratégique et celle attribuée aux niveaux opérationnels. Une étude de l’Anact le pointe : « Les modèles qui ouvrent la discussion uniquement sur des enjeux opérationnels risquent de reproduire la coupure entre les personnes qui pensent l’organisation et celles qui doivent la mettre en œuvre. » Ce que prétendraient changer ces mêmes nouveaux modèles managériaux, dont fréquemment l’initiative relève du seul dirigeant ; c’est ce qui faisait dire aussi à un salarié d’une « entreprise libérée » que « le processus de libération n’était pas très libéré »[10].
Quelques biais qui entravent les décisions collectives
Le groupe de décideurs, centré sur la tâche à accomplir, s’inscrit-il dans une logique de coopération et de succès collectif ? Ou bien ses membres sont-ils en concurrence les uns avec les autres, en conflit d’autorité, développant des stratégies personnelles d’affirmation de soi, de leur légitimité ou de leur expertise ? Ou encore, recherchent-ils avant tout un consensus ou une bonne entente au détriment de l’efficacité ? De telles dispositions individuelles ouvrent grand la porte à la « pensée de groupe » ainsi nommée par Irving Janis, le psychosociologue américain. Celle-ci peut apparaître lorsque le groupe, soumis à une forte pression temporelle (décision devant être prise rapidement), à un leadership autoritaire, ou confronté à des circonstances stressantes, recherche un accord rapide, au détriment d’une appréciation plus réaliste et objective de la situation et des actions possibles[11]. Il rend la pensée de groupe responsable d’un certain nombre de désastres survenus dans l’Histoire des États-Unis comme la destruction, le 7 décembre 1941, de la flotte américaine rassemblée à Pearl Harbour.[12] D’autres facteurs encore interviennent pour mettre à mal l’efficacité de décisions collectives :
- La taille du groupe. Plus les participants sont nombreux, plus le risque est grand de voir les décisions suivre l’avis de quelques-uns considérés comme experts. L’accord n’est qu’apparent ;
- Seul contre tous. Si quelqu’un dénonce une erreur dans un groupe qui soutient cette erreur, il pensera qu’il est lui-même en train de se tromper ;
- Les comportements bienséants. Ces règles non écrites, plus ou moins présentes dans les groupes, tendent à limiter ou à empêcher la prise de parole. Ainsi, il est de bon ton de « ne pas insister », de « ne pas intervenir si l’on n’est pas spécialiste du sujet », de « ne pas contredire telle ou telle personnalité », etc.
Des études en psychologie sociale mettent en évidence des phénomènes de « polarisation du groupe » (distinct de la « pensée de groupe ») : les décisions prises après discussion correspondent à une accentuation des avis ou des positions de départ des participants. Ainsi, les décisions seront orientées vers un plus grand risque si les tendances individuelles sont à la prise de risque, vers une plus grande prudence, au contraire, si la tendance initiale, partagée par les membres du groupe, vise la prudence.
Comment dépasser certains de ces obstacles ?
La première condition est de les avoir bien présents à l’esprit, à tout le moins chez l’animateur du groupe de décideurs. Pour éviter, par exemple, les méfaits de la « pensée de groupe », Irving Janis formule trois règles : 1) Informer les participants de l’existence de la « pensée de groupe », de ses causes et de ses conséquences ; 2) L’animateur de la réunion sera attentif à favoriser l’expression des doutes, des objections et des avis minoritaires ; 3) Un participant jouera le rôle d’avocat du diable en critiquant les idées en cours et en proposant des contre-arguments. Dans Décider ensemble (Seuil, 2021), Philippe Urfalino[13] invite à une réflexion de fond sur la définition de la décision collective et à quoi elle engage. Distinguant le choix de la décision, il identifie cette dernière comme l’arrêt de la délibération, autrement dit le moment où le choix se porte sur une option et la retient. Puis, à partir d’une analyse critique des définitions classiques de la décision collective, il propose celle-ci : « La décision collective est la décision d’un collectif ». Ainsi, il lie étroitement la décision collective aux rôles, mandats, fonctions ou responsabilités des participants réunis par ce cadre institutionnel où ils doivent choisir. Philippe Urfalino s’intéresse particulièrement aux modalités d’arrêt de la décision collective. C’est-à-dire à la façon de mettre fin à la délibération (toute la seconde partie de son livre y est consacrée). Déjà, en 2010, il constate que, dans les réunions d’équipe ou les conseils, les modalités « d’arrêt de la décision » sont, en dehors de l’appel au vote, rarement indiquées[14]. Pourtant, ces modalités doivent être clarifiées pour fixer les conditions du débat et son terme.
Le vote comme première règle d’arrêt de la décision
L’appel au vote, à main levée, oral, à bulletin secret, ou électronique, reflète peut-être la procédure la plus fréquente de prise de décision. Il requiert une majorité des voix, définie comme simple, qualifiée, ou selon un pourcentage fixé à l’avance. L’unanimité peut aussi être recherchée. Et en cas d’absence de majorité claire, la voix du président sera considérée comme prépondérante, etc. Annoncé à l’avance, le moment du vote indique que le débat a atteint son terme. Le plus souvent, ce sera à l’initiative de l’animateur du groupe. Après avoir reformulé la ou les propositions auxquelles le groupe est parvenu, l’animateur s’assurera que tous approuvent cette reformulation ; puis, à partir des résultats du vote, il entérinera la décision ainsi prise comme étant celle du groupe. Le vote met l’accent sur l’approbation : on est « pour » ou « contre » une proposition. La voix de chaque participant pèse autant. La somme des avis fait office de décision. À main levée comme à bulletin secret, chacun est obligé de se prononcer, sinon de faire connaître son abstention. Le groupe accepte donc des désaccords en son sein. Il les identifie et en mesure la proportion lors du résultat du vote. L’ampleur du résultat rend la décision plus ou moins solide, comme cela peut se vérifier quotidiennement dans les organisations, le consensus restant partiel.
Le « consensus apparent » comme seconde règle d’arrêt de la décision
À côté du vote, Philippe Urfalino identifie une seconde règle d’arrêt des débats – pratiquée dans les organisations, en l’absence de règles de prise de décision initialement fixées –, le « consensus apparent » : « Vous avez une assemblée, un comité, une commission, qui a une décision à prendre et il y a une discussion. À la suite de cette discussion, à un moment donné, un membre du comité – le plus souvent, quelqu’un qui a une certaine autorité, qui peut être formelle, un président de séance, par exemple – prend la parole d’une manière un peu plus solennelle et propose ce qui lui semble le résultat de la discussion. L’idée est que du débat pourrait sortir une proposition qui a vocation à rassembler les avis des uns et des autres. Une fois qu’elle est émise, il y a deux solutions : quelques-uns approuvent, la plupart se taisent. À ce moment-là, la décision est prise. La proposition qui a été émise devient décision. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une contestation, quelle que soit la forme de cette contestation[15]. » Il peut arriver, tout au contraire, qu’une objection soit faite. La discussion reprendra jusqu’à ce qu’une nouvelle proposition ne soulève aucune contestation. Si ce n’est pas le cas, aucune décision ne sera prise et il faudra se réunir à nouveau. Comme le souligne Philippe Urfalino, le « consentement est quelque chose d’assez subtil qui va de l’approbation que l’on ne veut pas formuler jusqu’à l’opposition qu’on ne peut pas formuler ». Entre les deux, « il y a l’approbation avec réserve qu’on manifeste par le silence, il y a l’indétermination (je ne sais trop ce qu’il faut faire, donc je ne dis rien) »[16]. Le silence peut masquer une forme de démission : laisser les autres décider pour soi ; ou bien une forme de perplexité… Dans ce type de fonctionnement, la décision proviendra de la non-opposition à la dernière proposition soutenue par un des membres du groupe. L’engagement des personnes dans la discussion ou leur retrait sont alors déterminants. Et, contrairement au vote où toutes les voix ont un poids égal, dans le consensus apparent, la décision peut être prise sans que la répartition des préférences des participants soit connue.
Discernement collectif et consensus partagé
Le discernement collectif bien mené offre une troisième règle d’arrêt de la décision : le consensus partagé. Comment les personnes peuvent-elles faire un choix collectif en toute sérénité lorsqu’elles savent pertinemment que sa mise en œuvre concernera plusieurs d’entre elles et qu’elles ne partagent pas le même point de vue ? Comment parvenir à se mettre d’accord, non pas sous forme de compromis, mais en faisant un choix dont le bien-fondé sera reconnu par tous ? Que les décisions soient d’ordre stratégique, financier, administratif, managérial, etc. ; qu’elles relèvent du droit, de l’éthique, de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la sécurité des biens et des personnes, etc. ; aucune de ces décisions ne peut être le fait d’un seul. C’est pourquoi, à l’écoute de leur annonce, journalistes et commentateurs s’interrogent : comment ont-elles été prises ? Qui a été consulté ? Quelles influences se sont exercées ? Quelle concertation ? Quelle adhésion a été recherchée ? Que comprendre par « consensus partagé » ? : ce consensus marque l’arrêt de la délibération. Il se présente comme un accord unanime sur le choix d’une option après la mise en œuvre d’un processus de discernement. Cette opération exige, tout d’abord, que tous s’entendent sur la « raison d’être » de leur organisation, qu’ils définissent ensemble le problème à résoudre, partagent les mêmes enjeux et identifient les options du choix à faire. Dans un second temps, en vue de préparer la délibération, le groupe devra s’assurer que chacun et tous sont en mesure de considérer chaque option avec une égale sympathie, avant même de poser les termes de leur délibération.
Le discernement collectif est ainsi un processus où il est possible, même si cela demeure exigeant et difficile, de dépasser les formes de décision où chacun risque de rester sur son « quant à soi ». Aller dans le sens de choix pris ensemble et véritablement partagés.
[1]- B. Bougon et L. Falque, Pratiques de la décision, Dunod éditeur, 2005, 2009, 2013. Les 3 premières éditions, mises à jour et remaniées, sont épuisées.
[2]- Le but de ces Exercices spirituels est d’accompagner spirituellement une personne qui désire prendre, dans les conditions d’une plus grande liberté, une décision importante pour elle. Dans nos ouvrages, nous nous inspirons directement du processus proposé par saint Ignace de Loyola.
[3]- H. Rheingold, Smart Mobs : The Next Social Revolution, Basic Books, 2002 ; traduit en français, Foules intelligentes : une révolution qui commence, M2 Éditions, 2005.
[4]- Cf. Laurent Bègue et Olivier Desrichard, Traité de psychologie sociale : la science des interactions humaines, Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2013, p. 42.
[5]- Christian Morel, Les décisions absurdes I, Gallimard, 2002.
[6]- Christian Morel et Jean-Marc Oury, « Des décisions absurdes aux processus de la haute fiabilité », Séminaire « Les Invités », Les Amis de l’École de Paris du Management, 2011, www.ecole.org
[7]- Christian Morel, « Les dérives de l’intelligence collective », Sciences Humaines, Grand Dossier no 36 (automne 2014).
[8]- « Entrepreneurs et dirigeants chrétiens », Les cahiers des EDC (avril 2019).
[9]- Par organisation, nous désignons toutes les structures privées et publiques où les questions de management sont à l’ordre du jour : entreprises, administration, collectivités locales ou encore associations…
[10]- Anact, entretien avec Clément Ruffier, « La participation des salariés aux décisions : pourquoi et comment, quels impacts sur les conditions de travail ? », La Revue des conditions de travail, no 12 (2021), p. 5.
[11]- Cf. les exemples de Maria Augustinova et Dominique Oberlé dans Psychologie sociale du groupe au travail : Réfléchir, travailler et décider en groupe, De Boeck Supérieur, 2013, p. 175-177.
[12]- Irving Janis, « Groupthink », dans Emory A Griffin (Ed.), A First Look at Communication Theory, New York, McGraw-Hill, 1991, p. 235-246. Selon Janis, le rassemblement de la flotte américaine en un seul port résulte d’une décision prise en fonction d’une « pensée de groupe ».
[13]- Directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’EHESS, il est devenu un spécialiste reconnu de la décision collective.
[14]- Stéphanie Novak, entretien avec Philippe Urfalino, « Comment s’arrêtent les décisions collectives », La Vie des idées (janvier 2010), laviedesidées.fr
[15]- Ibid., p. 1.
[16]- Ibid., p. 2.