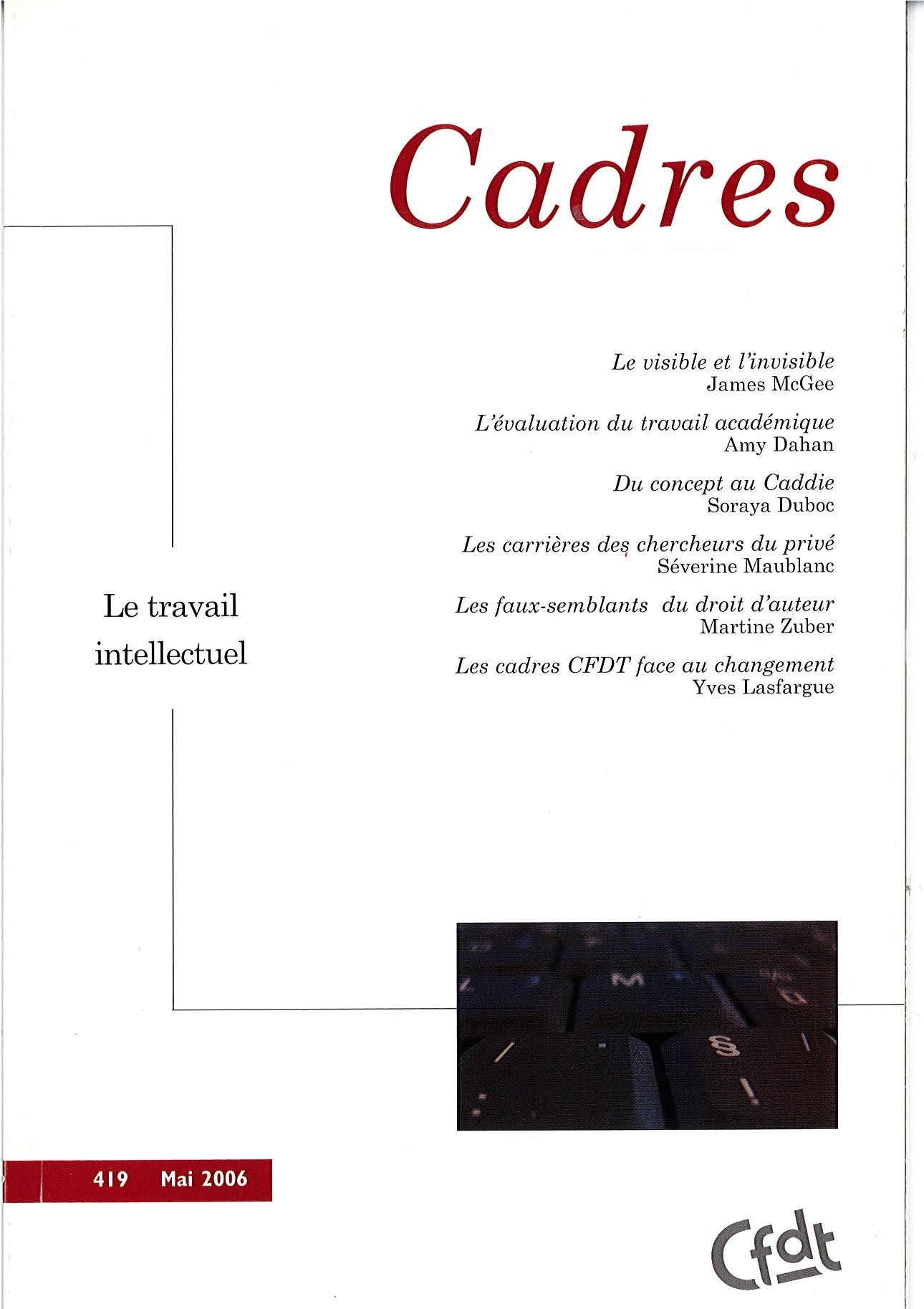Les expressions varient : économie du savoir, capitalisme cognitif, économie de la connaissance. On parle aussi de société de la connaissance, pour désigner un phénomène touchant non seulement les organisations de travail, mais aussi l’ensemble du monde qui nous entoure.
Sorti des images un peu faciles de la nouvelle économie, qui réussirent à angoisser autant qu’à faire rêver, comment représenter ce nouveau monde ? Comment comprendre ce qu’il emprunte à l’ancien, ce qu’il invente, ce qui demande à être maîtrisé et ce qui ne saurait l’être ? Fidèles à une méthode qui commence à faire école à la CFDT, nous avons décidé de partir du travail, de l’expérience quotidienne et des perspectives de ceux qui sont au cœur de cette métamorphose. Car si nous vivons tous, désormais, dans l’économie du savoir, il existe des « travailleurs du savoir » autour desquels se reconfigurent les situations et les parcours professionnels.
Il ne faudrait pas les voir comme une nouvelle avant-garde ou une promesse d’avenir, car certains d’entre eux survivent dans les interstices du monde du travail : les travailleurs du savoir, ce sont bien souvent des formateurs à la petite semaine ou des correcteurs d’édition rémunérés en droits d’auteur, vivant les uns et les autres aux marges du salariat.
Ce sont aussi des chercheurs, du public et du privé, confrontés les uns et les autres au problème du maintien des compétences, de l’orientation de carrière, du choix de structures et des hiérarchies pyramidales dans lesquelles tous n’arrivent pas à se hisser.
Que cet univers soit plus fluide et plus souple que le monde bien structuré de la société industrielle est une évidence. Que cette souplesse porte en elle une part d’angoisse en est une autre. Le travail physique pur de son côté perd de son importance, ou du moins devient sous-traité et non stratégique, par rapport aux compétences technique, scientifique, organisationnelle, communicationnelle et la capacité créative et adaptative.
C’est du côté de la recherche et du développement que gît aujourd’hui la valeur qui permettra à nos entreprises et à notre société d’affronter l’avenir.
L’accumulation capitalistique porte à présent sur la connaissance et sur la créativité, c’est-à-dire sur l’immatériel. On parle au niveau microéconomique de capital intellectuel.
Toute la question réside en fait dans la représentation de cette valeur désormais centrale : en faire un capital est sans doute une idée très opérante, mais ne fausse-t-elle pas le jeu ?
Certes, on ne saurait ignorer les théories qui, en partant du fait que le travail intellectuel est désormais central dans la vie économique, expliquent le surgissement de nouvelles élites, compétitives, à l’aise dans un espace mondial et promptes à occuper les lieux les plus rémunérateurs, dans et hors des organisations : consultants, experts, cadres de haut niveau et créatifs de talent voient effectivement une incroyable opportunité dans la nouvelle configuration de l’économie. Leurs perspectives et leurs niveaux de rémunération n’ont plus rien à voir avec ceux de leurs aînés qui avaient les mêmes compétences dans la société industrielle. Ces nouvelles élites, ces « manipulateurs de symboles » sont sans aucun doute les grands gagnants du passage dans une économie du savoir. Leur surgissement explique en grande partie cette polarisation nouvelle du salariat qui n’épargne pas l’encadrement et interroge désormais sur l’avenir même des classes moyennes.
Mais précisément, plutôt que d’assister impuissant à l’érosion de ce socle économique et social qui a donné tant de solidité au monde industriel, ne faut-il pas reconsidérer la question de la valeur et revenir sur les représentations économiques qui soutiennent cette nouvelle société ?
L’une des assises économiques de cette « classe » en voie d’émergence est en effet sa prétendue compétitivité. Il nous arrive d’ailleurs, à la CFDT, de céder à cette représentation en répartissant les salariés en compétitifs, protégés, précaires et exclus. Fort bien ; mais ces compétitifs, le sont-ils vraiment ? Ne sont-ils pas plutôt les bénéficiaires d’un héritage social ou d’un flair professionnel qui leur a permis de trouver des niches particulièrement rémunératrices, ou particulièrement protégées ? Il ne faut pas se laisser prendre à cette « compétition » qui, en France surtout, se conjugue étrangement à des trajectoires où tout est joué dès l’âge de vingt ans, par la magie des grandes écoles.
Deuxième remarque : ces nouvelles élites prennent leur essor dans un corps social, un territoire, un ensemble d’institutions, une population. Les représenter comme les détentrices d’un capital intellectuel, avec lequel elles pourraient jouer en propriétaires légitimes tandis que d’autres seraient condamnés à la médiocrité, c’est faire bon ménage de la construction collective de ce capital. Ou alors allons jusqu’au bout, en faisant de leurs anciens instituteurs des actionnaires de leur savoir.
On l’aura compris : si l’économie du savoir bouscule les organisations de travail et invite à reconsidérer l’idée même de la valeur, elle se conjugue avec des bribes du monde ancien, représentations économiques inopérantes ou castes prêtes à jouer de nouveaux jeux de domination. Des notions aussi essentielles que la redistribution, la valeur ajoutée, la propriété intellectuelle demandent aujourd’hui à être réactualisées. Ce numéro ne prétend en rien à l’exhaustivité ; en posant certains des problèmes qui traversent l’économie du savoir, en les posant du point de vue du monde du travail, il appelle simplement à poursuivre la réflexion.