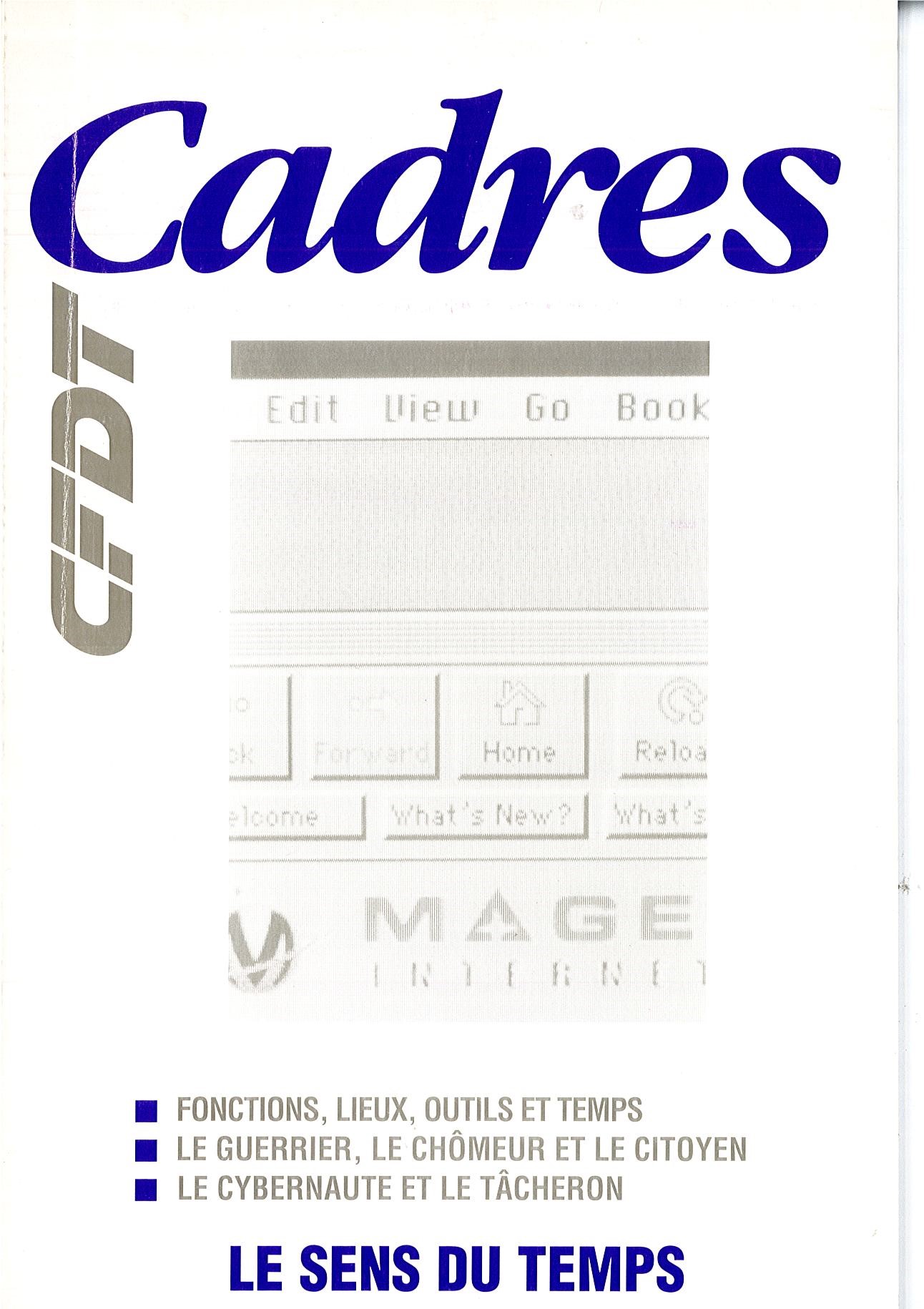La question sociale lancinante et de plus en plus dramatique de l’emploi projette les entreprises publiques et privées dans un discours justificateur par la guerre économique alors qu’il y a six ans seulement la mode managériale était à la gestion des ressources humaines ! Il s’agissait alors de mobiliser le personnel pour réagir aux aléas de la contingence technologique par la création participative d’une meilleure qualité, à la japonaise. Il s’agirait maintenant d’une lutte, sans merci pour le personnel, face à la concurrence internationale, l’objectif étant de battre les adversaires en se pliant aux injonctions de la finance pour réduire les coûts de personnel et faire toujours mieux avec moins de monde mais avec des compétences sans cesse renforcées. Que penser de ces images de samouraï et de mobilisation aux frontières sacrées de l’économie ? Les mêmes entreprises tenaient, il y a encore seulement vingt années, le discours de la rationalité organisationnelle dans un monde visant, grâce au développement technologique, le plein succès de la société de croissance et de consommation. Et les années quatre-vingt ont été marquées par un autre discours de type communautaire où la qualité des résultats devait reposer sur le caractère intégrateur de la culture d’entreprise. Comment croire à de tels renversements de perspectives avec toutes leurs conséquences sur les transformations du rapport entre entreprise et société ?
Un nouveau discours de la guerre économique
D’une certaine façon, nous assistons à un étrange déplacement du discours de la guerre vers les activités productives, alors que les périodes antérieures de la révolution industrielle nous avaient plutôt habitués à une profonde dichotomie entre la paix indispensable aux échanges et à la production économique, et la guerre de conquête ou de défense des territoires que l’Etat devait mener de temps à autre pour renforcer les bases saines d’une économie pacifique. Seule l’économie de guerre pouvait mélanger les deux réalités mais elle restait limitée à la production des flottes, des armes et des fortifications, constituant une zone de production étatique isolée. Avec les deux guerres mondiales et les quarante années de guerre froide qui les ont suivies, une nouvelle forme de mixité s’est progressivement installée, depuis « les efforts de guerre », où l’ensemble de la production se voyait imposer des objectifs d’armement et de soutien aux combattants, jusqu’aux complexes militaro-industriels surtout développés à l’Est au détriment de la satisfaction des besoins de consommation du peuple tout entier.
Certes, la guerre sociale autour de l’exploitation des travailleurs par le capital a transformé la vision de l’entreprise en champ de bataille entre classes sociales pour le renversement du système économique libéral, ou tout au moins pour le contrôle des conditions de salaire et de travail. Mais cette lutte, sauf cas exceptionnel de sabotage, ne concernait pas les actes mêmes de la production. Les grèves arrêtaient le travail mais en protégeant l’outil et les forces de production. La guerre sociale ne visait pas, en fin de compte, l’économie mais bien le pouvoir du capital et de l’Etat.
Entreprises, armées permanentes
Ainsi, jamais auparavant, les entreprises n’avaient pu être assimilées à des armées permanentes pour mener un combat vital à l’échelon planétaire, où l’on se prend non des places fortes mais des parts de marché, des majorités de contrôle du capital, et surtout où l’on s’efforce par tous les moyens d’exporter le chômage chez l’adversaire. Les chefs d’Etats se déplacent pour négocier des achats d’avions ou de TGV. Les pays neufs négocient durement les transferts de technologies en échange de commandes et cherchent à bénéficier au maximum des avantages concurrentiels qu’ils appuient sur les différences de coûts salariaux et sociaux de leur production. Devenue encore plus sauvage en Europe avec la nouvelle concurrence industrielle des anciens pays industrialisés du bloc soviétique, cette situation de rivalité acharnée a fini par atteindre les règles de la vie civique. La corruption, pour obtenir les marchés, touche de nombreux chefs d’entreprise, tandis que les pratiques de mafia se répandent à grande vitesse dans les nouvelles sociétés de marché de l’Est européen. D’une certaine façon, les prévisions marxistes d’une guerre économique inexorable entre nations capitalistes, pour conquérir des marchés et des chasses gardées de nature coloniale, se révèlent justifiées, à cette différence près que la contre expérience socio-économique du communisme totalitaire a échoué, précisément sur le plan économique.
Or, depuis cet événement majeur, les entreprises se trouvent progressivement engagées dans une sorte de guerre interne autour du sauvetage de l’emploi performant. Les plans sociaux sont quasiment présentés comme inévitables, et les succès de GRH finissent par s’évaluer en nombre de licenciés sans problèmes graves. Quels cadres, quels dirigeants ou experts-conseil n’ont pas trouvé dans ce discours de la guerre une justification, même honteuse, de leur refus d’embaucher et de leur politique de dégraissage des effectifs ?
Certains gestionnaires pourraient même aller plus loin ! Puisque guerre il y a, faisons-la pour gagner, sans état d’âme. Que les entreprises recrutent et décrutent qui elles veulent pour vaincre sur les champs de bataille du marché. Qu’on les laisse faire la guerre à fond et à leur manière, comme les condottieres, les mercenaires et les coloniaux du temps passé, pourvu qu’elles rapatrient des parts de marché, des contrats et des avantages concurrentiels durables qui mettront les indicateurs économiques au beau fixe. Profitalibilité, rentabilité, compétitivité, balance commerciale, taux de croissance de la production, innovation et créativité deviennent les maîtres-mots de cette guerre économique. Mais dans une économie libérale mondialisée l’objectif de cette guerre à outrance n’est plus la victoire sur un pays voisin, dont on se protégerait par de nouvelles frontières, mais bien la qualité de société, de niveau de vie et d’emploi qui doit en fin de compte s’instaurer dans les pays, les régions et les villes où sont installées les entreprises.
Une nouvelle forme de dualisme
Une nouvelle forme de société duale permanente se dessine ainsi à l’horizon de notre monde libéral. D’un côté on situe les porteurs de guerre économique sans frontière formant des sortes d’entreprises commando, recrutant, formant, rémunérant et licenciant ses gens en fonction des exigences de la bataille. D’un autre côté la société civile, celle des élus, du quartier, des loisirs, de l’éducation et de la culture, gère à sa façon le douloureux problème du chômage et de l’insertion par une autre compréhension de la vie active. Chacun devrait ici avoir le droit à la dignité de citoyen actif et reconnu dans le monde du bénévolat, de l’associatif, des études et du troisième âge. Il ne s’agit plus d’assistance sociale aux miséreux, mais d’une philosophie du temps choisi et de la pleine activité, dont on pense qu’elle produira plus de solidarité et de vie collective attentive aux besoins des individus.
Après la période taylorienne ayant instauré une division sociale du travail entre ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent, après une autre version de société duale séparant les entreprises de technologies avancées, jouant sur la scène mondiale, et les productions traditionnelles d’artisans et PME cantonnés dans la scène locale, nous voici confrontés à une énième formule de dualisme entre, d’une part, les entreprises qui créent les bénéfices, et d’autre part, la société civile qui s’occupe du chômage et de la dignité humaine ! Cette formule a-t-elle plus de légitimité que les précédentes au regard des valeurs de la démocratie et de l’avenir de nos civilisations ?
Entreprise et société : quels rapports ?
A quelle condition cette conception de l’économique abruptement séparée du social pourrait-elle être compatible avec les principes d’une société démocratique ? Si l’on reprenait l’exemple du service militaire obligatoire, il suffirait de répartir le fardeau de cette guerre économique de façon à peu près égale et obligatoire entre tous les citoyens pour qu’une sorte de justice distributive des risques et avantages permette la prise en charge de la guerre économique par la société civile. Par le moyen d’une rotation réglementée, chacun ferait plusieurs années de travail en entreprises performantes, en acceptant les charges et devoirs de compétitivité exigés par le marché international mais en retirant aussi les avantages d’un parcours professionnel méritant, exécuté à temps partiel ou en période d’alternance. Le service militaire de guerre économique s’apparenterait aux formules suisses ou israéliennes d’une mobilisation permanente sur des périodes de temps limitées. Une sorte de société utopique de gestion égalitaire du fardeau économique deviendrait ainsi progressivement réalité ! Le travail en entreprise se transformerait en simple devoir de la société civile, avec des périodes de rappel, des engagements courts et temporaires, et des moments d’intense dévouement à la cause commune de l’œuvre économique. D’une certaine façon on retrouve ici le modèle de la société kibboutzim, où les activités économiques des entreprises, souvent de haute technologie, n’occupent qu’une part minoritaire de la vie des membres de chaque communauté, par ailleurs consacrée aux activités de la société civile : pédagogiques, culturelles, conjugales, thérapeutiques, rurales et d’exercice de la démocratie locale.
Mais comment croire à la vérité d’un tel modèle à notre époque de marché et de concurrence véritablement transnationale ? Plusieurs arguments s’opposent à la réalisation d’une telle utopie, au moins dans le moyen terme, et que bien loin de partager socialement les risques de l’économique, elle contribue à aggraver les inégalités et déficits de solidarités.
Perte d'emploi et blocage identitaire
Tout d’abord, il faut admettre toutes les conséquences de notre héritage de société industrielle devenue globalement salariale. L’identité sociale des individus est encore largement définie par l’accès à un travail reposant sur un emploi stable et rémunéré et fournissant de raisonnables chances de promotion et de responsabilités créatrices. Perdre la réalité, ou même l’espoir pour les jeunes, d’une telle réalisation sociale par le travail, conduit tout simplement à la perte d’identité personnelle, c’est-à-dire à l’incapacité d’affirmer sa différence, son histoire et son désir quand on ne peut plus faire reposer la preuve de son poids social, aux yeux des autres, sur un parcours professionnel, une expérience ininterrompue de travail rémunéré, débouchant de surcroît sur un avenir probable et maîtrisé. De nos jours, perdre cette référence professionnelle de grade, de spécialité et d’appartenance maison, conduit à vivre une déchirure dans son histoire personnelle et une profonde perte de crédibilité sociale. Les chômeurs, ou les sans emploi, ou même les préretraités, se vivent un peu comme les sans famille, les bâtards ou les vagabonds de nos sociétés d’ancien régime. R. Castel et S. Paugam le soulignent avec pertinence dans les métamorphoses de la question sociale et la montée des nouvelles pauvretés.
Si donc la perte de l’emploi, ou l’extrême précarité qui caractérise les nouveaux jobs à durée déterminée, débouche sur une sorte de blocage identitaire, source de véritables souffrances, on voit mal comment mettre en œuvre les rotations harmonieuses vers un passage à l’emploi temporaire valorisé. Face à la peur de perdre la sécurité et les avantages de l’identité par le salaire durable, les hommes et femmes de notre temps trouveraient mille raisons d’en refuser la perspective.
Tout cela ne veut évidemment pas dire que le travail constitue aujourd’hui une merveilleuse façon de produire l’identité sociale. Sans doute que la définition par le travail, et le mérite de ses efforts et responsabilités, assure une légitimité plus égalitaire à l’identité citoyenne que celle de la famille ou du sang. En réalisant concrètement la division sociale du travail dans une ère de croissance industrielle, les sociétés ont acquis une modernité fondée sur davantage d’égalitarisme qu’autrefois. Mes propres travaux de recherche en entreprise, et ceux qui ont suivi sur la production sociale d’identité, montrent cependant que les vies de travail en organisation industrielle et administrative sont encore fortement inégalitaires en termes d’initiatives, de responsabilités et de mérites techniques reconnus. Le taylorisme et la bureaucratie ne sont pas morts (R. Sainsaulieu, N. Alter, C. Dubar, F. Osty, M. Uhalde, I. Francfort...). La tâche reste immense pour que l’expérience sociale du travail confère à chacun des modalités de reconnaissance et d’affirmation de soi sinon égalitaires, du moins comparables.
Identités professionnelles et société de castes
Parler de cette société de guerre économique consiste donc, d’une certaine façon, à refuser de voir et d’améliorer les conditions professionnelles de la production sociale des identités personnelles. C’est refuser de considérer combien les relations de travail constituent, de nos jours, une part importante de la vie sociale. C’est réduire la vie de travail à une sorte de jeu économique à base de compétences et de moyens financiers en négligeant toute la part des ressources humaines qui s’y actualisent.
Un second argument va contre ce modèle de la société de guerre économique, car pour qu’il puisse être compatible avec une conception de société démocratique, il faudrait que des valeurs d’égalitarisme républicain lui donnent consistance et assise. Pas de régime républicain sans vertus républicaines de justice, tolérance, équité, nous disait déjà Montesquieu dans l’Esprit des lois. Or, où en sommes-nous de semblables valeurs de partage égalitaire de l’emploi performant ? Les recherches de M. Bauer et B. Bertin-Mourot sur la sélection des élites gouvernantes de l’économie montrent que la France privilégie les atouts Etat et Capital sur celui de la carrière et de l’ascension sociale. Le système des grandes et moyennes écoles doublant l’université de masse entretient un fort cœfficient de reproduction sociale au niveau des élites des appareils technico-économiques de notre époque. En d’autres termes, notre société française réserve à d’étroites filières sélectives le recrutement des emplois stables et porteurs d’avantages économiques, sociaux et culturels durables. La société de guerre économique deviendrait ainsi vite l’apanage d’une véritable société de castes. On doit, ici, se souvenir de la façon dont les seigneurs de guerre ont toujours fini par s’approprier les avantages de ces positions risqués pour les transformer en privilèges féodaux durables et transmissibles.
Retour aux privilèges familiaux
Parallèlement à ce déficit de démocratie au sommet, il semble bien que la pénurie de l’emploi ait conduit à la résurgence des « relations » familiales. Toujours vrai dans les milieux artisanaux, ruraux et de petits commerces, (encore que les perspectives de chemins personnels se soient grandement ouvertes, grâce à l’école, par comparaison avec les commerces ou boutiques du siècle passé où l’on exerçait les mêmes métiers et prérogatives de père en fils), le familialisme tendrait, de nos jours, à revenir en force dans les entreprises publiques et privées. Non que les critères de recrutement soient détournés, mais ce sont les informations pertinentes sur les concours, les stages et les périodes de recrutement qui circulent par relations. L’emploi étant rare, il devient un bien précieux que tout un chacun s’efforce de transmettre à ses proches, dans un contexte où l’élévation des niveaux scolaires et culturels confère aux diplômes moins de valeur automatiquement marchande que dans les premières années de la croissance. Quand la pénurie menace, ce sont les relations qui fonctionnent. Tout le monde sait cela. Il en résulte un obstacle fondamental au modèle idéal de la société de guerre économique, car les relations ne sont pas partageables ; elles érigent en privilège l’appartenance à des réseaux affinitaires fermés et la société de guerre économique débouche sur une juxtaposition de structures communautaires, à l’extrême ce sont les mafias qui l’emportent !
Quelle motivation pour le guerrier ?
Un troisième argument s’oppose à la pertinence du modèle de la société guerrière. Pour combattre en effet il faut pouvoir disposer de soldats aguerris, courageux et prêts à se battre. Or comment mobiliser et motiver des actifs autour d’emplois exposés à la guerre économique si celle-ci se déroule en rase campagne et à l’échelon international, sans la protection de frontières solides ? L’agression économique internationale est brutale en effet. Les raiders de la finance rôdent en quête de proies faciles, les Bourses évoluent brutalement au gré des investisseurs de fonds de pensions, les transferts de technologie ne se font plus clé en main, mais sur licences exploitées localement par des main-d’œuvres devenues expertes, en Asie comme en Afrique ou en Amérique Latine. Même protégés par les relations, des diplômes et des affinités, les meilleurs techniciens et cadres d’entreprises rachetées ou déséquilibrées sur le plan financier, peuvent se retrouver à la rue, eux-mêmes chômeurs, après avoir souvent dû jouer le rôle de licencieur. Jusqu’à un certain point la menace peut motiver le guerrier, mais pas dans un climat d’incertitude généralisée et prolongée. Pour cause d’excès de guerre sans foi, ni loi, les entreprises peuvent ainsi se retrouver sans guerriers motivés, trop soucieux de sauver leur propre emploi, pour assumer les initiatives de destruction créatrice qui garantiraient l’avenir.
En fonction de ces trois arguments, nous pouvons affirmer que le modèle de la société de guerre économique ne tient pas, sauf comme prétexte à des actions d’urgence, souvent inconsidérées, mais toujours profondément conservatrices de privilèges acquis face à l’emploi stable. Comme l’affirme Dominique Thierry (Le Monde, avril 1996), l’entreprise risque en fait sa propre légitimité aux yeux de citoyens et de ses salariés, à ne choisir qu’une formule de gestion guerrière de la compétence en oubliant tout ce qui se rattache à l’emploi. A trop s’accrocher à cette justification guerrière du mépris de l’emploi l’entreprise risque d’oublier que, loin d’être une armée, elle est surtout partie intégrante de la société et que là réside une part centrale de son dynamisme.
L’entreprise face à ses responsabilités sociales
A bien y regarder, le succès économique des milieux de production n’a jamais pu faire l’impasse sur ses effets de société. Roustang et Perret nous l’on récemment clairement rappelé (L’économie contre la société). Même au début du siècle, les entreprises paternalistes étaient obligées de prendre en charge les conditions de vie de leurs ouvriers, exclus du monde rural, pour arriver à réaliser une production fiable, tandis que les luttes sociales anarchistes et révolutionnaires fournissaient aux prolétaires l’espérance et la solidarité internationale. Avec la reconstruction et la croissance d’après-guerre ce ne sont plus des îlots de sociétés protégées autour des usines que les entreprises prennent en charge, mais bien l’amélioration des conditions de vie au travail, ainsi que le partage des bénéfices de la croissance, en échange d’une adaptation aux cadences et contraintes du taylorisme. La société de consommation et l’ascension sociale vers une classe moyenne ont été les objectifs et les leviers de la croissance obtenus par la négociation entre partenaires sociaux. Ici la société dont a eu besoin l’entreprise n’était pas autour de chaque entreprise, mais dans la nation toute entière.
Quand les premiers signes de la crise et de l’internationalisation effective des marchés se sont faits sentir, le management des entreprises a opéré un tournant à 180 degrés. Pour réagir aux nouvelles contingences économiques, technologiques et à la pression croissante de la concurrence, il a fallu mobiliser les forces internes autour de la modernisation. Ce sont alors les efforts de GRH, participation, communication, écoute et projets d’entreprise ou de services qui ont été recherchés par des expérimentations sociales concrètes. D’une certaine façon, c’est une entreprise communauté qui devait ainsi produire une cohésion sociale interne comme facteur du développement économique.
Un nouveau défi de légitimité
Mais la mondialisation récente des finances et des marchés confronte à présent les entreprises à l’invention d’une autre sorte de rapport à la société : non plus alentours, extérieur, ou en interne, mais bien en interface, puisque l’accès à l’emploi stable conditionne profondément les identités individuelles dans leur capacité à être sujets d’actions dans tous les domaines de la vie, et que c’est par l’entreprise que l’on obtient l’emploi stable. S. Paugam, Ch. Desjours, P. Boulte ont clairement démontré que chômage et précarité conduisent à une très grave régression sociale et psychique. Voici donc les entreprises confrontées à un nouveau défi de légitimité ! Or les sondages récents (Entreprises et carrières ainsi que des résultats SOFRES, Axa) démontrent amplement une méfiance accrue chez les cadres envers les entreprises qui ne leur assurent plus la promotion, les responsabilités et le sentiment d’être acteur d’un développement économique et social, comme au cours de la décennie précédente. Et l’on assiste au va et vient erratique entre, d’une part, des stratégies d’évolution indépendantistes (anciennement pratiquées par les ouvriers professionnels et les OS, toujours en quête de meilleures conditions de salaire et prêts à quitter les entreprises par lesquelles ils se sentaient surtout exploités, alors qu'à présent ce sont les cadres qui ne se sentiraient plus aussi fidèles et dévoués qu’avant à leur entreprise par laquelle ils se sentent lâchés lors des plans sociaux) et, d’autre part, des replis défensifs sur les communautés d’entreprise dès que l’emploi est menacé (avec le souci de récupérer les activités de sous-traitance, de conserver des volants de précarité et d’utiliser des jeunes stagiaires pour ne pas embaucher).
Modernisation et recentralisation
La mondialisation des affaires économiques et politiques a brutalement projeté l’entreprise taylorienne sur une scène de menaces extérieures où l’arme de la rationalité organisationnelle s’est révélée insuffisante pour sauver de bons établissements face aux prix de producteurs de l’ancien Tiers Monde, augmentés de ceux de l’ex bloc soviétique. En France, et probablement aussi en Allemagne, les entreprises ont réagi par l’effort de modernisation pour sophistiquer les produits et élever leurs avantages compétitifs, au prix d’une sorte de recentralisation sur la communauté des producteurs comme véritable avantage comparatif. L’entreprise s’est ainsi efforcée de rechercher en elle-même les vertus d’un lien social plus participatif et négociateur pour réussir la modernisation en échange de l’emploi assuré, à moyen terme ; cependant au prix de restructuration et de gestion prévisionnelle des effectifs de court terme.
Mais voilà que cette tentative de recentralisation communautaire n’a pas suffi, quand elle a pu être menée assez loin, ce qui n’a que rarement été le cas. La nouvelle donne de la globalisation économique des années quatre-vingt-dix a, semble-t-il, bloqué cet effort de mobilisation collective sur l’expression et la qualité, sur des projets de service et sur l’amélioration des communications internes. Même l’action syndicale a souvent échoué pour permettre que des accords sur l’emploi débouchent sur autre chose que la défense des emplois en place pour ceux qui les occupent.
La nouvelle responsabilité sociale : le partage de l'emploi stable
Face à l’ampleur du déficit de l’emploi, la question se pose alors de définir d’autres politiques d’entreprise intégrant cette nouvelle responsabilité sociale du partage de l’emploi stable, sous peine de devoir à brève échéance supporter les conséquences de l’insertion-échec, avec son prix de régressions sociales et psychologiques pouvant atteindre des sociétés locales et nationales toutes entières. Rappelons-nous les conséquences, gravissimes pour nos sociétés modernes, du nombre de victimes et blessés de la guerre de Quatorze sur la vie politique, industrielle et culturelle, notamment dans les milieux ruraux ! Un sursaut d’imagination est indispensable pour prendre en compte ces nouvelles responsabilités sociales de l’économie, car déjà s’allonge la liste des exclus et des jeunes bloqués dans les impasses de l’insertion.
De l’entreprise fermée à l’entreprise ouverte sur l’emploi
Pour le sociologue, la prise en compte de ces nouvelles responsabilités sociales ne sera possible que par une dynamique de sortie des communautés fermées et défensives vers des logiques d’ouverture sur la société abîmée par l’insuffisance de ses ressources d’emplois. En effet, un regard sur le passé de cette articulation entre l’économique et le social montre que de tels sursauts se sont produits plusieurs fois dans l’histoire des entreprises occidentales mais pas sans conditions particulières, pas sans acteurs nouveaux qui ont été d’une part, d’abord les syndicats de métier, puis les syndicats confédéraux, et, d’autre part, l’entrée en scène croissante de l’Etat comme régulateur de négociations entre partenaires sociaux de 1936 à 1986, pendant plus de cinquante années !
C’est donc un dialogue triangulaire qui a permis antérieurement de sortir des enfermements technocratiques et bureaucratiques d’entreprise pour s’ouvrir aux débats nécessaires sur la gestion des conditions sociales et salariales de la production. Où et comment retrouver de nos jours un tel triangle ouvrant les entreprises à la dimension réelle des problèmes de l’emploi ?
Le local face au mondial
Face à la mondialisation des décisions financières présentant leurs choix comme des impératifs incontournables de court terme, il faut imaginer que c’est au niveau des implantations locales de la production que peuvent s’opérer de tels renouvellements de solidarité, au point de recréer de la société avec et par l’entreprise. En effet, c’est au plan local que le drame de l’emploi se fait brutalement sentir et c’est là que des réserves d’actions et de solutions peuvent être décelées et mise en œuvre. Trois catégories d’acteurs y ont effectivement intérêt : les associations d’insertion, les gestionnaires de ressources humaines d’entreprises et les élus politiques et sociaux.
Du côté des associations, on observe en effet un mouvement important noté par les observateurs du courant de l’économie solidaire (Laville, Eme, Gautrat...) et autres chercheurs sur les dispositifs de l’insertion (Rassouw). Les associations et organismes divers, centrés sur l’insertion et la formation des jeunes, arrivent tous à une bonne maîtrise des processus d’apprentissage et de réintégration de jeunes ou chômeurs de longue durée dans une dynamique de travail, de compétence et de motivation pour tenir un emploi. Le véritable problème est celui de l’absence de passage à l’emploi stable et donc la fermeture des entreprises acceptant, certes, de soutenir financièrement, ou par des aides bénévoles, les organismes d’insertion, mais sans aller jusqu’à offrir des emplois stables. Devenus techniquement fiables, les responsables d’insertion n’espèrent qu’une chose : des contacts avec les entreprises dont ils ne voient trop souvent, encore, que les hauts murs, poternes et ponts-levis barricadés, et dont le siège s’avère interminable et désespérant.
Quatre logiques d'action
Mais au sein des forteresses de production, la maladie de la précarité menaçante a déjà fondu sur les défenseurs qui perdent le moral et plus secrètement le sentiment de leur légitimité citoyenne face à tant de misères. Des souhaits d’ouverture vers le partage d’un emploi stable sont en fait déjà là, encore faudrait-il les percevoir et les exploiter avec plus de rigueur. Ce que devrait développer la gestion des ressources humaines, autrement condamnée aux dures tâches d’exclusion, en complète contradiction avec sa philosophie fondatrice de mobilisation communautaire. Une importante recherche sur les dynamiques sociales d’entreprise (I. Francfort, F. Osty, M. Uhalde et R. Sainsaulieu, « Les mondes sociaux d’entreprise ») montre la coexistence de quatre logiques d’actions légitimes présentes au sein de chaque établissement de production : la communauté défensive, le désir de profession, le souci des résultats et les perspectives de projets personnalisés. Toute culture d’entreprise se présente de nos jours comme une sorte de structure mixte, à reconnaître, entre ces quatre orientations d’actions perçues comme légitimes. Or, face aux menaces sur l’emploi, ces dynamiques peuvent orienter sur d’évidents partenariats avec des faces extérieures.
La communauté défensive sur l’emploi d’un site ou d’un métier vise en fait à protéger plus qu’un salaire : toute une forme de vie locale à laquelle s’intéressent d’autres entreprises. Comment ne pas élargir ce fort sentiment communautaire à une véritable solidarité locale interentreprises ?
Désir de métier et ouverture professionnelle
Le désir professionnel demeure de nos jours une motivation dominante dans la vie de travail : avoir un métier et le conserver, changer de métier à la rigueur, retrouver un métier ancien, ou acquérir de nouvelles compétences et en faire reconnaître la valeur professionnelle, tout plutôt que de se retrouver sans métier, c’est-à-dire vulnérable et sans dignité ! Tels sont les propos qui reviennent à longueur d’enquête en tous milieux. D. Segrestin nous a clairement informés sur la quête d’une valeur d’identité sociale et professionnelle qui se cache sous ces actions à l’allure parfois corporatiste. Or les métiers sont de nos jours confrontés à de constantes évolutions techniques, à des reconversions liées aux politiques de modernisation. Le désir de métier est donc étroitement associé à la nécessité de suivre des programmes de formation continue. Les entreprises peuvent y trouver les voies de nouvelles collaborations avec les universités, lycées, collèges et centres de formation localement accessibles. Des formules d’alternance, métier et congés-formation, permettraient de redéfinir les temps et rythmes de travail et les sociabilités d’apprentissage.
Par ailleurs, les jeunes en quête d’insertion professionnelle sont aussi, et profondément, demandeurs de tutorat et de temps de formation sur le tas. Les formules d’apprentissage en alternance devraient ainsi conduire à réinstaurer des séquences de formation et d’éducation permanente ouvertes aux populations de jeunes au sein même des activités professionnelles classiques ; autre conception de l’ouverture des professionnels sur leurs environnements locaux de jeunes et de formation permanente.
La troisième logique, celle du souci de l’entreprise et de ses résultats auprès de clients et d’usagers, instaure une voie nouvelle dans le partage des responsabilités du développement local. En effet, pour beaucoup de salariés, le souci économique et commercial de leur production n’est pas un vain mot, d’autant qu’ils ont pu acquérir des éléments de comptabilité d’entreprise pour mieux comprendre la marche des affaires. Contrairement à la période de croissance où le désir d’avenir passait surtout par la promotion cadre, l’avenir de son emploi et de sa position sociale passe davantage à notre époque par la réussite d’une entreprise qui sera aussi évaluée en termes d’emplois, de responsabilités et de risques assumés. Il y a là un potentiel de valeurs liées au travail qui tend à s’accroître avec les difficultés de l’emploi. Construire une entreprise c’est déjà, et avant tout, faire son emploi et celui de quelques proches. De telles motivations ne peuvent-elles être décelées et soutenues dans un contexte de développement local ? Les difficiles parcours de créateurs, repreneurs, essaimeurs d’entreprises n’ont pas fini d’être reconnus et socialement valorisés si l’avenir des sociétés locales passe par eux. A nouveau l’entreprise devrait trouver dans cette voie des ouvertures nécessaires à la mise en œuvre d’une dynamique de réponses à l’emploi.
Une logique de double implication
La dernière logique, celle des parcours personnels et individualisés, montre que pour beaucoup d’employés et de cadres l’attachement à l’entreprise est fortement contrebalancé par des engagements locaux associatifs, électifs, éducatifs et familiaux, par l’implantation du travail du conjoint, par l’investissement dans la maison. Pour d’autres, plutôt jeunes et diplômés, l’avenir se conçoit comme un parcours évolutif, interentreprise et même international. Pour tous ces salariés, l’aménagement du temps de travail, du moment qu’il permet des activités extérieures, devient un atout de vie et d’expérience citoyenne. Toutes les formules de temps partiel, y compris celles qui préparent la retraite, deviennent ainsi des outils permettant le double investissement dans la vie de travail et hors travail. On est loin de l’époque de pleine croissance où, pour tenir les engagements de vie familiale, les jeunes femmes salariées devaient adopter une attitude de retrait envers les relations de travail pour réserver leur énergie dans la seconde journée, celle de la maison. On assisterait plutôt à des logiques de double implication dans les tâches professionnelles et les activités civiques et domestiques.
On voit ainsi qu’une gestion des ressources humaines prenant en compte cette variété de logiques d’engagement pourrait aider à légitimer d’autres politiques d’entreprises à l’égard de l’emploi et du temps d’activité nécessaire aux formes diverses du développement local. Responsables d’insertion et responsables locaux d’entreprises, particulièrement DRH, pourraient ainsi trouver des bases d’intérêt et de collaboration.
Mais encore faudrait-il que ces acteurs de potentielles collaborations se rencontrent au sein de processus concrets conduisant à des accords de partenariat autour du développement local et de l’emploi. On doit alors se retourner vers les élus syndicaux et politiques, tous également décrédibilisés par la permanence du chômage. Une nouvelle légitimité ne pourrait-elle pas naître de leur capacité à construire des accords de partenariat entre les forces localement et objectivement concernées par la recherche de solutions à l’emploi : entreprises, grandes et petites, établissements industriels et de services, organismes et entreprises d’insertion, centres de formation privés et publics ? Autant de structures disponibles pour l’aménagement d’accords de partenariat visant à créer et redistribuer des emplois en échange d’aménagements dans la vie locale des gens et d’investissements participatifs dans les activités pour construire une intégration sociale susceptible de faire reculer l’exclusion.
L’entreprise entre deux guerres
Nous étions partis du constat des conséquences de la mondialisation sur la conception même de l’entreprise qui, face à tant de concurrences et de contingences, ne peut plus croire aux anciennes solutions paternalistes, tayloriennes, sociales démocrates et, plus récemment, communautaires, de gestion de son rapport à la société. La gravité sociale du problème de l’emploi qui passe de façon centrale par les pratiques et politiques des entreprises les oblige à faire un choix draconien. D’un côté une sortie de guerre, en fait contre la société parce que purement économique, et l’on retrouve ici, mais au niveau de l’entreprise elle-même, le diagnostic de Perret et Roustang : « l’économie contre la société ». Pour réussir la production dans le libéralisme sans frontière de notre époque, l’entreprise doit se vivre comme guerrière, c’est-à-dire l’inverse de la société civile. Ce sont deux mondes séparés qui devraient se compléter et s’épauler, comme l’armée garantit théoriquement les conditions de paix. Mais nous avons montré que les effets sociaux de cet engagement guerrier ne pouvaient, au moins pour un temps, que détruire la société et la crédibilité de l’entreprise du même coup.
D’un autre côté, le choix devient en fait celui d’une sorte de pacification de l’économie en réinstaurant le souci de l’emploi dans un contexte de développement local. Il s’agit là aussi d’une sorte de guerre mais, cette fois ci, pour l’introduction de la société civile dans l’entreprise. Les luttes sociales ont été progressivement maîtrisées par l’institution de rapports entre acteurs de l’entreprise, des syndicats et de l’Etat au cours des années de la croissance. Et ce fut, d’une certaine façon, la victoire de la société de consommation sur l’ambition des systèmes monopolistiques et totalitaires.
De nos jours, l’emploi est déjà devenu un enjeu de décentralisation pour toute une génération en crise. Au plan local, gestionnaires de ressources humaines d’entreprises, associations d’insertion, élus politiques et sociaux se trouvent conduits, chacun à sa manière, à mener une sorte de guerre d’ouverture aux partenaires de la question de l’emploi, car chacun isolément y risque sa crédibilité. Ces pratiques d’ouverture à des échanges et accords interinstitutionnels ne peuvent en effet advenir qu’en s’imposant aux logiques de cloisonnement et de clivages antérieures. Au plan local, les victimes et souffrances de l’emploi sont devenues si pressantes et si visibles que le besoin de nouvelles solidarités actives peut conduire à de véritables mobilisations, non plus sur la qualité, la technologie, ou sur les parts de marché, mais sur la création et le partage d’emplois stables. Gageons que ce défi est au cœur de la définition d’une modernité postindustrielle des entreprises.