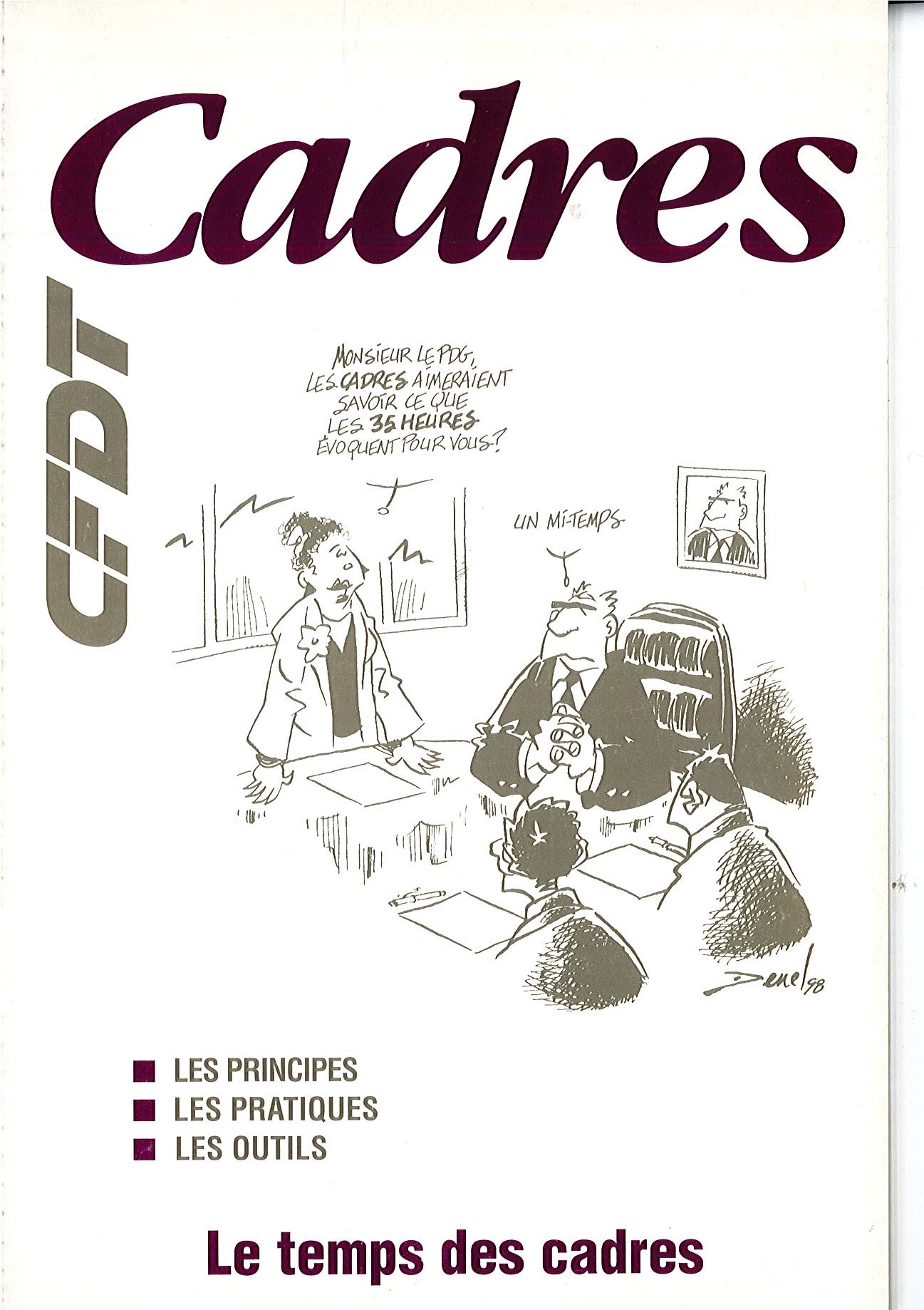La loi sur les trente-cinq heures offre à la société française l’opportunité de se poser la question de la mesure et, partant, de la nature du temps de travail, temps partiellement déconnecté du lieu de travail qui est de plus en plus éclaté. C’est à propos des cadres que le problème se pose avec le plus d’acuité, ce qui conduit certains à se poser la question de la nature du lien qui unit le cadre à l’entreprise. Ce lien est, comme pour tout salarié, le lien de subordination, consubstantiel au contrat de travail. Il est aussi un lien social, constitutif d’une identité sociale.
Une loi opportune, une autre à optimiser
Rappelons d’abord que la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite loi sur les trente-cinq heures ou première loi Aubry, s’applique grosso modo aux entreprises et aux salariés de droit privé. Bien sûr les autres travailleurs de la société française, qu’ils soient fonctionnaires, personnels à statut, indépendants ou employés de maison peuvent à bon escient y voir une norme sociale inspiratrice de leur propre temps de travail mais ils ne sont pas immédiatement concernés par elle.
Contrairement à ce que veulent faire croire ses détracteurs, la loi 98-461 n’est pas une loi autoritaire qui obligerait toutes les entreprises à faire travailler trente-cinq heures par semaine leurs salariés à partir du 1er janvier 2000 ou 2002 car, chacun peut le constater, le temps de travail réel n'est pas forcément de même amplitude que le temps de travail conventionnel, qui lui-même n’est pas nécessairement le temps de travail légal. Certains négociateurs plus intéressés par l’immobilisme que par la dynamique ne se font d'ailleurs pas faute d'utiliser ce décalage. La loi 98-461 est d'abord une incitation à la négociation.
Les cadres font souvent quarante-cinq heures par semaine, de façon généralement contraire à leur contrat de travail qui parle d’horaire collectif d’une durée de trente-neuf heures. Tandis que leurs collaborateurs vont passer de trente-neuf à trente-cinq heures, ils se demandent avec angoisse s’ils reviendront à la légalité, s’ils réussiront a minima à diminuer leur temps effectif de dix pour cent ou s’ils devront l’augmenter encore, entraînés par le système du « forfait tous horaires » qui leur fera perdre toute référence au temps. Ils vivent cette discrimination comme profondément injuste.
La loi du 13 juin est pour la société française une opportunité exceptionnelle qui ne se répétera probablement pas avant une génération. Elle incite à engager une négociation multiforme et permet par conséquence de revitaliser le dialogue social, de mettre à plat l’organisation des entités productives et ainsi d’améliorer à la fois l’efficacité des entreprises, la qualité de la vie des salariés et l’intégration dans l’emploi de ceux qui n’y sont pas.
La « deuxième loi » sera préparée en fonction du bilan des accords. Dans un pays où l’évolution passe par la loi plus que par la négociation, le fait que le législateur se place dans un rapport dialectique avec les partenaires sociaux participe à une évolution importante, dans laquelle d’ailleurs l’Europe a sa part. Et cela confère une importance forte à ce qui se passe aujourd’hui sur le terrain, tant dans les branches que dans les entreprises.
La deuxième loi devra en particulier préciser les choses pour les cadres. Le débat sur la RTT, de loi « Robien » en loi « Aubry », a attiré l’attention sur le fait que la plupart des employeurs n’étaient pas dans la légalité, la plupart des cadres effectuant un certain nombre d’heures supplémentaires « noires », non répertoriées et non payées. Cette constatation étant faite, on a entendu toute une palette de réponses, allant de « puisque nous ne suivons pas la loi, changeons la loi pour qu’elle suive nos pratiques » (c’est-à-dire tous les cadres et même les professions intermédiaires et les employés au forfait sans référence horaire, type de contrat normalement réservé aux dirigeants) à « nous allons respecter la loi, mais pas tout de suite » (on passe de deux mille heures annuelles à mille six cents par étapes), en passant par « nous allons continuer à ne pas respecter la loi mais nous ne ferons proportionnellement pas pire qu’aujourd’hui » (les cadres verront baisser leurs horaires de dix pour cent, pas plus).
A ceux qui disent « les cadres travaillent plus longtemps que les autres salariés et cela doit continuer puisqu'il en a toujours été ainsi » , nous ne pourrons que citer l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » (nul ne peut se prévaloir de sa propre faute). Les entreprises doivent revenir à la légalité.
Heureusement, il y a aussi des réponses sur le thème « travaillons mieux, réorganisons, modulons, négocions » de la part de ceux qui ont admis que si les modalités de la réduction du temps de travail des cadres pouvaient être diverses, le principe était le même pour tous.
Les employeurs (ou plutôt la partie indifférente à détruire les hommes pour consolider les profits) mènent une double offensive pour obtenir des salariés un coût horaire le plus bas possible. En direction des travailleurs « non qualifiés » : ils demandent la suppression du principe du salaire minimal, la diminution des charges sociales, le développement du temps partiel, les heures supplémentaires à la discrétion de l’employeur et payées au même taux et même la prise en charge par la collectivité d’une partie de leur rémunération. En direction des cadres : pour ceux-ci ils acceptent un salaire global correct mais à condition que le nombre d’heures de travail soit le plus élevé possible, et ils enrobent cet écrasement des coûts dans une confiture idéologique selon laquelle les cadres sont tellement attachés à l’entreprise qu’ils ne font plus la distinction entre vie professionnelle et vie personnelle et donc ne peuvent être concernés par une définition légale du temps de travail.
Même si les cadres échappent au « forfait tous horaires », il n'est pas dit que beaucoup d'entre eux ne soient pas contraints à signer un avenant à leur contrat de travail « blanchissant » les heures supplémentaires sous la forme d'un forfait de cinq ou dix heures de plus que la durée hebdomadaire conventionnelle. Ils continueraient ainsi à travailler beaucoup plus que leurs collègues d'autres collèges, mais cette fois en toute légalité.
Nous espérons que la « deuxième loi » consolidera les aspects positifs et novateurs des négociations.
Le cadre n'est pas unidimensionnel
De par leur position charnière, les cadres sont au cœur des processus de réorganisation liés à l’aménagement - réduction du temps de travail, ce qui rendrait pour le moins paradoxal qu’ils en soient les grands exclus. C'est pourtant ce que cherchent des directions qui veulent augmenter la productivité en jouant sur l’extension et l’intensification du travail des cadres. Des idéologues se mettent à leur service en justifiant la suppression de toute référence temporelle par deux types d’arguments : le travail des cadres ne s’effectue pas toujours sur un même lieu, une partie de l’activité des cadres a un caractère mixte entre le travail et le loisir.
Certes, la règle des trois unités ne joue plus : le cadre (parmi d’autres, même s’il est en première ligne) ne fait pas un travail strictement prescrit dans un lieu déterminé pendant un temps collectif rigide. De nouvelles formes de travail sont liées au développement des services par rapport à la production de biens matériels, à l’emploi plus important des nouvelles technologies de l’information et de la communication, aux activités en réseau (bien que cet aspect soit peut-être surestimé : si de grandes entreprises regroupent sur une même plate-forme leurs unités de service autrefois éparpillées, ce n’est pas par hasard).
Les lieux où s'exerce l'activité du cadre peuvent être nombreux (dans l'entreprise, chez le client ou le fournisseur, dans la voiture ou les transports, à domicile), ce n'est pas pour autant que cette activité cesse d'être du travail effectif.
Certes, le cadre prend dans la plupart des cas intérêt à son travail et c’est heureux ! Au sens ancien des mots, on dirait que son activité n’est pas un « travail » mais un « ouvrage ». Son activité professionnelle mêle stress et plaisir, mais ce n’est pas pour autant qu’elle doit envahir toute sa vie.
Le temps et l'argent
Derrière le brouillage idéologique, la réalité crue est que l’actionnaire et son représentant tentent de placer les salariés - et singulièrement les cadres - en prise directe sur le marché, sans les amortisseurs que représentent les garanties collectives, et de retourner la nature du salaire et du profit. Le profit n’est plus le solde entre un chiffre d’affaires éminemment variable et une masse salariale relativement stable. Les capitaux investis se servent désormais les premiers, la masse salariale devient l'élément le plus flexible, la variabilité devient maximale pour l’ensemble des salariés. Parmi ceux-ci, les travailleurs relativement peu qualifiés sont voués au système du temps partiel contraint accompagné d’une flexibilité brutale et à l’emploi en pointillés (alternance de périodes de chômage et de travail, celui-ci généralement de mauvaise qualité et sans perspective), les cadres sont pressés comme des citrons avant d’être pris dans la charrette d'un plan social ou d'un licenciement individuel pas même forcément négocié, ou d'être invités à se transformer en travailleurs « indépendants », sous-traitants à un seul donneur d’ordre.
Si la rénovation du tissu industriel et commercial français qui commence à être impulsée par la loi du 13 juin 1998 ne va pas à son terme, on court le risque de fractures supplémentaires dans la société salariale. Celle-ci juxtaposera des personnes très mal payées (les Anglo-saxons les ont déjà, ils les appellent les Working poors) à temps partiel imposé et fluctuant, entrant et sortant de l'activité, pour lesquelles le rapport entre coût total et revenu net sera relativement bas grâce aux aides publiques en tout genre ; des salariés « classiques » avec contrat de travail à temps plein et durée indéterminée sans annualisation ni flexibilité, « 35 heures payées 39 », retraite complémentaire par répartition et sérénité... jusqu'au plan social qui les transformera en chômeurs de longue durée ; des cadres lambda forfaitisés à « 35 plus 10 » et priés d'en remercier l'entreprise ; des cadres dirigeants à stock-options et fonds de pension, maîtres de leur temps et de celui des autres.
Tant que l’on aura pas inventé une unité pertinente et opérationnelle de la mesure de la charge de travail, la référence collective au temps est un garde-fou dont les cadres ne peuvent pas faire l’économie. Le passage des cadres (entraînant dans leur sillage une partie des professions intermédiaires voire des employés) à un « forfait tous horaires » ou même à un forfait annuel extensif constituerait pour l’ensemble du monde salarié une régression considérable.
Il serait pour le moins paradoxal que cette possibilité d’avancées sociales se transforme en une révision de cent ans de droit social. Et que le prochain siècle soit pour les cadres celui de « cent ans de solitude ».
Lien de subordination et lien social
On entend certaines voix proclamer avec force que la loi ne concerne pas les cadres car leur rapport à l’entreprise n’est pas celui entre employeur et salarié, basé sur un échange temps contre salaire mais un rapport différent, fait de confiance mutuelle et d’adhésion aux valeurs de l’entreprise.
Disons tout net que cette vision des choses nous paraît très dangereuse. Les notions d’allégeance, de fidélité, de dévouement, de patriotisme d’entreprise n’ont aucune valeur juridique et sont socialement régressives. Certes l’obligation de bonne foi exigée dans tout contrat s’applique au contrat de travail mais cela n’a pas à aller plus loin. Et la bonne foi doit exister d'une part comme de l’autre, les partisans du harcèlement psychologique et de la démission forcée ne devraient pas l’oublier, car aujourd'hui le respect des personnes n'est pas toujours une préoccupation hiérarchique. L’article 9 du Code civil pose le droit de chacun à sa vie privée, et la Cour de Cassation se fonde sur lui pour poser les bornes de la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle, limitant ainsi l’étendue de l’échange prestation/salaire. La « perte de confiance » - sous le prétexte de laquelle ont été licenciés tant de cadres - n’est, fort heureusement, plus admise par la Cour de Cassation depuis le début des années quatre-vingt-dix : seuls les faits professionnels qui seraient à l’origine de cette perte de confiance ont à être pris en considération, pas les faits relevant de la vie privée sans rapport avec l’entreprise. Et l’adhésion à des valeurs philosophiques relève de la vie privée. Certes, les entreprises dites « de tendance » (Eglise, parti politique, syndicat) sont en droit d’exiger un peu plus du salarié, mais pas les entreprises industrielles ou commerciales.
Comment d’ailleurs peut-on parler des idéaux d’une entreprise industrielle ou commerciale ? L'entreprise, son conseil d’administration, son état-major peuvent se donner des règles de conduite, certains appellent cela l’entreprise citoyenne, d’autres la prise en compte des stakeholders (les partenaires), c’est simplement le respect de certaines normes sociales. Mais ces règles peuvent varier au cours du temps, en fonction des décisions de ceux qui ont le pouvoir dans l’entreprise privée, c’est-à-dire les actionnaires.
L’entreprise a tendance à demander toujours plus au salarié, sans lui assurer obligatoirement en retour reconnaissance et stabilité.
Le salarié, et pas plus le cadre qu’un autre, n’a pas d’adhésion psychologique à donner à l’entreprise industrielle ou commerciale. Celle-ci n’a pas à se transformer en secte où l’adepte se dévoue corps et âme sans même être assuré de garder éternellement la confiance du Maître.
Ce qui relie le salarié - et qu’il ait une position cadre ne change rien à l’affaire - à l’entreprise privée qui l’emploie porte un nom : c’est le lien de subordination. Dans l’échange salaire contre prestation, le salarié n’a qu’une obligation de moyens : faire le travail qui lui est confié de façon consciencieuse. Lorsque les employeurs parlent de « mission » du cadre, ils veulent tout simplement lui imposer une obligation de résultat. L’obligation de résultat n’est pas scandaleuse en soi, mais elle pose la question des moyens qui sont donnés. Si les objectifs sont disproportionnés aux moyens alloués, si le cadre est seul face aux fluctuations du marché, ce qu’on lui demande relève de la mission impossible. C'est encore plus net quand les objectifs sont individuels et les moyens collectifs. Les cadres sont alors mis en position de rivalité les uns par rapport aux autres, ce qui ne favorise pas la synergie. Pourtant, une entreprise vivable n’est pas une addition d’individus, le tout est plus que la somme des parties.
Le lien de subordination est aussi un lien social, l’entreprise est un lieu de socialisation. C’est dans l’entreprise que les salariés en général et les cadres en particulier construisent une grande part de leur identité sociale. Ce n’est pas pour autant que la totalité de l’identité sociale doive dépendre de l’entreprise : la citoyenneté, la famille, l’appartenance à des groupes divers, qu’il s’agisse du club de sport ou de l’association des parents d’élèves, sont au moins aussi importants que l’appartenance à l’entreprise.
Prends garde à la longueur des jours
Les accords qui s’occupent spécifiquement des cadres leur donnent le plus souvent des jours entiers de récupération. L’UCC a suffisamment souligné l’intérêt de ce genre de calcul (« 200 jours en l’an 2000 ») pour que l’on puisse nous croire si nous disons : attention, comme toute bonne mesure, elle peut avoir des effets pervers. Deux choses sont à prendre en considération : la longueur des jours travaillés et le statut des jours qui ne le sont pas.
Si leur charge de travail reste la même, il y a de fortes chances que les cadres essaient de faire tenir le même temps global dans un moindre nombre de jours, le nombre d'heures annuelles étant constant. L’actuelle durée légale du travail, c’est environ 1750 heures par an, celle de demain, ce sera 1600 heures. Quand nous parlons de « deux cents jours en l’an 2000 », il ne s'agit pas de jours indéfiniment extensibles.
Pour l'entreprise, la question sera économiquement différente si le cadre est classé dans les frais généraux ou si son temps est facturé au client.
Il faut aussi s’interroger sur le statut des jours non travaillés du fait de la réduction du temps de travail sous forme de jours entiers. Il y a un vrai risque que ces jours ne soient pas pris dans les faits, soit qu’ils soient perdus pour le salarié, soit qu’ils soient repoussés éternellement pour être transformés en indemnités lors du départ ou en préretraite de fait. Cette dernière hypothèse n’est pas créatrice d’emploi, et ne fait qu’aggraver la situation bien particulière de la France qui a un faible taux d’activité des plus de cinquante-cinq ans.
Ils peuvent aussi prendre la forme de périodes sabbatiques, de plusieurs semaines à quelques mois, permettant la réalisation de projets personnels irréalisables en temps « normal » : apprendre le grec à Ithaque, parcourir l'Inde en camping-car, écrire un roman...
Et si ces jours sont pris dans l'année, reste une question : sont-ce des vacances supplémentaires (avec vraisemblablement en conséquence une imprégnation beaucoup plus grande du temps industriel et commercial par le temps scolaire) ou sont-ce des temps de « respiration » plus brefs à éparpiller par petits paquets (pour aller à un festival de cinéma ou un cours d’art floral, voire pour des activités associatives) ? Nous ne disons pas qu’il y a une bonne et une mauvaise solution, nous pensons simplement que l’organisation du travail dans l’entreprise et les embauches ne seront pas de même nature dans l’un ou l’autre cas. A étudier...