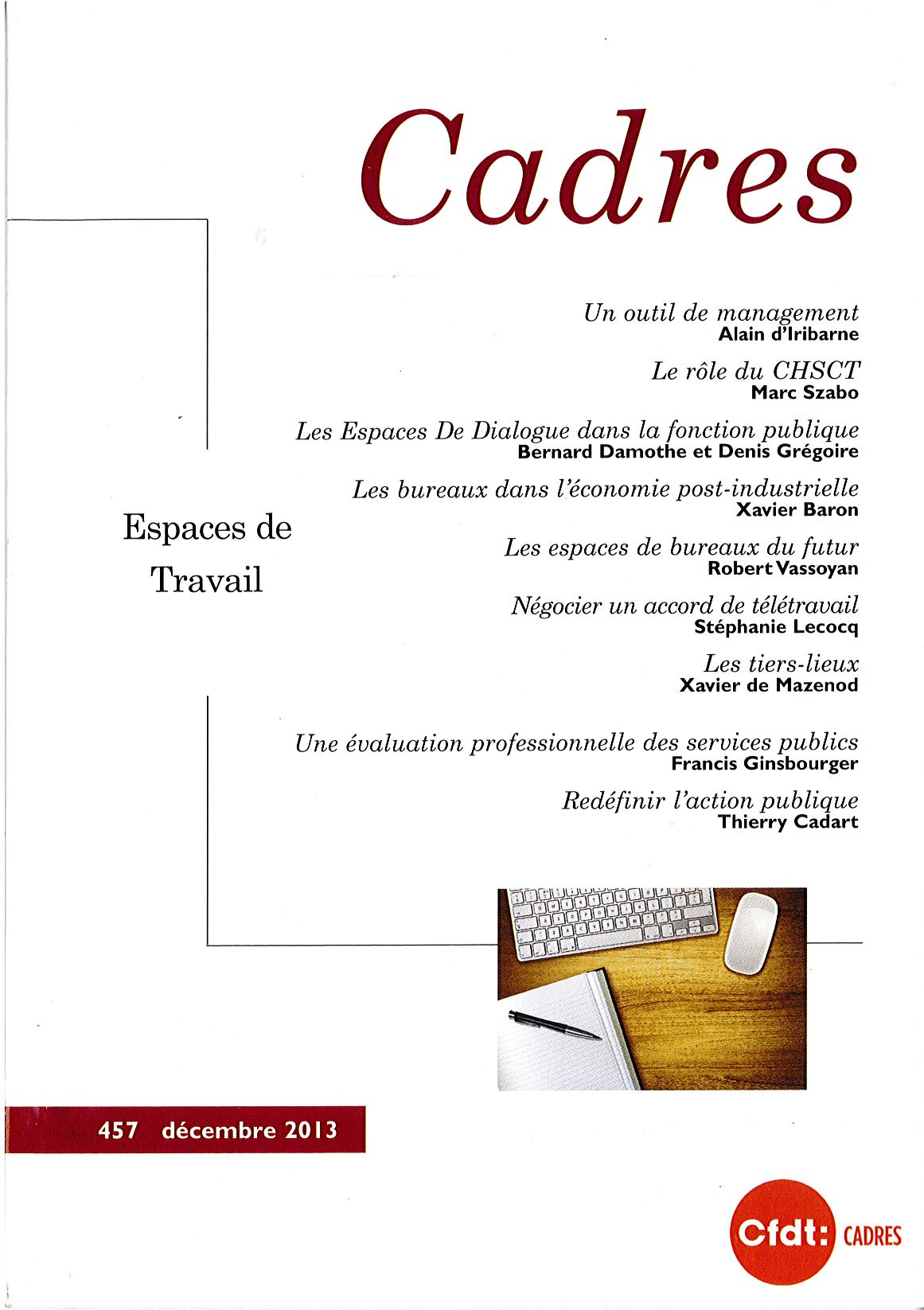La mutation numérique, ses conséquences socio-syndicales
Il relève de la conversation de café du commerce de se lamenter quant à la montée des individualismes et la perte, ou au mieux l’effritement, des solidarités entre salariés. Nous pouvons regarder ce phénomène à la lumière d’une évolution essentielle : la dématérialisation des tâches.
Quand je les interroge, mes plus anciens collègues racontent comment autrefois l’entreprise vendait, étudiait, développait, fabriquait, installait et assurait le service après-vente d’équipements électroniques. Les solidarités ouvrières y étaient bien plus fortes qu’aujourd’hui, où nous avons évolué vers plus de maîtrise d’œuvre et donc de sous-traitance, pour livrer des matériels où la part d’informatique (le software) prédomine.
Le management, confronté à des échecs technico-industriels, a parfois identifié l’absence d’esprit de coopération comme cause des déboires constatés. Avec les solidarités ont disparu aussi les aptitudes à « bien » travailler ensemble.
Pour reconstituer « l’esprit d’équipe », sont apparues des tentatives - parfois sympathiques, le plus souvent empruntes d’une attitude de technocrate, voire pathétiques - de replâtrage. Ce sont par exemple, les objectifs collectifs, censés susciter une forme de coopération ou éveiller un intérêt commun, ou encore la programmation d’événements de convivialité – journées portes ouvertes, repas de service, petits déjeuners périodiques, moments festifs de début d’année - comme si la spontanéité dans les comportements se décrétait, à l’image des casual friday anglo-saxons.
Nous en apprenons beaucoup du récit des anciens venus de divers horizons industriels sur l’origine des solidarités ouvrières : « Tu sais quand j’étais posté, pour aller p…, il fallait bien que mon collègue accomplisse les deux boulots simultanément, sinon on plantait tout ! »
Dans un laboratoire, un atelier, sur une chaîne de montage, le processus technico-industriel et la limitation des moyens imposaient une coopération entre les acteurs, aussi bien pour rendre le quotidien supportable (la réponse aux « appels de la nature ») que pour l’accomplissement d’une opération. Quand un atelier d’électronique ne possédait qu’un seul oscilloscope à 10 Mégahertz de bande passante, il devenait impératif de dialoguer avec ses collègues, de créer un lien (social) pour organiser le partage « rationnel » de l’outil. La matérialité de l’entreprise et de son activité a permis ou favorisé à l’époque le développement de certaines solidarités.
Bien que le salariat, a fortiori le prolétariat, ne pouvait prétendre à la propriété de l’entreprise au sens juridique et financier : c’est-à-dire la détention du capital, donc de ses titres, il y avait appropriation, voire colonisation « par l’usage » de l’appareil productif par les salariés1 eux-mêmes. Probablement cette phase de l’histoire commune a-t-elle pesé dans la conscience du rapport de force.
De nos jours, donner rendez-vous à un collègue développeur en informatique et quitter simultanément l’open space situé dans le quartier de la Défense à l’heure du déjeuner pour aller jouer au tennis crée du lien. Il n’est pas toutefois de même nature que le partage de la souffrance à soulever à deux des poutres métalliques sur un chantier. Le premièr suppose une affinité élective primordiale, le deuxième l’engendre, parfois à l’insu des protagonistes.
Le numérique, un autre rapport à l’objet
Du point de vue technologique, deux éléments marquent notre époque : la facilité technique et la qualité de reproduction d’un support matériel d’information. Un équipement grand public rudimentaire suffit à obtenir immédiatement une copie quasi-parfaite d’un CD-Rom de musique enregistrée, là où trois décennies auparavant il fallait quarante-cinq minutes pour transférer un disque microsillon vinyle sur une cassette audio avec une évidente dégradation du rapport signal à bruit de l’enregistrement. Grâce à la numérisation, un fichier image se démultiplie à l’infini sans aucune perte d’information. C’est bien ce que nous faisons quand figurant dans la liste de destinataires d’un e-mail avec pièces jointes, nous transférons à notre tour ; alors qu’un processus de photocopie dégraderait notablement la qualité obtenue.
Aujourd’hui la copie devient quasiment un original2 à son tour.
Ce dernier point revêt une importance cruciale dans l’analyse de la valeur de l’activité identifiée sous le nom de « production logicielle ». En tant qu’objet de production, le logiciel ne relève que de la pure prestation intellectuelle. Lorsque le « développeur » a achevé son code source, le « produit » qui en résulte peut se dupliquer sans aucune perte, et en très grand nombre, à un coût unitaire quasi-nul3 au regard des heures passées à son élaboration.
Ici est identifiée une situation d’économie d’entreprise originale. Les compagnies manufacturières dont la mission était de fabriquer le même produit en grand nombre, avec pour objectif implicite la minimisation du coût unitaire, s’organisaient autour de cette réalité : division du travail, puis automatisation des tâches. La notion de coûts de série avait tout son sens dans la gestion des affaires, son aspiration à les réduire imposait l’organisation de l’entreprise. La part d’investissement, essentiellement en recherche et développement (R & D), consacrée au produit, s’amortissait explicitement sur la série. Tout gain en forme de réduction des coûts de matières (premières) et de transformation représentait un enjeu fondamental.
Dans le cas du logiciel, très souvent commercialisé par simple téléchargement, seuls les coûts de création initiale compteront, le coût marginal, lié à l’édition d’une copie supplémentaire, pouvant être considéré comme nul.
Certaines entreprises avaient justifié le recours à une sous-traitance de production en déclarant : « Notre cœur de métier s’établit autour de la R & D, nous conservons le prototypage, la réalisation du premier de série. D’autres acteurs industriels ont largement plus investi que nous en moyens de fabrication de masse, ils réalisent à des coûts bien inférieurs, d’où leur compétitivité. »
Le problème à résoudre du fait de la généralisation de la sous-traitance devenait celui de la spécification, et du contrôle : comment passer commande à un fournisseur de mécanique, d’électronique en étant sûr de recevoir un produit conforme aux attentes ? Commander des pièces mécaniques à un centre d’usinage suppose un dossier de fabrication contenant des informations sans équivoque sur les matériaux employés, la géométrie, les tolérances, éventuellement le process. Néanmoins, un seul dossier, voire même un simple schéma suffit à formuler avec la précision requise la pièce à approvisionner, parfois à des milliers d’exemplaires.
En ce qui concerne le logiciel, la prescription se révèle d’un autre niveau d’exigences.
La perfection numérique source de difficultés spécifiques dans la sous-traitance
L’infinie reproductibilité évoquée plus haut s’avère consubstantielle au caractère numérique des objets informatiques. Les possibilités uniques pour un bit de prendre la valeur 0 ou 1 éliminent toute équivoque dans la reproduction. Là où un objet « analogique » se définit avec une tolérance -de la valeur d’un composant électronique, d’une dimension d’une pièce mécanique-, un logiciel, se traduisant par un fichier informatique, se révèle in fine n’être qu’une suite concaténée de 0 et de 14.
L’expérience quotidienne nous apprend qu’un système mécanique dont les pièces sont de mauvaise qualité peut quand même accomplir la tâche, ou rendre le service pour lequel il a été élaboré. Quiconque s’est confronté à la programmation a au moins une fois rencontré un bug, où une simple erreur dans un nom de variable a bloqué le flot des opérations, et fournit un résultat absurde.
Cette donnée fondamentale distingue définitivement la spécification des sous-traitances matérielle et logicielle, où la précision requise nécessitera un travail aussi conséquent, si ce n’est plus, que le codage et le développement eux-mêmes.
L’évolution des propriétés intellectuelle et industrielle
La génération née après la création d’internet, et qui a toujours connu la copie numérique, n’a probablement pas développé le même rapport à la propriété et la création intellectuelle ou artistique que les précédentes : pourquoi acheter un disque de musique, un DVD de cinéma, un livre, alors que sa copie est gratuite ? Pourquoi apprendre par cœur des vers de Racine, la liste des départements français, le tableau de Mendeliev, puisque Wikipédia nous les fournit en quelques clics ? Cette nouvelle forme d’abondance, cette absence de rareté de l’objet, ritualisée dans la phrase « Tu me mets une copie sur cette clé… » rendent difficilement compréhensible le discours désormais ancien sur le partage des biens, et les négociations évoquées ci-dessus qui pouvaient exister à l’intérieur du collectif de travail.
Des évolutions des entreprises difficilement prévisibles
Dans ces conditions, l’émergence de l’esprit de coopération est devenue nettement contingente. Répétons-le, cela n’ira pas sans conséquence sur la conduite des projets et affaires, et le management sera parfois lui-même nostalgique des solidarités ouvrières, qui étaient certes fondement d’un rapport de force avec l’employeur, mais qui produisaient aussi de la fluidité dans le processus de production, une capacité de mobilisation collective dont une équipe dirigeante intelligente pouvait tirer profit pour l’entreprise. Décrire les collectifs de jeunes travailleurs comme des demi-autistes (« la génération Y ») relève éminemment du cliché, plutôt discriminatoire et méprisant. Néanmoins, la généralisation de la simulation, de la modélisation, de ce que l’on désigne parfois sous le terme générique de « virtuel », comme objet primordial de travail, induira inévitablement des comportements et des trajectoires inattendus : le clivage avec la réalité matérielle5 ou au contraire la confusion possible entre l’objet et sa représentation est plus que possible.
Avec la crise dite des subprimes, nous avons observé le clivage entre finance et économie réelle et ses conséquences dramatiques telles que la création et l’explosion de bulles financières. La multiplication de « l’image », le développement incessant des représentations (le simulé, le modélisé, le virtuel) conduiront-ils à des effets catastrophiques du même type ? Ce n’est malheureusement pas tout à fait impossible dans la mesure où risque de se développer apparemment un monde sans rapport direct avec la réalité.
1 : La célèbre chanson « Rien n’est à eux, tout est à nous » que l’on entend encore dans certains cortèges syndicaux en fin de manifestation, illustre parfaitement cet état d’esprit.
2 : Dans ces conditions, la distinction entre original et copie s’efface. Des notions telles que la rareté s’avèrent remises en cause.
3 : Au pire : celui de l’inscription sur un support matériel… qui se réduit à néant en cas « d’acquisition » par simple téléchargement. Cependant, cette analyse évite la discussion sur les coûts associés aux investissements et maintien des infrastructures comme les serveurs, rapidement réduits au statut d’externalités.
4 : En informatique s’applique systématiquement le proverbe suivant : « Un seul bit vous manque et rien n’est compilé. » Comme déjà souligné, le langage informatique ne véhicule aucune équivoque, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, contrairement à la langue parlée ou écrite, les effets de la métaphore et de la métonymie lui sont étrangers.
5 : Sur un autre registre, le problème se pose de façon similaire pour les pilotes de drones de l’US Air Force : ils passent leur temps derrière un écran, en un lieu parfaitement sécurisé, tout en jouissant d’une forme de toute puissance, et d’où ils ne peuvent apprécier directement les conséquences dramatiques infligées aux populations attaquées. Dit autrement : les drones d’attaque sont de très bonne armes pour gagner la guerre… sûrement pas pour gagner la paix !