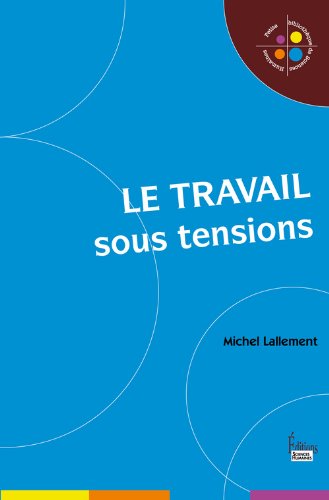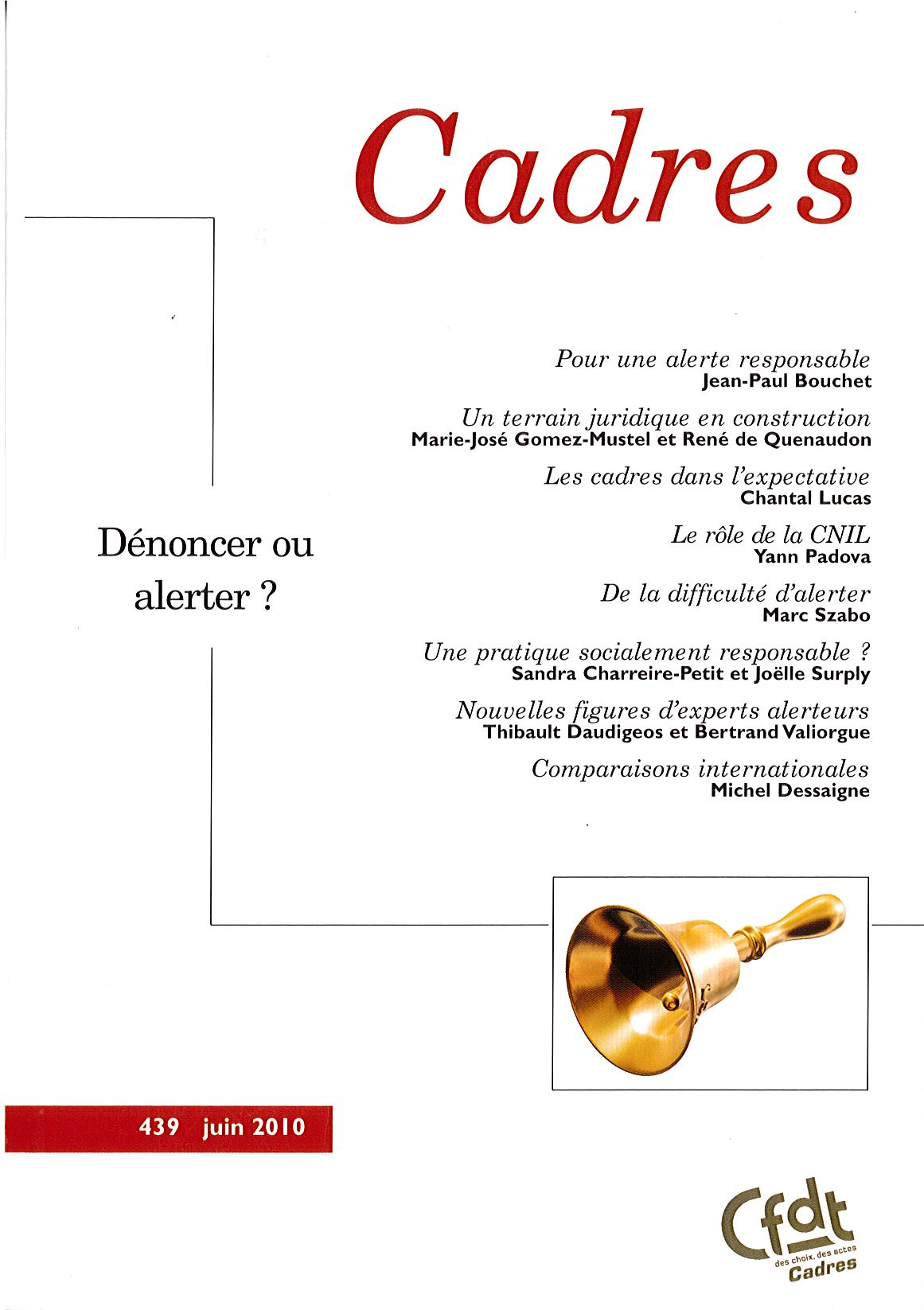Salariat et organisation du travail : vous voulez réviser vos classiques ? A l’heure du débat sur le rôle des institutions représentatives du personnel et de la réforme de la représentativité syndicale, la concision du dernier ouvrage de Michel Lallement offre un panorama utile des tensions contemporaines. Présentant le travail comme un « bien commun », son petit ouvrage se lit comme un outil d’action faisant le point sur le principal terrain de jeu des partenaires sociaux.
L’une des principales évolutions concerne la multiplication des acteurs : on savait que les clients et les actionnaires étaient devenus dominants, mais il convient d’ajouter les sous-traitants et les fournisseurs, la panoplie de lobbies patronaux, les mouvements de consommateurs et consultants en tous genres, qui relativisent ainsi les organisations syndicales. Le monde du travail a vu ces dernières années se démultiplier le nombre de parties prenantes, auxquelles se sont ajoutées des contradictions temporelles (court terme contre investissement) et géographiques (la proximité et le global). Sur cette dérégulation de l’organisation sociale traditionnelle – pour ne pas s’étendre sur la crise de la démocratie sociale –, fleurissent de nouvelles formes de confrontations, à la fois plus éclatées ou enfermées dans un formalisme, mais également une montée en puissance de la dimension purement juridique du règlement des conflits.
Dans l’entreprise, les réseaux ont rationnalisé le travail. Automatisation, applications partagées et gestion optimisées à distance ont permis l’émergence d’une dualité profonde entre donneurs d’ordre et production externalisée. Derrière ces fortes dépendances et convergences, M. Lallement rappelle la grande pluralité des mondes du travail. En termes de secteurs d’activités et de conditions de travail, rien ne rapproche les sphères du commerce, des services à la personne ou de l’hôtellerie-restauration par exemple, avec les secteurs énergétiques, les activités financières ou les postes-télécoms. Les administrations et secteurs publics sont eux aussi au cœur de mutations, entre logiques bureaucratiques classiques et modèle de la compétence technique. Ces tensions révèlent « un véritable désarroi des fonctionnaires qui vivent la modernisation comme une perte de sens radicale de leurs activités ». Le privé comme le public admet plusieurs formes d’organisations : des organisations apprenantes (tâches complexes et peu répétitives) au lean production (rotation des tâches), en passant par des formes classiques, tayloriennes (répétition des tâches) ou de structure simple (faible contenu cognitif).
Puis, s’approchant des réalités changeantes du salariat - dont on sait que les cadres semblent en être la figure de proue -, l’auteur dresse une synthèse des tensions. Développement du travail par projet, accroissement sans cesse de la polyvalence et de la réactivité : tout est bon pour dépasser le taylorisme. Avec au cœur une tendance de fond : « les salariés bénéficient de plus d’autonomie dans leur travail et, dans le même temps, les contraintes auxquelles ils sont soumis se sont alourdies ». En forçant le trait, « les évolutions depuis les années 80 tendent à transformer chaque salarié en entrepreneur, individuellement responsable des missions qui lui sont confiées ». L’individu prend de plus en plus sur lui (« enrôlement de la personnalité ») et gère les contradictions des demandes. La charge mentale ne cesse de progresser et les frontières du travail croisent celle de la vie privée. La pression s’accroît et le temps est moins de moins mesurable. La moitié des salariés affirme que ses heures de travail ne sont pas contrôlées.
C’est dans ce contexte qu’apparaissent alors les liens entre pathologies et univers organisationnels, mais aussi entre injonctions contradictoires et le besoin d’équiper le travailleur pour prendre soin de son « pouvoir d’agir ». Ce qui, entre parenthèses, forme une adresse bien exigeante à l’égard de ses représentants… Voilà le travail « sous domination » de la finance comme des réorganisations permanentes dont l’objectif majeur est la réalisation d’économies d’échelle. Les logiques de performances à court terme étant ravageuses pour les entreprises et donc pour le travail. Ce que renforce la crise récente « venue sanctionner l’autisme actionnarial et l’auto-valorisation de la finance au détriment de l’économie réelle ».
Les conséquences d’une telle forme de gestion sont la contradiction entre le travail et l’emploi, alors qu’on ne peut séparer la force de travail et les compétences de celui ou celle qui les porte. Une tension majeure à l’origine de la vision quantitative du travail qui, schématiquement, satisfait employeurs et politiques publiques. M. Lallement rappelle la nécessité de « marquer nettement la différence entre le travail en tant que pratique et l’emploi en tant que statut » et ouvre son constat engagé sur l’inspiration d’André Gorz fustigeant « la lutte contre le chômage à tout prix ayant pour contrepartie la dégradation du travail au rang d’activité de serviteur ». Des tensions du travail à l’action syndicale passent ainsi l’émancipation des salariés et la valorisation de leurs compétences. Tout un programme syndical.