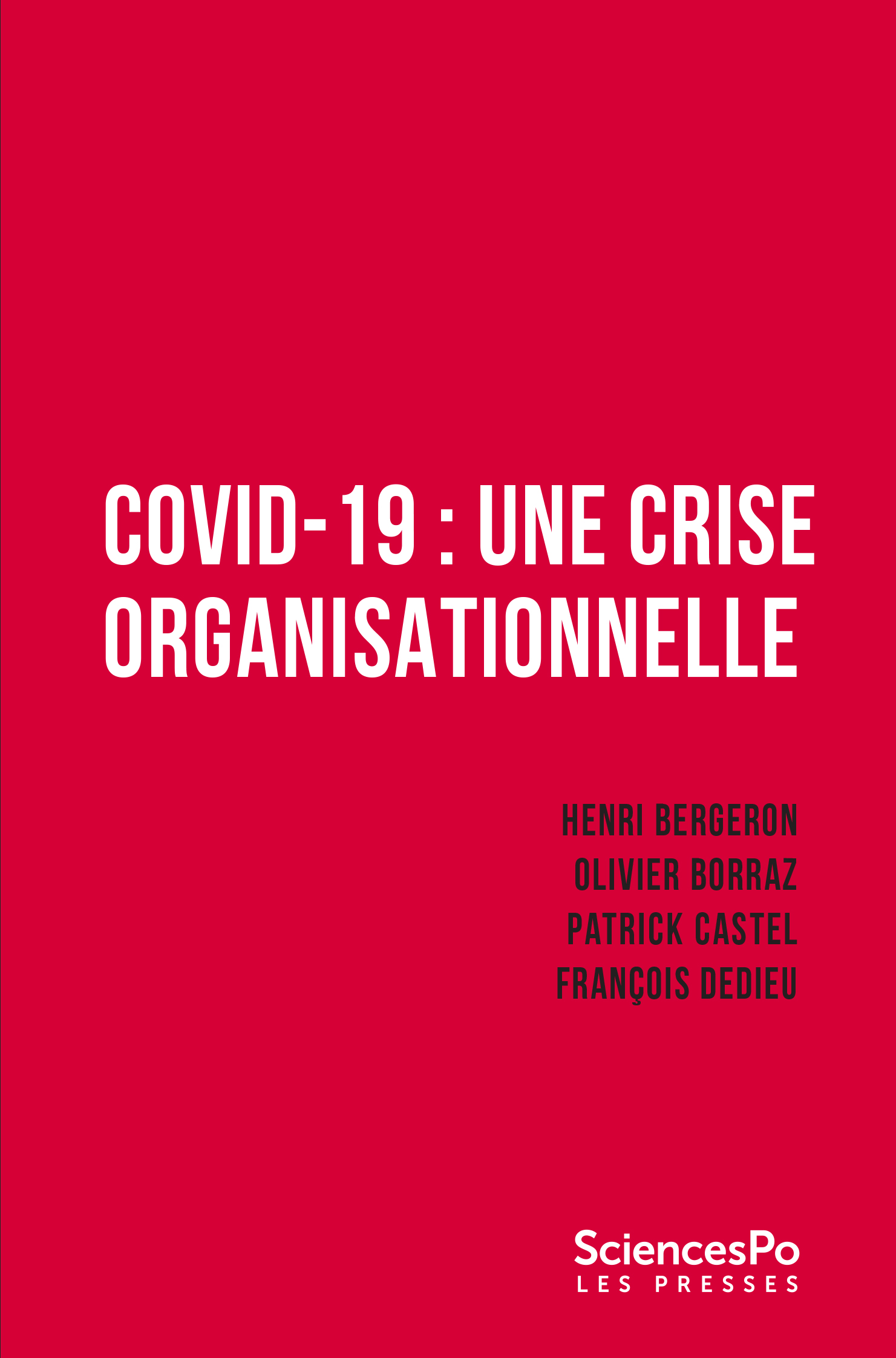Comment être amené à qualifier les confinements de décision rationnelle ?
Olivier Borraz. Le Centre de sociologie des organisations, fondé par Michel Crozier autour d’un programme de recherche consacré à l’administration française, est un laboratoire de recherche qui dépend de Sciences Po et du CNRS avec des domaines d’investigation larges. Concernant la crise sanitaire, nous avons enquêté à chaud auprès d'acteurs publics, politiques et de santé, afin d’explorer les conditions de leurs prises de décisions. Les mauvaises leçons tirées du passé dans le domaine de la santé publique, mais aussi un sentiment de sécurité excessif, ou encore une confiance aveugle dans les outils de planification de gestion de crise ont amené à décider d’un confinement total. Une première historique.
C’est notre rôle d’apporter à l’actualité un regard scientifique en parallèle et en complément avec des projets de recherche de long terme. Nous ne sommes pas les seuls à nous préoccuper de gestion publique à vif ; citons par exemple le rapport du général Lizurey, chargé au printemps dernier par Matignon de réaliser un audit sur le pilotage de la crise. Celui-ci pointe notamment l’excessive centralisation des décisions et le manque d’articulation entre l’État et les collectivités territoriales.
Ce qui nous a frappés avec la décision de confinement, outre qu’elle n’avait jamais été prévue dans aucun plan, c’est qu’elle a été présentée comme « la seule solution possible ». Autrement dit, reprenant le modèle de la décision rationnelle, selon laquelle les décisions sont prises en ayant analysé toutes les données disponibles, anticipé les conséquences des différentes options, et en étant capable de peser en amont tous les rapports coûts-bénéfices, cette décision était, sinon inéluctable, du moins la plus rationnelle. Pourtant, nous avons montré, en reprenant les acquis des travaux de Graham Allison – dont le livre Essence of decision (1971) est un classique de modèle d’analyse des décisions, appliqué à la crise des missiles de Cuba en 1962 – que cette décision ne pouvait se comprendre qu’en la resituant dans une série de processus organisationnels et politiques qui, en ayant sous-estimé la gravité de la menace jusqu’au début du mois de mars, en ayant cru également disposer des capacités pour affronter une épidémie, et en ayant cherché à tout prix à préserver un calendrier politique tendu (réforme de retraites puis élections municipales), ont contraint les autorités à décider dans l’urgence, sans disposer loin de là de toutes les informations nécessaires, à commencer par celles relatives aux conséquences de leur décision. A cela il faut ajouter la constitution d’un conseil scientifique qui, n’étant pas tenu par les mêmes contraintes que les organisations sanitaires existantes, a pu imposer au décideur une solution inédite : le confinement. Si les autorités s’étaient appuyées sur les instances sanitaires existantes, il n’est pas certain que cette solution aurait été proposée.
Cette rationalité pousse à la création de comités ad hoc pour contourner les dispositifs existants.
O.B. Le grand public connaît le « conseil scientifique », mais la liste des comités et des cellules créés cette année est impressionnante, alors que le pays ne manque pas de dispositifs de sécurité civile et sanitaire. Une des raisons à cela tient au souci des autorités de ne pas s’appuyer sur les dispositifs existants, de peur qu’ils leur imposent leurs contraintes et solutions toutes faites. Ils préfèrent conserver une certaine liberté dans leurs décisions. C’est ce qui conduit aussi, surtout depuis la rentrée, à un recours fréquent au conseil de défense et de sécurité pour prendre les décisions, dont l’opacité garantit aux autorités une plus grande marge de manœuvre.
Mais M. Crozier avait également identifié un cercle vicieux bureaucratique qui consiste, face à un problème de coordination, à introduire de nouvelles organisations pour le résoudre, avec pour effet d’aggraver au contraire la situation. Nous vivons encore dans ce phénomène bureaucratique : plus la coordination est difficile, plus on entreprend de l’améliorer en introduisant de nouveaux dispositifs (organisationnels ou technologiques), sans chercher d’abord à comprendre ce qui est à l’origine de ces problèmes de coopération. Cet empilement d’organisations au printemps a ainsi contribué à désorganiser la réponse publique.
Ces comités reposent également sur une forme de confusion. Tout en prétendant dissocier la science et le politique, dans les faits les deux sont étroitement entremêlés. Ainsi au départ, le conseil scientifique contribue à imposer la représentation d’une crise qui touche d’abord les hôpitaux et qui nécessite une mesure radicale, le confinement, pour ralentir le virus. Puis l’exécutif entreprend de prendre ses distances pour regagner en autonomie de décision ; tandis que le conseil scientifique soigne son autonomie et se montre de plus en plus critique vis-à-vis des décisions politiques. Ce qui conduit l’exécutif à chercher un soutien ailleurs, avant de se rallier à nouveau cet automne aux avis du conseil scientifique pour décider d’un reconfinement, sur des bases qui associent éléments scientifiques et considérations économiques, sociales et politiques.
C’est une conclusion classique de la sociologie des organisations : l’expression de la libre parole est modulée par le pouvoir. La frontière est ténue entre information auprès des décideurs et formation de leur décision politique… Tandis que ce que le dirigeant gagne ou croît gagner en autonomie de décision, il la perd souvent en capacité de mise en œuvre. Car dans toutes les décisions qui ont été prises, jamais l’exécutif n’a cru bon de consulter ceux qui seraient chargés de leur mise en œuvre ou ceux qui seraient concernés au premier chef. Pourquoi n’écouter que le conseil de quelques scientifiques, ou d’autres instances d’expertise, et si peu les organisations de la société civile mais également les différentes administrations déconcentrées ainsi que les collectivités locales ? Je remarque que l’Etat prend souvent le risque de susciter la contestation de celles et ceux qui n’ont pas été associés aux décisions les concernant. La connaissance du terrain est peu intégrée dans la décision publique.
Vous avez écouté des acteurs du milieu hospitalier comme espace de coopération et d’improvisation professionnelles.
O. B. C’est un secteur où il faut souvent prendre des décisions dans l’urgence. Au printemps dernier, l’exceptionnel esprit de dévouement du personnel de santé et l’éthique de soin ont permis d’atteindre des résultats inespérés dans les hôpitaux, mais ils ne suffisent pas à expliquer les formes inédites de coopération qui nous avons observées.
Tous les témoignages convergent pour pointer l’existence de quatre conditions favorables à l’adaptation à une situation inédite : la suspension des contraintes budgétaires et le soutien au travail, une moindre contrainte hiérarchique sur les médecins, l’absence de compétition entre services pour les « meilleurs patients », et la déprogrammation et la libération des tâches habituelles.
Sans porter de conclusions hâtives sur l’organisation du travail, le regard des sociologues et de la science politique permet de penser, avec détachement, les conditions de la coopération et de son épanouissement. Ne nous contentons plus d’osciller entre les récits de l’ingéniosité d’individus providentiels qui guident l’activité et la simple dénonciation des conflits, replis et corporatismes, entre la recherche de héros et de coupables. Portons notre regard sur les causes structurelles des échecs et réussites fonctionnels.
Ainsi, cette crise peut être l’occasion de réfléchir aux conditions de la coordination sans hiérarchie, pour reprendre l’expression de Donald Chisholm (Université de Berkeley). Celui-ci suggère de privilégier la coordination informelle lorsque des unités interdépendantes rencontrent des problématiques communes plutôt qu'une traditionnelle centralisation du pouvoir. Sa conception de la coopération est celle d'une solution à mettre en œuvre plutôt que d'un problème à résoudre. Contribuons avec cet exemple de l’hôpital à promouvoir l’apprentissage organisationnel…
Quels sont les autres enseignements à tirer de ces premiers mois de crise en termes de gestion publique ?
O.B. Il faut d’abord, selon nous, réfléchir à l’évolution de la préparation à la gestion de la crise, en rompant avec une logique purement procédurale. La France accumule les plans d’actions et les exercices de simulation, qui tendent à proposer une représentation « ordonnée de la crise », très loin du chaos que constitue une crise réelle. Les crises font également trop peu l’objet d’évaluations empiriques. Il faut en finir avec les rapports d’enquête qui cherchent d’abord des responsabilités ou des défaillances, sans porter un regard global sur ce qui a marché comme sur ce qui n’a pas marché, afin d’en tirer des leçons pour le long terme.
Les sciences sociales ont un rôle à jouer pour tirer des leçons qui permettront de mieux préparer les crises à venir. Plutôt que de concevoir la crise actuelle comme un prolongement du fonctionnement ordinaire dans une situation « dégradée », comme cela a été le cas jusqu’ici dans les plans de préparation, il convient de penser des processus organisationnels capables de se recomposer en période de crise, en partant pour cela des exemples très concrets que nous offre la crise actuelle[1].
En somme, l’enjeu est, il me semble, de donner aux élites une culture de la décision en situation d’incertitude, plutôt que de les former à l’anticipation rationnelle. Leur parcours de formation, comme l’environnement professionnel des cabinets ministériels par exemple, ne les prépare pas à penser et agir dans l’incertitude, à analyser les problèmes inédits et complexes. C’est par le pluralisme de leur carrière, de leur recrutement, de leurs compétences que l’on peut progresser. En position de décideurs, il faut qu’ils interagissent davantage avec le monde scientifique et universitaire qui apporte le doute et les interrogations, ainsi qu’avec les acteurs de la société concernés par les mesures prises.
Les futures élites ne bénéficient d’aucune formation en sciences sociales pour les aider à comprendre les dimensions organisationnelles de la société. On continue de privilégier des approches inscrites dans des savoirs stables et des éléments fixes. Nous proposons une approche pédagogique articulée en quatre ambitions : concevoir une critique des savoirs enseignés, placer l’investigation et le raisonnement scientifique au cœur de la pédagogie, pratiquer l’enquête qui demande du temps, développer l’alternance entre l’immersion et les périodes de prises de recul. Il faut former les élites, les décideurs à comprendre les problèmes autant qu’à leur apprendre à les résoudre à tout prix. L’Etat entretient son élite dans une certaine conception de l’ordre public, celle du sachant qui sait protéger et prévoir ; mais gare à susciter des attentes qu’il n’est pas en mesure de satisfaire, au risque de créer de la défiance et d’alimenter l’incertitude et l’inquiétude sociale.
Propos recueillis par Laurent Tertrais
[1] Cf. O. Borraz, « Qu’est-ce qu’une crise ? », 20 avril 2020.