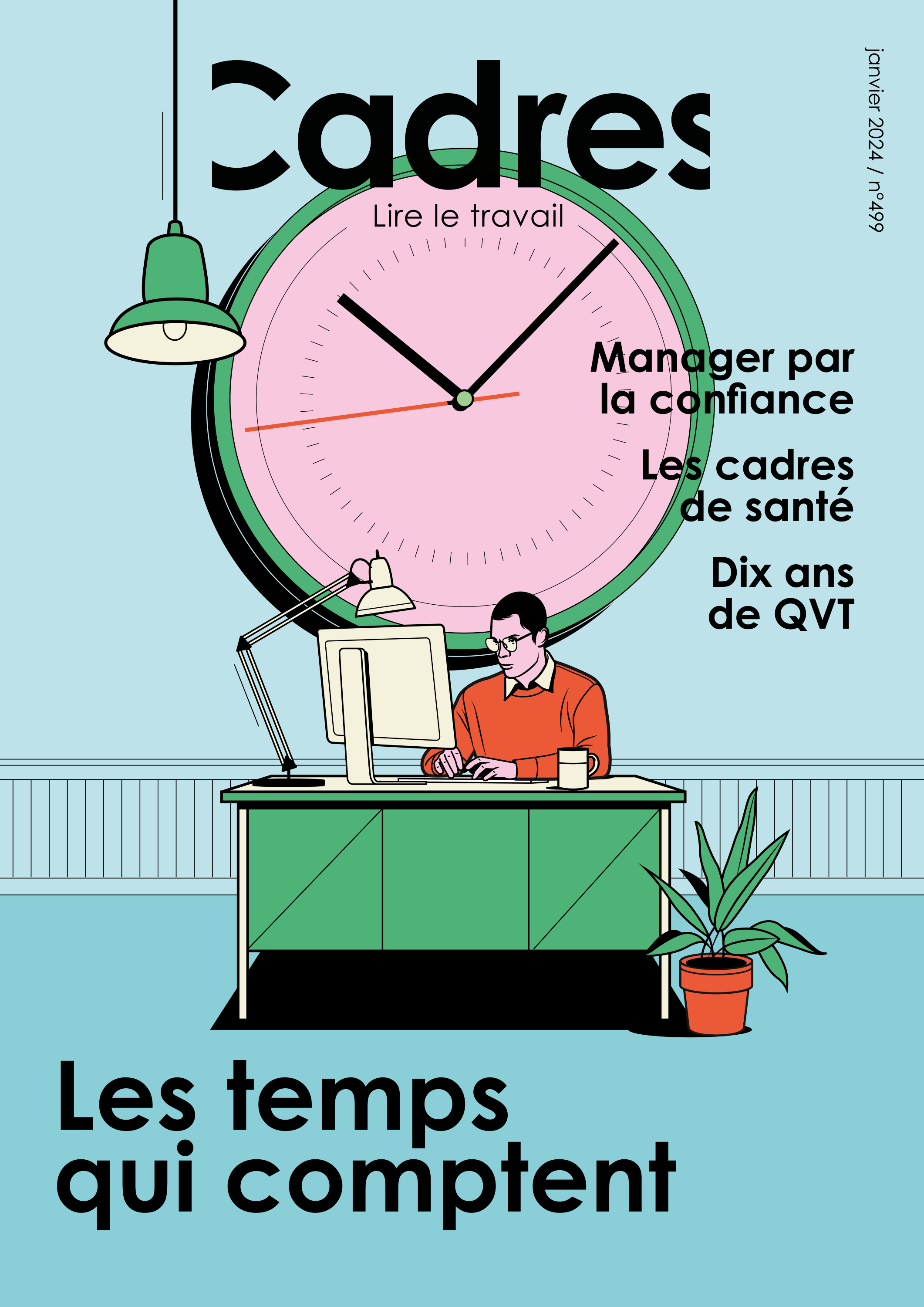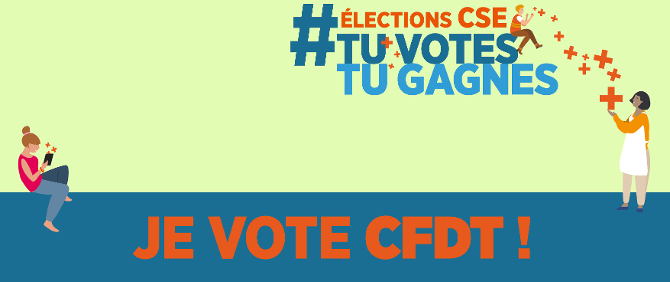Quels sont à votre avis les conditions pour que le télétravail puisse être durable, c’est-à-dire pérennisé dans des conditions qui bénéficient au plus grand nombre ?
Suzy Canivenc. Le télétravail est et sera un phénomène durable. Il était largement demandé par les travailleurs avant la pandémie, il a été expérimenté à large échelle pendant les confinements et, malgré des conditions d’expérimentation dégradées, il est encore aujourd’hui réclamé par les travailleurs : huit salariés sur dix déclarent vouloir un mode de travail hybride, en travaillant 1 à 3 jours par semaine depuis le domicile[1], et 38 % seraient prêts à démissionner si on leur imposait un retour sur site total[2]. Le télétravail ressort donc clairement comme une demande sociale. De plus, les employeurs semblent aussi y avoir découvert des vertus insoupçonnées, eux qui auparavant l’assimilaient davantage à la « télé » qu’au travail. Toutefois, une autre question est de savoir comment pérenniser un télétravail durable au sens de responsable. Sur ce point, le télétravail « sanitaire » nous aura permis d’y voir plus clair.
Pour être générateur de qualité de vie au travail autant que de performance, le télétravail doit être choisi et intermittent, deux conditions qui n’étaient clairement pas au rendez-vous pendant la crise sanitaire. « Choisi » veut dire qu’il répond à un double volontariat (de l’employeur comme de l’employé). « Intermittent » renvoie à l’idée que le travail optimal n’est ni à 100 % sur site, ni à 100 % à distance. C’est la fameuse courbe en cloche ou en U inversé issue des travaux de l’OCDE et reprise par la Banque de France. L’efficience des travailleurs augmente à la faveur d’une certaine intensité de télétravail mais diminue lorsque celui-ci devient excessif. Il y aurait donc une zone idéale où le niveau de télét