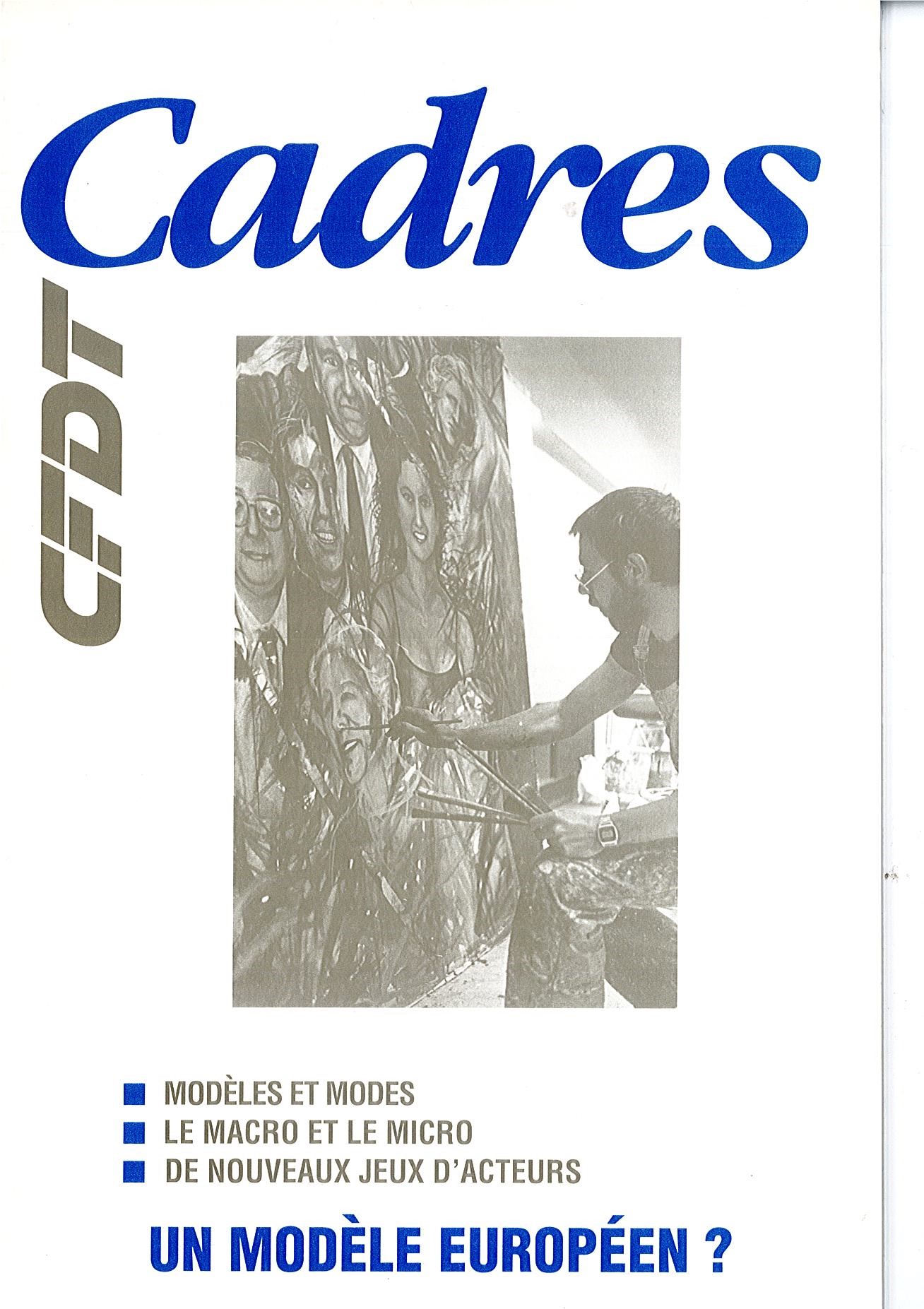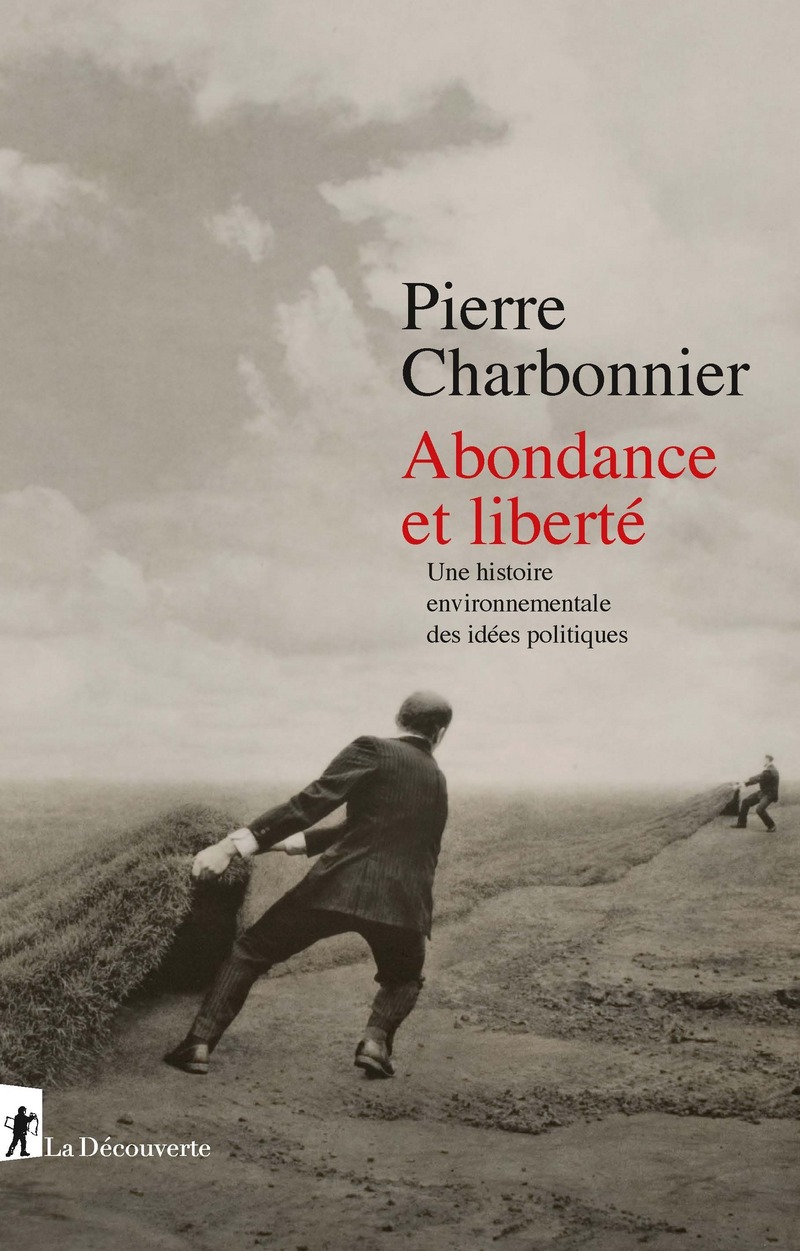Le modèle social europĂŠen existe-t-il autrement que sous forme dâune incantation dĂŠfensive ? La rĂŠponse est dĂŠbattue, mais il paraĂŽt clair quâune rĂŠalitĂŠ sociale europĂŠenne existe, diffĂŠrente du modèle que la globalisation, projet politique, veut nous imposer sous peine de dĂŠclin et de stagnation.
Quels sont les enjeux du modèle social europĂŠen ? A quoi correspond le modèle du libĂŠralisme intĂŠgral globalisĂŠ ? La mondialisation offre-t-elle dâautres alternatives ? En quoi consiste le modèle social europĂŠen ? Comment monter une stratĂŠgie de solidaritĂŠ ? Câest Ă de telles questions que nous allons tenter dâapporter quelques ĂŠlĂŠments de rĂŠponse.
Les enjeux du modèle social europÊen
Au cours dâune rĂŠunion qui se tenait Ă Luxembourg en novembre 1996, traitant des ÂŤ scĂŠnarios europĂŠens dix ans après lâEuro Âť, un financier anglais qui participait interrompit un dĂŠbat sur lâadaptation du welfare state (Etat protecteur) aux contraintes de la mondialisation en disant ÂŤ Vous me faites penser Ă Gorbatchev quand il tentait de rĂŠformer le communisme. Le welfare state europĂŠen nâest pas plus rĂŠformable que le communisme. Vous viendrez au système anglo-saxon, tĂ´t ou tard Âť.
Cette conviction est aujourdâhui ancrĂŠe comme une vĂŠritĂŠ ĂŠtablie dans les milieux internationaux dominants. Toutes les organisations internationales, toutes les ĂŠtudes officielles morigènent les EuropĂŠens attardĂŠs qui se crispent sur la dĂŠfense sans issue dâune organisation sociale responsable de leurs difficultĂŠs, alors que les brillants succès ĂŠconomiques du reste du monde, et particulièrement des USA, dĂŠmontrent que la voie unique du nouvel ordre mondial est la seule praticable.
Cette franchise a le mĂŠrite de bien placer lâenjeu. Le compromis social-dĂŠmocrate europĂŠen sâest traduit par lâĂŠmergence de versions, Ă doses plus ou moins conventionnelles ou ĂŠtatiques, dâun système de protection sociale solidaire Ă vocation exhaustive. Utilisant les mĂŠthodes et les rĂŠgulations de la dĂŠmocratie sociale, qui font son originalitĂŠ, il a bien fonctionnĂŠ dans un monde industriel de politiques ĂŠconomiques keynĂŠsiennes, de commerce transatlantique administrĂŠ, dâhĂŠgĂŠmonie occidentale et de compĂŠtition avec le contre-modèle soviĂŠtique.
Aujourdâhui lâUnion europĂŠenne doit faire face Ă une globalisation qui se centre sur lâAsie, Ă lâhĂŠgĂŠmonie non contestĂŠe des USA ainsi quâĂ un marchĂŠ financier mondialisĂŠ qui interdit les politiques ÂŤ dĂŠviantes Âť. En outre le modèle productif est pris dans la troisième rĂŠvolution industrielle, celle de lâĂŠlectronique et des communications, qui reconfigure ses schĂŠmas techniques de production, ses stratĂŠgies et lâemploi.
Une question critique se pose aujourdâhui Ă lâEurope et Ă la France en particulier : comment assurer la mobilisation des ressources pour garder une place gagnante en conservant, et mĂŞme en valorisant, ses valeurs sociales et plus prĂŠcisĂŠment sa protection sociale ? Nous sentons bien, intuitivement, quâune utilisation purement dĂŠfensive du modèle social europĂŠen est vouĂŠe Ă lâĂŠchec.
La grande rĂŠgression
En dĂŠcembre 1996 Ă lâoccasion dâune rĂŠunion Ă Londres consacrĂŠe aux systèmes de retraite du conseil franco-britannique, Franck Field, prĂŠsident de la commission de la sĂŠcuritĂŠ sociale de la Chambre des Communes, prĂŠcisa directement sa façon de voir : ÂŤ Un chĂ´meur, cela nâexiste pas, il nây a que des gens qui refusent de travailler pour le prix que lâon veut bien attribuer Ă leur travail. La sociĂŠtĂŠ nâest pas un train collectif pour aller vers lâavenir. Câest individuellement que lâon y va. La solidaritĂŠ entre gĂŠnĂŠrations est une ressource trop rare pour quâon la mette Ă contribution pour la retraite. Câest Ă chacun de financer celle-ci par une ĂŠpargne suffisante qui est de sa responsabilitĂŠ. Bien sĂťr 20 ou 30 % de la population nâaura pas les revenus ou la vertu de prĂŠvoyance nĂŠcessaires. Alors les plus riches pourront payer pour les pauvres mais Ă condition quâils approuvent la façon dont ceux-ci se comportent Âť.
Ce discours introduit bien le modèle de protection sociale prĂŠconisĂŠ aujourdâhui par les organisations internationales (Banque Mondiale, OCDE) : la rĂŠduction du salaire Ă un ÂŤ prix Âť commercial du travail fixĂŠ sur un marchĂŠ libre, la rĂŠduction des dispositifs collectifs Ă un ÂŤ filet de sĂŠcuritĂŠ Âť, forfaitaire, très rĂŠduit et sous conditions de ressources, et lâessentiel de la prĂŠvoyance (invaliditĂŠ, santĂŠ, retraite) relevant de la dĂŠmarche individuelle, plus ou moins aidĂŠe fiscalement. En France, la promotion de cette conception se manifeste notamment par la volontĂŠ de sĂŠparer ÂŤ lâassistance Âť de ÂŤ lâassurance Âť.
Un modèle de ce type peut reprĂŠsenter un progrès pour des pays en voie de dĂŠveloppement et sans protection sociale. Pour les pays europĂŠens dâaujourdâhui, il reprĂŠsente une rĂŠgression. Celle-ci sâĂŠclaire par deux conceptions diffĂŠrentes de la sociĂŠtĂŠ et de lâhomme 1. Dâun cĂ´tĂŠ la sociĂŠtĂŠ amĂŠricaine, reprenant le flambeau du libĂŠralisme, met lâaccent sur la responsabilitĂŠ des pauvres eux-mĂŞmes. Il y aurait quelques ÂŤ pauvres vertueux Âť, quâil faut aider par compassion et les ÂŤ mauvais pauvres Âť, responsables de ce qui leur arrive. De lâautre cĂ´tĂŠ la sociĂŠtĂŠ française, par exemple, dans la tradition Durkheim, met lâaccent sur lâinterprĂŠtation sociale de la pauvretĂŠ et sur ses causes structurelles, sanctionnĂŠes par lâexclusion et ses consĂŠquences.
Les EuropĂŠens ÂŤ continentaux Âť considèrent quâils ont dĂŠpassĂŠ lâĂŠpoque oĂš la pauvretĂŠ, comme la maladie et les autres malheurs, reprĂŠsentait la punition de nos fautes, de celles de nos parents ou de notre race ! Au contraire les Anglo-saxons ne comprennent pas que nous considĂŠrions ÂŤ lâenrichissement comme une mesure douteuse du succès Âť 2, câest-Ă -dire du ÂŤ mĂŠrite Âť. En fait, le mauvais sort des pauvres et des perdants (leur ÂŤ sacrifice Âť dirait RenĂŠ Girard) donne du prix et du plaisir Ă la richesse et au pouvoir. La sociĂŠtĂŠ est une haute falaise escarpĂŠe oĂš chacun aspire Ă monter en enviant la place des gagnants, et non en aspirant Ă adoucir ses ĂŠcueils pour que tous puissent gagner ensemble. Il nây a pas de pauvres ou de chĂ´meurs, il nây a que de mauvais perdants ! Cette conception se complète dâune vue ÂŤ diabolique Âť, extĂŠrieure, manichĂŠenne du ÂŤ mal Âť et du postulat que le mĂŠrite seul, au sens moral, permet de gagner au jeu social.
Lâutilitarisme consumĂŠriste, qui vise Ă remplacer le citoyen par le consommateur, alimente comme philosophie sociale et politique ce risque de grande rĂŠgression. Celle-ci peut se reprĂŠsenter sur un schĂŠma simplifiĂŠ des positions et stratĂŠgies sociales (voir grilles 1, 2 et 3).
Les grilles 1 et 2 reprĂŠsentent, par positionnement sur les deux axes de rĂŠfĂŠrence de la ÂŤ rĂŠussite sociale Âť (ÂŤ domination-pouvoir Âť et ÂŤ richesse Âť), dâune part les sociĂŠtĂŠs prĂŠindustrielles (grille 1), dâautre part les sociĂŠtĂŠs industrielles (grille 2). Celles-ci ont intĂŠgrĂŠ les salariĂŠs comme acteurs de la sociĂŠtĂŠ, politiquement et ĂŠconomiquement, par le moyen du compromis social (la dĂŠmocratie sociale) et de la mutualisation des risques (la protection sociale remplaçant lâassistance).
La grille 3 schĂŠmatise la ÂŤ grande rĂŠgression Âť. Le dĂŠveloppement des travailleurs pauvres et des exclus (ĂŠconomiquement et politiquement) alimentant la catĂŠgorie des rebelles ou ÂŤ sauvages urbains Âť refusant le jeu.
Oui Ă la mondialisation, non Ă la globalisation
Faut-il rĂŠduire la mondialisation Ă un spectre menaçant, vecteur de la grande rĂŠgression ? Non bien sĂťr. En tout ĂŠtat de cause une telle attitude est vouĂŠe Ă lâĂŠchec, puisquâelle ne produit pas de marges de manĹuvre permettant de reprendre lâinitiative. Mais pour adopter une attitude offensive et positive, il est utile de distinguer la mondialisation de la globalisation.
La mondialisation, ce sont les faits, ceux de lâĂŠmergence dâune sociĂŠtĂŠ mondiale ouverte, coĂŻncidant avec le dĂŠveloppement fulgurant des communications directes, de lâĂŠconomie de lâimmatĂŠriel et de lâeffondrement du modèle dâadministration autoritaire. Cette sociĂŠtĂŠ ouverte des rĂŠseaux et de la relation offre aux pays ĂŠmergents un moyen de prendre part au banquet de la prospĂŠritĂŠ, et en plus elle conteste ou dĂŠtruit les rĂŠgimes autoritaires.
Outre le fait quâil est irresponsable de vouloir sâopposer aux faits, il faut regarder la mondialisation comme une chance, mĂŞme si le sĂŠisme est violent, dâautant que la crainte des dĂŠlocalisations et de la concurrence dĂŠloyale relève largement du fantasme et de lâalibi : le commerce des pays ÂŤ pauvres Âť ne reprĂŠsente que moins de 3 % des richesses produites par les nations les plus riches. En outre ce sont les marchandises et services rĂŠclamant beaucoup de travail qualifiĂŠ et peu de capital qui sont exportĂŠs par les pays riches 3.
La globalisation elle, est une doctrine. Câest de la politique qui est habilement assimilĂŠe Ă la mondialisation. Il est inutile de rappeler ici le contenu de cette doctrine du libĂŠralisme intĂŠgral, qui sâĂŠtale Ă longueur de colonnes et de discours. Elle enferme lâespèce humaine dans la fatalitĂŠ dâun ordre lugubre indĂŠpassable. Elle est au service dâintĂŠrĂŞts politiques.
Elle fait courir cinq dangers principaux : celui de la sociĂŠtĂŠ consumĂŠriste, oĂš lâutilitarisme individuel tient lieu de morale civique ; celui de lâeffacement des territoires comme ÂŤ construit politique Âť 4 permettant lâordre rĂŠpublicain, au profit de rĂŠgressions communautaires et dâune conception sanglante de la terre comme possession patrimoniale ; le danger ĂŠconomique dâune instabilitĂŠ croissante des marchĂŠs 5 et du dĂŠveloppement de lâĂŠconomie du crime et de la dĂŠlinquance ; le danger gĂŠopolitique dâune hĂŠgĂŠmonie mondiale utilisant au profit de sa force la ÂŤ libertĂŠ Âť de jeu partout imposĂŠe, y compris sur les marchĂŠs locaux et fragiles ; le danger pour lâespèce humaine de livrer sa survie, ĂŠcologique, nuclĂŠaire et maintenant gĂŠnĂŠtique, aux alĂŠas dâun jeu de marchĂŠ indĂŠpendant dâinstances politiques efficaces, donc disposant dâun rĂŠel pouvoir contraignant Ă lâĂŠchelle des problèmes.
La nĂŠcessitĂŠ de prendre des distances avec la doctrine de la ÂŤ globalisation Âť, dâun point de vue gĂŠnĂŠral, pour que la mondialisation soit une chance, rejoint la mĂŠfiance ou lâhostilitĂŠ ressenties par ceux qui en sont les victimes actuelles ou futures. Mais le gĂŠnĂŠral et le particulier doivent ĂŞtre pris en compte. Comme toujours, pour prĂŠserver lâessentiel, il faut ĂŞtre prĂŞt Ă remettre en cause les modalitĂŠs et les organisations.
La globalisation fonctionne comme un ÂŤ piège mimĂŠtique Âť 6 : ce nâest pas en imitant ceux qui rĂŠussissent aujourdâhui quâon les remplacera demain. Les choses vont plus vite. Un bon ÂŤ joueur Âť a une stratĂŠgie qui lui est propre, ĂŠconomique et sociale. Il ne faut pas craindre de perturber le dĂŠsir des pouvoirs, y compris des marchĂŠs, qui est dâinstrumentaliser les autres acteurs en les enfermant dans des règles qui les avantagent.
La globalisation nous enferme dans une alternative qui peut ĂŞtre schĂŠmatisĂŠe :
Nous voyons bien comment une telle formulation est un piège. Les valeurs auxquelles les sociÊtÊs europÊennes tiennent sont en amont des caractÊristiques rÊputÊes  condamnÊes , qui ne sont que des modalitÊs tellement implantÊes que nous les prenons facilement pour les valeurs elles-mêmes. Comment alors construire une sociÊtÊ jouant le jeu de la mondialisation sans tomber dans le piège de la globalisation ?

Le modèle social europÊen
Formant un ÂŤ modèle Âť au sens prĂŠcis ou pas, les systèmes europĂŠens de protection sociale rĂŠpondent globalement Ă quelques caractĂŠristiques gĂŠnĂŠrales politiques, ĂŠconomiques et culturelles qui sont propres Ă lâEurope, avec des nuances, plus marquĂŠes pour la Grande-Bretagne. Quelles sont-elles, en simplifiant ?
Comme chacun sait, ce modèle a bien fonctionnĂŠ pendant lâĂŠpoque de croissance industrielle sur une base nationale. Non seulement il a ĂŠtĂŠ efficace socialement et politiquement, mais aussi ĂŠconomiquement par le bouclage vertueux ÂŤ pouvoir dâachat - consommation - croissance Âť. Il est mis aujourdâhui en cause par des phĂŠnomènes internes Ă lâEurope, et par la mondialisation. Lâoffensive de la ÂŤ globalisation Âť, telle que nous lâavons dĂŠfinie, est la plus vigoureuse, la plus visible et la moins acceptable, mais en rester lĂ sur un mode rĂŠactif ne permet ni de comprendre ni de traiter la question.
Tentons une rĂŠcapitulation schĂŠmatique des ÂŤ nouveaux besoins Âť qui mettent en cause lâorganisation de la protection sociale :
Les anciennes structures, et les vieilles recettes telles que la relance par la consommation, ne peuvent plus rĂŠpondre Ă ces besoins et Ă ces contraintes. Câest pour cette raison que lâon nous propose par exemple de ÂŤ cibler Âť la protection sociale sur une ÂŤ assistance Âť minimum aux plus dĂŠmunis. La ÂŤ punition Âť de la stigmatisation et de la disqualification faisant sans doute parti du traitement. Ces tentatives sont cohĂŠrentes avec le modèle de sociĂŠtĂŠ dĂŠcrit plus haut.
Pour autant, la nĂŠcessitĂŠ dâadapter les pratiques sociales et la protection sociale europĂŠenne reste inĂŠvitable.

Construire des stratĂŠgies de solidaritĂŠ
La solidaritĂŠ universelle, non limitĂŠe Ă la famille primitive, de sang ou dâethnie, reprĂŠsente sans doute la valeur-clĂŠ du modèle europĂŠen, en dĂŠpit de lâabondance des abus et dĂŠrives. Câest donc sur sa base que des stratĂŠgies ÂŤ positives Âť peuvent ĂŞtre ĂŠlaborĂŠes.
La solidaritĂŠ ainsi dĂŠfinie requiert un ÂŤ construit politique Âť pour ĂŞtre mise en Ĺuvre, dans lâentreprise comme dans un pays. Elle valorise le lien politique.
Sur lâintĂŠrĂŞt ĂŠconomique de la solidaritĂŠ, beaucoup a dĂŠjĂ ĂŠtĂŠ ĂŠtudiĂŠ et dĂŠcrit. Le social est une composante de lâefficacitĂŠ ĂŠconomique. ÂŤ Il lui fournit ses forces - ĂŠducation, infrastructures - et son oxygène (demande rĂŠgulière) Âť 7.
En matière de protection sociale, construire une stratĂŠgie de solidaritĂŠ veut pratiquement dire aborder la reconfiguration des dispositifs. Ce nâest pas la solidaritĂŠ qui doit disparaĂŽtre, mais ce sont ses modes dâexpression et de concrĂŠtisation quâil faut rĂŠĂŠvaluer, et remettre en cause si nĂŠcessaire. Lourdeurs et stratifications ont parfois fait perdre le chemin au profit de logiques corporatistes non rĂŠgulĂŠes. En outre la solidaritĂŠ administrative attachĂŠe aux statuts ne permet pas de prendre en charge les parcours et les situations individuelles. RĂŠgulation, responsabilitĂŠ, proximitĂŠ et personnalisation de la relation sont les nouveaux principes que la protection sociale solidaire et collective doit aujourdâhui concrètement intĂŠgrer, en plus de lâefficacitĂŠ.
Il serait bien prÊtentieux de prÊtendre fournir une mÊthode toute faite pour dÊfinir les stratÊgies correspondantes, et encore plus de fournir ces stratÊgies. Une dÊmarche est cependant proposable pour configurer et Êvaluer pratiquement des dispositifs de protection sociale rÊpondant aux critères prÊcÊdents.
Sommairement, cette dĂŠmarche repose sur le croisement de trois approches qui apportent chacune un point de vue indispensable et complĂŠmentaire :
. une approche par les besoins, en particulier par les nouveaux besoins tels quâils ont ĂŠtĂŠ ĂŠvoquĂŠs ci-dessus. Un champ dâactivitĂŠ considĂŠrable sâouvre ;
. une approche par le contenu de la solidaritĂŠ, indispensable pour garantir la finalitĂŠ du dispositif. Celle-ci selon le dictionnaire 8, correspond : Ă unĂŠtat de fait, celui de dĂŠpendance mutuelle, crĂŠateur de lien social ; Ă unsentiment relevant du ÂŤ projet Âť, celui qui pousse les hommes Ă sâaccorder de lâaide ; et en droit Ă une propriĂŠtĂŠ technique relative Ă une obligation et faisant ÂŤ obstacle Ă sa division Âť.
Cette dĂŠfinition est intĂŠressante, car elle alimente la ÂŤ grille Âť dâĂŠvaluation dâun dispositif (de santĂŠ, de prĂŠvoyance, de retraite, etc.) et de vĂŠrification que, remplissant bien les trois ÂŤ cases Âť constitutives du contenu de la solidaritĂŠ pour les anciens et les nouveaux besoins, il nâalimente pas le modèle de sociĂŠtĂŠ dĂŠsintĂŠgrateur ;
. une approche par lâĂŠvaluation, discipline moderne qui englobe rĂŠfĂŠrences et points de vue des diffĂŠrents acteurs, avec leurs divergences, dans le processus dâapprĂŠciation dâun service ou dâune politique.
Une telle dĂŠmarche a pour objet dâalimenter une dynamique dĂŠlicate pour faire ĂŠmerger des rĂŠponses ÂŤ solidaires Âť aux nouveaux besoins, en tenant compte dâintĂŠrĂŞts contradictoires, tout en fournissant un support mĂŠthodologique.
1 : Alban Goguel dâAllondans : ÂŤ Lâexclusion : la mĂŠtamorphose dâun concept Âť, 1996.
2 : New York Times du 11 fĂŠvrier 1997.
3 : Daniel Cohen :  La troisième rÊvolution industrielle - Au-delà de la mondialisation , Fondation Saint-Simon, 1997.
4 : Bertrand Badie : ÂŤ La fin des territoires Âť, Fayard, 1995.
5 : Georges Soros, Le Nouvel Observateur du 30 janvier 1997.
6 : Alain-Marc Rieu, ÂŤ A propos de la rĂŠponse du Japon Âť, Le Monde du 18 novembre 1996.
7 : Anton Brender : ÂŤ LâimpĂŠratif de solidaritĂŠ Âť, La DĂŠcouverte, 1996.
8 : PublicitĂŠ de lâARRCO, 1996.