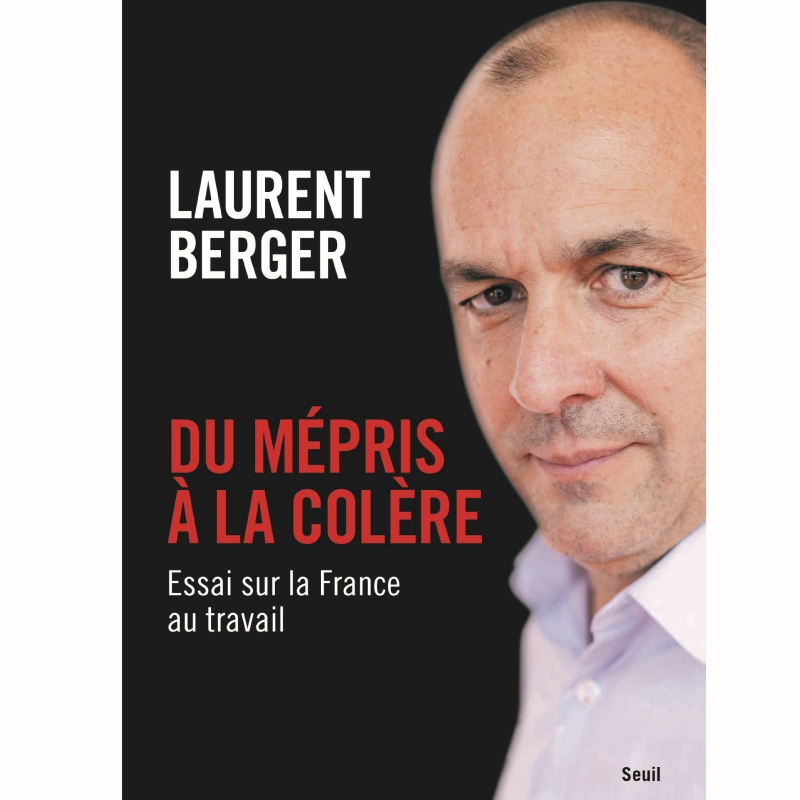La France « jacobine » serait hostile aux corps intermédiaires ! Cette antienne souvent entendue et parfois actualisée à des fins politiques ne recoupe qu’une part de l’histoire des deux derniers siècles. En effet, en parallèle de l’hostilité proclamée dans certains discours contre toute forme de corps intermédiaires, la réalité institutionnelle, sociale et politique a été différente. Loin de se résumer à un retour de l’Ancien Régime dans une France d’après la Révolution, les corps intermédiaires ont pu constituer une ressource importante pour l’établissement et l’évolution de la République. Il ne s’agit certes pas d’une histoire linéaire : du développement du syndicalisme, à celui des associations et des institutions représentant la société, de nombreux conflits ont pu accompagner ces différentes évolutions. Une approche par l’étude des corps intermédiaires permet d’analyser l’Etat dans son fonctionnement en refusant ainsi de croire à la frontière rigide entre ce dernier et la société.
Assemblée constitutionnelle depuis 1946, héritier d’une première institution créée en 1925, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) reste à la fois méconnu et un bouc émissaire souvent un peu facile lorsque l’on veut critiquer le fonctionnement présent des institutions françaises. Sis au Palais d’Iéna après avoir siégé avant 1958 au Palais-Royal, le CESE peine à acquérir une visibilité et voit sa légitimité mise en cause. Il s’agit cependant d’une institution qui permet de mieux comprendre les questions politiques posées par la place des corps intermédiaires.
Le « jacobinisme amendé »
Le premier constat passe par la référence à Tocqueville et à ses analyses signalant cette forme d’Etat jacobin qui se perpétuerait de l’Ancien Régime à la France post-révolutionnaire et nierait la possibilité de corps intermédiaires. Pierre Rosanvallon nous met en garde contre le fait de s’arrêter à ce seul constat et il souligne qu’« il convient de prendre en compte pour compléter le tableau : celle des fortes résistances à ce même « jacobinisme ». Car ce modèle n’a pas cessé d’être massivement dénoncé ou critiqué en même temps qu’il était généralement décrit comme dominant. Du même coup, il n’est pas resté figé dans sa forme native et s’est largement amendé. »[1]
Grâce aux travaux d’historiens de l’économie, on connaît aujourd’hui bien mieux l’ampleur des débats sur les corporations d’Ancien Régime durant le XVIIIème siècle. Pour la période révolutionnaire, le regard est automatiquement attiré par les fameux décret d’Allarde supprimant les « corporations de métiers » (2-17 mars 1791) et loi Le Chapelier (14-17 juin 1791) proscrivant les « réunions particulières, l’élection de syndics, le dépôt de pétitions en nom collectif ». Mais cette référence est aussi pour une part un piège pour l’analyse historique. Pierre Rosanvallon en reprenant les analyses successives de la Révolution française tout au long du XIXème siècle constate que ces textes ont longtemps été assez oubliés. Il explique même que l’on « va véritablement « inventer » un Le Chapelier imaginaire pour pouvoir prétendre ensuite dissocier sa critique d’une remise en cause des principes de 1789 »[2]. La rupture date en fait des années du Second Empire et elle se poursuit au début de la République.
A la fin 1802 (3 nivôse an XI), on assiste à une recréation des chambres de commerce car l’information économique constitue un enjeu majeur dans la France d’alors. Malgré de nombreux débats, il n’y a pas de rétablissement général des corporations mais des corps intermédiaires contrôlés sont à nouveau encouragés par l’Etat. Ce mouvement se continue d’ailleurs tout au long du XIXème siècle et les œuvres de Guizot et de Thiers peuvent aussi être relues à cette aune. Des corps intermédiaires sont acceptés pour des raisons de gestion tout à la fois comme « béquilles » de l’administration (Pierre Rosanvallon parle d’un impératif de « gouvernabilité ») et comme garde-fous contre le socialisme. Après l’élan associatif de 1848, dans cette logique, l’étape du Second Empire est essentielle avec la suppression du délit de coalition en 1864.
Une IIIème République moins hostile aux corps intermédiaires qu’il n’y paraît
Au cours des vingt dernières années, l’historiographie de la IIIème République a évolué. Le régime est certes toujours celui d’un Parlement en majesté mais nombreux sont les historiens qui se méfient de la caractérisation d’un « modèle républicain » et qui ont proposé de prendre en compte toute une série d’expériences, d’institutions et de questions longtemps négligées[3]. Au-delà des célèbres lois de 1884 sur les syndicats et de 1901 sur la liberté d’association, on connaît mieux aujourd’hui le monde complexe de l’administration consultative avec les nombreux conseils supérieurs créés à la fin du XIXème siècle. La IIIème République connaît aussi la réorganisation de certains corps intermédiaires comme les chambres d’agriculture ou les chambres de métier ont été bien étudiés.
Le XIXème siècle avait connu des projets de chambres parlementaires regroupant les « producteurs », les « intérêts économiques », les représentants du « travail », les « capacités »… Mais ces discours étaient souvent restés bien loin de toute mise en pratique, tout comme les appels réactionnaires à un retour vers une représentation corporatiste de la société comme sous l’Ancien Régime. La situation change au début du XXème siècle pour au moins deux raisons : d’une part les syndicats et les associations sont reconnus légalement depuis les lois de 1884 et 1901 et commencent à conquérir un large public ; et d’autre part le fonctionnement des institutions républicaines est ouvertement critiqué, en particulier pour le Sénat. Le débat juridique devient donc précis à la veille de la Première Guerre mondiale[4]. Il est davantage encore approprié par différents acteurs du spectre politique au début des années 1920 et après avoir été un thème de la campagne législative de 1924, le gouvernement du Cartel des gauches crée finalement par décret en janvier 1925 un Conseil national économique (CNE).
L’exposé des motifs du texte fondateur dit bien l’objectif d’une institution modeste seulement consultative mais qui doit constituer « un centre de résonance de l’opinion publique »[5]. Le nombre de ses membres est limité (47 titulaires mais auxquels s’adjoignent 94 suppléants qui peuvent siéger, auxquels s’ajoutent des experts et rapporteurs issus de la haute administration) et ils sont regroupés en trois inégales catégories : population et consommation, travail, capital. Les membres sont désignés par les « organisations les plus représentatives » pour chaque catégorie, cette expression apparaissant alors dans le contexte de la construction de l’Organisation internationale du travail.
Cette nouvelle institution, voulue par des figures du parti radical comme Justin Godart ou Edouard Herriot, est ouvertement attaquée que ce soit par les conservateurs ou chez les communistes qui dénoncent une institution mêlant syndicalistes ouvriers et représentants patronaux. Risquant toujours d’être supprimé par un nouveau décret, l’institution construit progressivement sa légitimité sous l’action efficace de son secrétaire général, le membre du Conseil d’Etat Georges Cahen-Salvador. Ce dernier encourage le CNE à produire des rapports sur la politique économique dans un moment où l’appareil d’Etat en manque encore grandement.
La création par décret trouve enfin sa confirmation avec le vote d’une loi en mars 1936 (soit juste avant les élections législatives). Le texte voté est issu de très long débat et l’organisation du CNE avait marqué les luttes autour de la réforme de l’Etat durant l’année 1934. Le Conseil en sort grandement transformé. Il est maintenant organisé en différentes instances : une assemblée générale (173 membres dont certains issus des sections) et des sections professionnelles (20 puis 25, pour près de 200 puis 250 membres). Mais à ce changement formel s’ajoute surtout de nouvelles missions avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement du Front populaire. Les grandes lois sociales (semaine de 40 heures et extension des conventions collectives) sont en effet renvoyées devant le CNE pour leur application dans les différentes branches. Connaissant une intense activité à partir de l’automne 1936, le CNE devient alors un des lieux privilégiés de négociation et de dialogue social.
L’institution refondée par la loi de mars 1936 est trop associée aux mesures économiques et sociales du Front populaire pour rester en l’état avec l’arrivée au pouvoir du Maréchal Pétain. Le Conseil républicain est dissout en décembre 1940 et remplacé par les différentes structures corporatistes que tentent de mettre en place le régime et par des conseils économiques d’experts dont l’activité reste limitée. A la Libération, l’existence d’un conseil économique et social semble certaine tant elle a été affirmée dans la plupart des projets préparés par les différents mouvements de Résistance. Les thèmes de la démocratie économique et sociale sont portés aussi bien dans le programme du Conseil national de la Résistance, que par le parti socialiste ou le mouvement des républicains populaires. Le préambule de la constitution de 1946 le manifeste avec éclat. Des débats vifs existent cependant car se pose nettement la question du bicamérisme.
Après l’échec du premier référendum, la constitution finalement ratifiée par référendum le 13 octobre 1946 parle peu du « Conseil économique » et renvoie son organisation à une loi. Or, à force de négociations parlementaires, on aboutit à une institution assez contradictoire. Les 164 sièges sont répartis de manière complexe proposant une photographie un peu déformée des forces économiques et sociales. Cette loi est modifiée en 1951 pour entériner le nouveau paysage français avec la scission de la CGT et de la CGT-FO. L’institution est présidée jusqu’à sa mort en 1954 par le syndicaliste Léon Jouhaux puis par Emile Roche, journaliste dans la presse économique et membre du parti radical. Elle intervient sur beaucoup de questions sociales mais sa voix est peu audible dans le fonctionnement heurté de la IVème République[6].
Entre timide refondation et renouveau démocratique
Les institutions nées de la rupture politique de 1958 accordent à nouveau une place à la représentation sociale et économique. Dès le discours de Bayeux du 16 juin 1946, le général de Gaulle avait présenté une vision bicamériste dans laquelle la deuxième chambre contient en fait une part de représentation professionnelle. La situation est cependant délicate à l’été 1958 car les partisans d’un maintien d’une deuxième chambre uniquement politique s’opposent fermement à la volonté du nouveau chef de l’exécutif. Le général cède sur ce point et le nouveau Conseil (devenu « économique et social », CES) est créé comme troisième assemblée consultative à la composition une nouvelle fois modifiée. Mais l’institution est dans un équilibre instable et dès 1963, le président de la République envisage de la réformer en profondeur.Cette préoccupation rencontre d’ailleurs à la même époque le souci issu d’un raisonnement très différent de Pierre Mendès France de donner une nouvelle place aux forces sociales et économiques dans une « République moderne »[7]. L’échec du projet de référendum d’avril 1969 (qui s’explique sans doute qu’assez peu par cette question constitutionnelle de la réforme du CES et du Sénat) fige en fait l’institution dans un équilibre que ne remet pas véritablement en cause les réformes limitées introduites par le président François Mitterrand, avec le vote d’une nouvelle la loi organique du 27 juin 1984.
Sous la IVème République, sur les 152 sièges, dix étaient réservés aux « représentants de la pensée française ». L’inflation du nombre de « personnalités qualifiées » sous la Vème République peut être interrogée, dès lors que la légitimité de ces nominations - entre les mains du pouvoir exécutif - est souvent l’objet de commentaires acerbes des médias et même des juristes. De même, le CES compte pendant longtemps des membres de sections en plus des conseillers et leurs désignations sont parfois sujettes à caution. L’activité de l’institution est variable suivant les périodes, la volonté des présidents du CES puis du CESE et surtout les relations établies avec le pouvoir exécutif. Si parfois les affrontements y sont vifs (sur la réforme de l’entreprise ou sur les retraites par exemple durant les années 1970 et 1980), la logique de l’institution tend au consensus ce qui atténue parfois la portée de ses travaux. Le CES est parvenu cependant sur certains thèmes à assurer une fonction de vigie. Un des plus symboliques se manifeste dans les deux rapports réalisés au CES sur la grande pauvreté par les responsables d’ATD-Quart Monde[8]. La question de l’articulation du CESE à l’échelle nationale se pose aussi dans ses relations aux CESER (Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux), à l’autre CESE (le Comité économique et social européen), aux institutions comparables dans le monde.
L’institution n’est plus la même entre les années 1980 et les années 2010 et ce fait n’est pas seulement dû au changement de dénomination intervenu en 2008 par l’introduction de la mention de « et environnemental » lors de la révision constitutionnelle. Les mesures finalement adoptées par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (changement de nom, plafonnement à 233 du nombre des membres) et surtout par la loi organique du 28 juin 2010 ont tenté de répondre aux critiques habituelles sur la composition de l’institution. Rajeunissement - obtenu par une représentation spécifique dédiée aux jeunes et aux étudiants par l’abaissement à dix-huit ans de l’âge permettant de siéger au Conseil - et féminisation - affirmée à l’article 7 de la loi organique - étaient deux axes de cette réforme. L’autre point majeur concernait bien sûr la présence de représentants de l’environnement. Cette nouvelle représentation constitue aujourd’hui une des grandes spécificités de l’institution dans le paysage institutionnel français. Parmi les autres innovations, il faut noter la possibilité pour l’institution d’être saisie par voie de pétition.
Mais il faut noter que l’introduction de représentants de l’environnement s’est faite en tenant à distance tous les projets possibles d’« académie du futur » ou de « parlement des choses ». Or, le fait d’être dans le temps d’une réflexion politique indépendante des cycles électoraux peut constituer un avantage comparatif pour cette institution. Elle pourrait de même être le lieu d’expérimentations démocratiques avec des pratiques plus suivies de conférences citoyennes et de mobilisations de personnes tirées au sort : c’est le cas partiellement avec le fait que la convention citoyenne pour le climat s’y réunisse depuis octobre 2019.
[1] Le Modèle politique français. La société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Le Seuil, 2004, p. 11.
[2] Ibid., p. 261.
[3] Marion Fontaine, Frédéric Monier, Christophe Prochasson (dir.), Une Contre-histoire de la IIIème République, La Découverte, 2013.
[4] A. Chatriot, « Les apories de la représentation de la société civile. Débats et expériences autour des compositions successives des assemblées consultatives en France au XXème siècle », Revue française de droit constitutionnel, 71, juillet 2007, pp. 535-555.
[5] A. Chatriot, La Démocratie sociale à la française. L’expérience du Conseil National Economique, 1924-1940, La Découverte, 2002, p. 356.
[6] A. Chatriot, « Renouveaux et permanence d’une institution représentative. Le Conseil économique sous la IVème République », in Laurent Duclos, Guy Groux, Olivier Meriaux (dir.), Les Nouvelles dimensions du politique. Relations professionnelles et régulations sociales, LGDJ, 2009, pp. 55-68.
[7] La République moderne. Propositions, Gallimard, 1962 et A. Chatriot, Pierre Mendès France. Pour une République moderne, Armand Colin, 2015.
[8] Joseph Wresinski, « Grande pauvreté et précarité économique et sociale », 1987, Geneviève De Gaulle-Anthonioz, « Evaluation des politiques publiques de lutte contre la grande pauvreté », 1995.