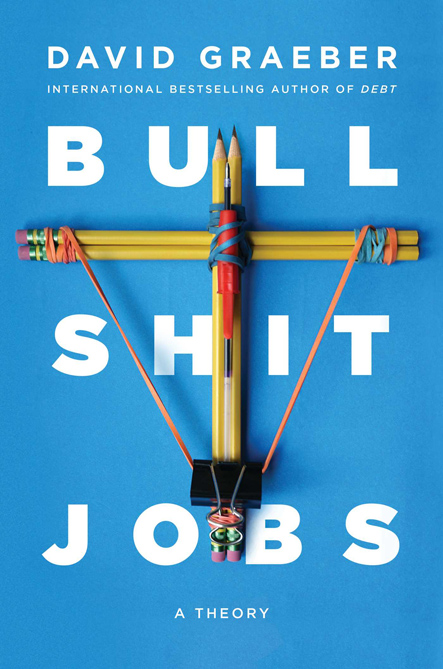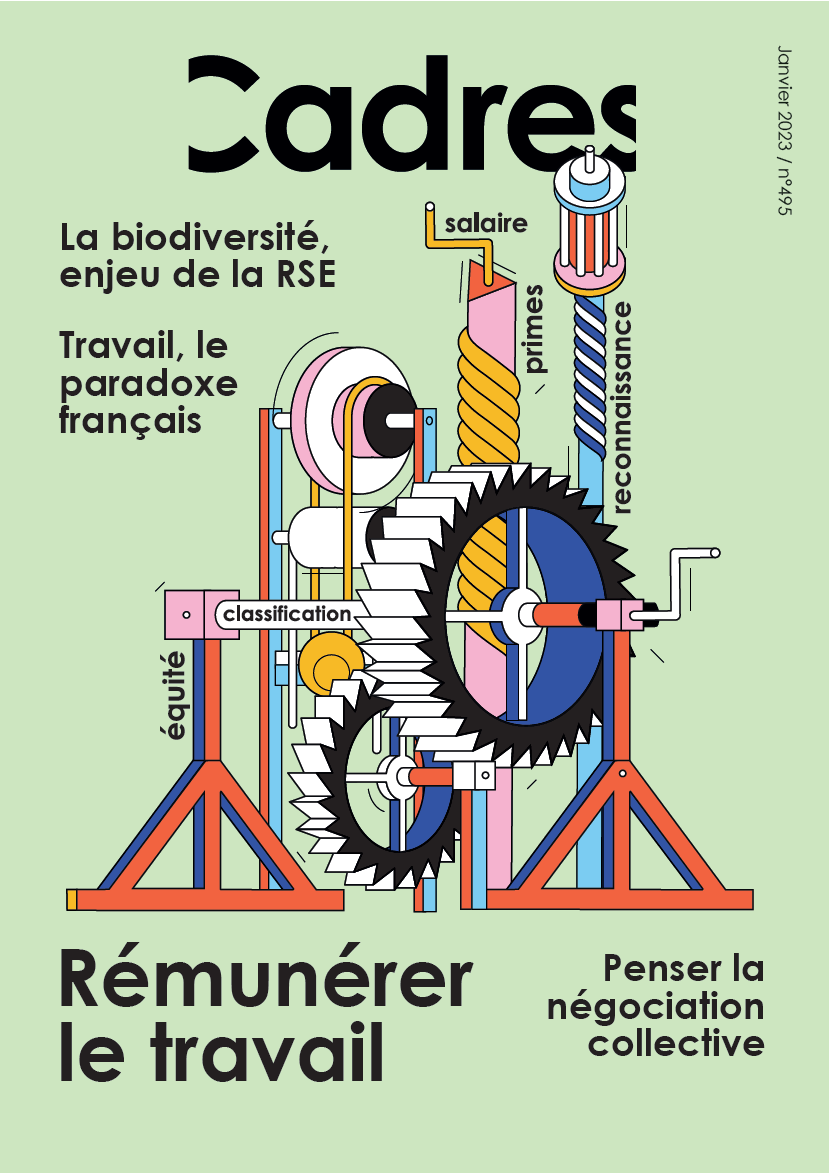La France est toujours « ce pays qui n’aime pas négocier » – comme le disait Jean-Paul Jacquier[1]. Les chiffres, certes en hausse, sont trompeurs : dirigeants d’entreprise et responsables syndicaux peinent à la considérer comme un mécanisme utile, équitable et efficace. Urgente nécessité de l’heure : en faire, inlassablement, la pédagogie. Quelques pistes sont ici suggérées. La publication par la DGT, en septembre 2022, du bilan 2021 de la négociation collective en France, et les résultats de l’enquête Acemo 2020, publiés en juillet 2022 par la Dares, viennent rappeler l’urgente nécessité d’élaborer – enfin ! – cette « pédagogie de la négociation collective » que Jean-Denis Combrexelle mettait au centre de ses propositions d’action dans son rapport de 2015, La Négociation collective, le travail et l’emploi.
Car les chiffres de la négociation collective en France contemporaine, au-delà des rodomontades et des satisfecit de la puissance publique, dessinent une réalité contrastée, en deçà des attentes, malgré vingt ans de réformes incessantes du Code du travail.
Si l’on résume les données 2020 et 2021 fournies récemment par la DGT et la Dares[2], cela donne ceci : près de 100 000 textes contractuels déposés dans les Dreets (97 240 en 2021, 96 520 en 2020) ; près de la moitié d’entre eux sont des accords ou des avenants signés par des délégués syndicaux ou des élus mandatés (48,3 %) ; et le nombre d’entreprises de moins de 50 salariés, de moins de 500 salariés et de plus de 500 salariés ayant engagé une négociation ces deux dernières années est en hausse continue (respectivement 9,2 %, 56,1 % et 93,8 % en 2021, contre 7,2 %, 51,5 % et 81,2 % en 2007).
Mais ces (bons) chiffres sont trompeurs. Car observées sur durée longue – dix, voire quinze années –, ces données dessinent un tableau moins idyllique.
Certes, en dix ans, entre 2012 et 2021, la hausse du nombre de « textes signés et enregistrés » (dans les Dreets) avoisine les 50 %. Mais la part des accords collectifs dans le total des textes comptabilisés par la DGT s’est réduite (57 % en 2021, 59 % en 2012). Le solde – 43 % ! – est constitué par les décisions unilatérales de l’employeur (type « Plan d’actions ») – on peine à comprendre pourquoi la DGT les classe en « textes contractuels »… – et les ratifications par référendums aux 2/3 auprès des salariés de textes écrits par les employeurs (environ 20 %)…
Après des années de réformes drastiques du Code du travail et moult lois sociales ou ordonnances censées promouvoir la négociation collective, le constat pour 2020 fait par la Dares, le service statistique du ministère du Travail, est sans appel : « En 2020, 16,6 % des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé non agricole ont engagé une négociation collective à leur niveau […], soit 0,6 point de moins qu’en 2019. […] 81,2 % des négociations ont abouti à un accord ou un avenant, soit un taux d’aboutissement en baisse de 5,1 points sur un an. […] Parmi les entreprises n’ayant pas ouvert de négociation, 54,1 % appliquent directement une convention de branche et 22 % n’ont pas d’interlocuteur pour formaliser le dialogue social par la négociation[3]. »
Le travail est donc devant nous. La problématique a été posée par Jean-Denis Combrexelle. « L’une des difficultés principales, écrivait-il dans son rapport de 2015, réside dans la façon qu’ont les acteurs, pas seulement les syndicats mais aussi les entreprises et leurs organisations, d’aborder la négociation collective, de la considérer comme utile, équitable et efficace, et de s’emparer des ressources que le droit leur offre. »
Il ajoutait que ce n’était pas en multipliant les textes légaux sur la négociation collective que l’on parviendra à renforcer sa légitimité : cela contribuera même, affirmait-il, à l’affaiblir davantage. « La meilleure façon d’asseoir cette légitimité est de montrer, notamment aux responsables mais plus globalement à l’ensemble de la société, que la démarche dans laquelle elle s’inscrit est rationnelle. »
Il en déduisait une feuille de route : dynamiser les comportements plutôt que produire des normes ; inviter les acteurs sociaux à transformer leurs pratiques de négociation collective ; les convaincre, exemples à l’appui, que cette négociation collective « n’est pas simplement une obligation ou une formalité mais un mode de régulation de notre société en soi efficace et qui, en période de crise, est nécessaire ».
Concernant les organisations syndicales, Combrexelle pointait une triple nécessité : modifier leur rapport à la négociation collective, en considérant celle-ci comme une méthode de résolution de problèmes socioproductifs ; ne plus définir l’agenda syndical indépendamment de la stratégie sociale et économique des firmes ; et inclure les salariés dans leurs stratégies de négociation avec les directions d’entreprise.
Sous la plume de Combrexelle, cela donnait ceci : « Il faut aussi convaincre les syndicats du bien-fondé et de la nécessité de la négociation. Cela ne va plus de soi. […] Cette négociation est doublement difficile pour les syndicats. Elle n’est plus systématiquement une négociation de distribution mais une négociation d’accompagnement de la crise et de gestion des conséquences sociales des mutations économiques. […] Mais faire de la négociation un outil essentiellement tourné vers la distribution du surplus, c’est prendre le risque pour les syndicats d’un découplage de plus en plus important avec la stratégie des entreprises. C’est aussi faire des salariés qu’ils représentent les témoins passifs de décisions qui leur échappent dans leur élaboration mais qui ont des effets directs et concrets sur leur situation. »
À ces trois problèmes – de conception de la négociation collective, de définition d’un agenda syndical de négociation et de mobilisation des salariés autour de cet agenda – s’ajoutent deux autres : l’articulation entre CSE et processus de négociation collective, et la valorisation, urbi et orbi, de ce qui a été négocié. Examinons-les en détail.
Penser la négociation collective comme un mécanisme de résolution de problèmes socioproductifs
L’énoncé peut sembler étrange. Le mot de « négociation collective » (collective bargaining), forgé par Beatrice et Sydney Webb dans l’Angleterre victorienne des dernières années du xixe siècle, désignait pour eux un substitut au marchandage de l’employeur avec chaque travailleur (l’individual bargaining), aux fins d’atténuer le déséquilibre et l’inégalité de pouvoir de négociation entre l’employeur et les travailleurs. La commission présidée par Lord Donovan, qui rendit légalement exécutoires en 1968 en Grande-Bretagne les accords collectifs signés entre les représentants des employeurs et représentants des salariés, définissait ainsi la négociation collective : « Le moyen le plus efficace pour donner aux travailleurs le droit d’être représentés dans les processus de décision affectant leur vie professionnelle »[4]. Pour l’OIT, elle est « un moyen essentiel par lequel les employeurs et leurs organisations ainsi que les syndicats peuvent établir des salaires et des conditions de travail équitables » ou « un moyen clé pour réduire les inégalités et étendre la protection au travail ». Ces définitions, toujours d’actualité, sont cependant réductrices.
Saisir aujourd’hui la négociation collective comme un processus de résolution de problèmes affectant les cours d’action de chacune des parties prenantes à l’acte productif permet de redimensionner la fonctionnalité de ce mécanisme de décision collective : moins un processus d’acquisition indéfinie de droits nouveaux qu’un processus permanent de régulation sociale conjointe.
La réduction des inégalités dans l’entreprise, la promotion d’une qualité de vie au travail ou l’obtention de rémunérations décentes ne disparaissent pas de l’agenda ; mais ces items sont inscrits dans le projet d’une entreprise pluralisée, où figurent en bonne place ces questions d’équité salariale et d’égalité professionnelle comme conditions nécessaires à sa réussite, celle-ci se traduisant par un haut niveau de performance socio-économique.
L’expression « régulation sociale conjointe » désigne l’activité de co-décision à propos des règles et des modalités de cette action productive. Représentants des salariés et employeurs sont ainsi des private legislators, des législateurs privés – selon le mot du sociologue anglais Allan Flanders, qui fut membre de la commission Donovan et proposa, à la fin des années 1960 ce concept de joint regulation que reprit et approfondit le sociologue Jean-Daniel Reynaud.
La tâche de ces co-régulateurs – employeurs et syndicalistes – est de pallier de façon appropriée les aléas et difficultés – nombreuses ! – rencontrés par l’action productive au quotidien. Ils l’accomplissent au travers d’un processus de confrontation d’arguments et de points de vue. La négociation collective est ainsi un mécanisme efficient de production conjointe des règles de travail, car résultant d’un débat contradictoire et de la prise en compte d’intérêts différents, parfois rivaux, mais que ces co-régulateurs s’efforcent de rendre compatibles.
Définir un agenda syndical de négociation couplé à la stratégie de l’entreprise et à ses enjeux de performance
Un agenda syndical autonome de la stratégie des directions d’entreprise sur leurs marchés et pour façonner l’organisation de travail peut se révéler en effet improductif. Le désintérêt des directions d’entreprise envers la négociation collective et leur croyance en les vertus supposées d’un management unilatéral, éclairé par sa seule technicité et sa réflexivité, se renforce dès lors que l’organisation syndicale majoritaire dans l’entreprise circonscrit son champ d’intervention aux seuls items de défense et de protection des salariés. S’ouvre alors un cercle vicieux : devant le mutisme des dirigeants envers les propositions syndicales d’ouverture de négociations ciblées sur les seules rémunérations directes, les responsables de sections syndicales les érigent en priorités, au détriment d’autres éléments significatifs du rapport d’emploi ; ce qui autorise les directions à ignorer ou différer leurs demandes, etc. La régulation sociale conjointe s’appauvrit, voire disparaît.
À l’inverse, un agenda syndical de négociation collective articulant explicitement les thématiques d’organisation du travail, de productivité au travail et de qualité de vie des salariés au travail, peut rendre attractifs pour les directions des processus de négociation collective dont l’objectif peut être communalisé (satisfaire des revendications et, en même temps, résoudre des problèmes productifs…).
Les risques éventuels d’un « syndicalisme gestionnaire » ou « d’accompagnement des réorganisations » peuvent être évités si cet agenda syndical de négociation est pensé comme un exercice devant générer des gains pour toutes les parties prenantes, qu’elles soient directes (salariés, syndicats, directions) ou indirectes (fournisseurs, actionnaires, société civile, etc.), et si les dimensions sociétales et environnementales dont est porteuse l’action syndicale sont intégrées au processus d’élaboration de ces compromis pragmatiques.
Mobiliser les salariés et les agents autour de cet agenda syndical de négociation
Enrôler les salariés dans l’élaboration de ce programme syndical de négociation, puis dans son suivi, enfin dans l’évaluation de celui-ci, n’est pas qu’une question de démocratie sociale : c’est aussi une condition de sa réussite. Cela est maintenant jugé comme une évidence : les questions de télétravail, d’organisation du travail et de sobriété énergétique ne peuvent être traitées qu’au plus près des salariés et des agents, en lien avec le travail réel et les contraintes de l’action productive. Le meilleur moyen de faire se correspondre règles négociées et problèmes à résoudre est d’associer pleinement les salariés et les agents à la réflexion et au suivi des processus de négociation.
Articuler CSE et agenda syndical de négociation collective
Car les deux scènes – l’instance d’information et de consultation des représentants élus des salariés et l’instance de régulation sociale conjointe via la négociation collective – sont liées, ou devraient être liées.
On le sait, la France est un pays, à la différence des autres pays européens, qui a (depuis 1947) choisi de dissocier représentation des personnels et négociation collective. Même si la formule du « conseil d’entreprise », initiée par les ordonnances sur le travail de 2017, a tenté de conjoindre ces deux activités, comme partout ailleurs en Europe, la division du travail de régulation continue de s’opérer, avec, d’un côté, des élus du CSE chargés de « présenter les réclamations […] des salariés à l’employeur », ou d’assurer leur expression collective « permettant la prise en compte de leurs intérêts » et, d’un autre côté, des délégués syndicaux, chargés, eux, de « négocier des accords collectifs » et « formuler [à l’employeur] des propositions, des revendications ou des réclamations ». On est toujours étonné de cette propension française à distinguer le fait de « présenter des réclamations » (les élus CSE) et le fait de « formuler des réclamations » (les DS), ou « permettre la prise en compte des intérêts des salariés » (les élus CSE) et « négocier des accords collectifs » (les DS), comme si ces formulations n’étaient pas identiques et ne participaient pas d’un même processus de régulation sociale…
Cette fiction juridique étant encore d’actualité, il convient que les équipes syndicales connectent elles-mêmes ce que le droit du travail n’a pas encore connecté, à savoir le travail de représentation des salariés / présentation de leurs revendications et le travail de négociation / régulation. Cela passe par un CSE assumant clairement son rôle de co-régulateur social, rôle qu’il partage avec l’employeur, et une direction d’entreprise assumant clairement son rôle de co-régulateur avec les élus et délégués syndicaux.
Deux exemples, parmi d’autres, de ce lien étroit (plus que) nécessaire entre CSE et délégation syndicale : la santé /sécurité au travail et la transition écologique. Pour ces deux thématiques, le renouvellement des CSE et la renégociation des protocoles d’accords préélectoraux sont une belle opportunité pour repenser l’articulation des instances de consultation et de négociation. Pour le premier thème, l’aménagement et l’enrichissement de la procédure et des moyens accordés au CSE lors des consultations, ponctuelles ou récurrentes portant sur la prévention, doivent être un objectif de négociation.
L’idée est d’associer continûment les élus du CSE au travail d’enquête et de délibération débouchant sur un plan d’action négocié. Pour le second thème – la transition écologique – l’essentiel a été dit dans l’article de Syndicalisme Hebdo du 15 novembre 2022, intitulé « La transition écologique, c’est aussi une affaire syndicale », qui se concluait ainsi : « Le prochain cycle électoral [de renouvellement des CSE] offre l’opportunité aux équipes de négocier des commissions environnementales ou d’inclure la thématique du climat et de la transition dans les sujets sur lesquels challenger les directions. »
Promouvoir et valoriser l’accord collectif
Le principe « faire ce que l’on dit, et dire ce que l’on fait » est plus que jamais d’actualité, en ces temps d’outrance et de (grosse) fatigue démocratique. L’enjeu est de valoriser le droit conventionnel et les productions contractuelles des acteurs « du terrain ». Et le faire avec pédagogie et constance. L’argument qui justifie cette injonction se fonde sur les données chiffrées de la DGT et de la Dares commentées au début de cet article : moins de 10 % des entreprises de moins de 50 salariés interrogées dans l’enquête Acemo (14 000 entreprises) ont négocié au moins une fois l’année précédente, et 56 % dans les entreprises de moins de 500 salariés. Il y a ainsi un faible habitus patronal et syndical à co-construire des règles et les écrire dans des accords, ces derniers étant moins vus comme des contrats, qui lient solidairement les contractants, que comme des armistices, chacune des parties privilégiant, pour atteindre ses objectifs, des stratégies alternatives (le lobbying politique, la décision unilatérale, la grève, etc.).
Or un accord collectif signé dans une entreprise, quels que soient sa taille, son secteur professionnel et l’âge de son capitaine, est d’abord l’occasion de définir à plusieurs des règles de travail et des règles d’organisation – parce qu’elles sont plus riches, plus adaptées, plus respectées puisque produites localement et à l’issue d’un débat contradictoire. Peu importe que ces accords collectifs ne soient pas des modèles littéraires ou des parangons de sécurité juridique : ces règles négociées sont en permanence révisables, et elles ont un objectif avant tout pratique. On peut également expérimenter des formes ajustées d’accords collectifs, via des lettres d’entente dûment signées, des comptes rendus validés par les deux parties, des relevés de co-décisions paraphés, etc.
Concluons ainsi ce plaidoyer : nous sommes, certes, à l’âge de la négociation collective, et d’immenses progrès ont été accomplis depuis 1982 pour rendre usuel dans les entreprises ce mode de décision prise à plusieurs et à l’issue d’une confrontation. Mais nous sommes à mi-chemin de l’objectif, et les craintes, réticences et résistances de nombre d’acteurs sociaux sont nombreuses ; elles doivent être prises en compte, puis dépassées. Les équipes CFDT sont au cœur de ce nécessaire travail de promotion pédagogique de la négociation collective.
[1]- Jean-Paul Jacquier, « Un pays qui n’aime pas négocier », dans Ch. Thuderoz et A. Giraud-Heraut [dir.], La Négociation sociale, CNRS éditions, 2000, p. 199. [2]- Rapports disponibles sur https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/bilan-de-la-negociation-collective-en-2021 et https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/la-negociation-collective-dentreprise-en-2020. [3]- Mathilde Pesenti, « La négociation collective d’entreprise en 2020. Un repli modéré en dépit de la crise sanitaire », Dares Résultats, no 33, juillet 2022. [4]- Cité dans Robert Banks, “ The Reform of British Industrial Relations: The Donovan Report and the Labour Government’s Policy Proposals ”, Relations Industrielles / Industrial Relations, vol. 24-2, 1969, p. 333-82.