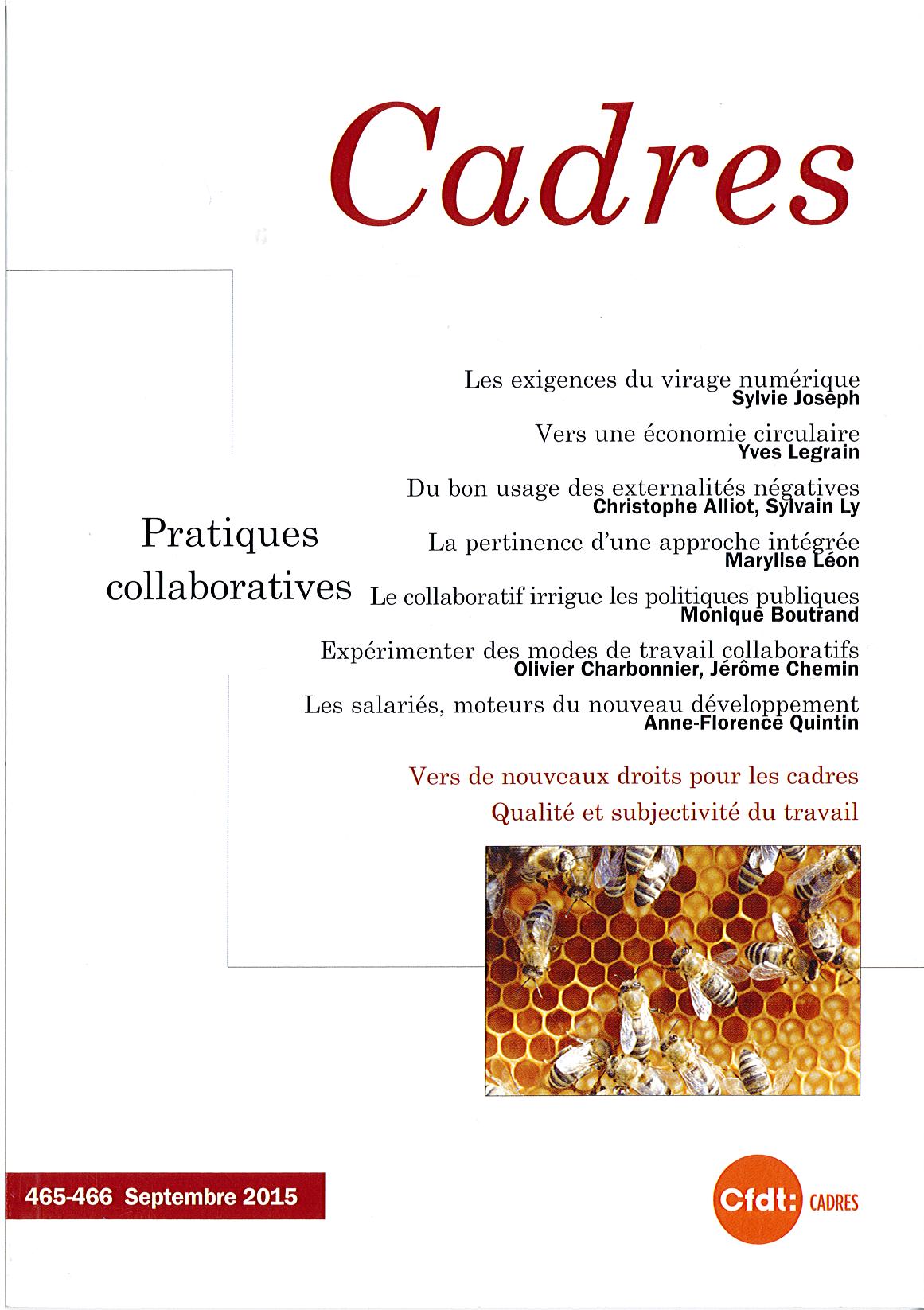La diversité des situations professionnelles et des modes d’expression questionne le travail de représentation des salariés. Actifs, retraités, salariés du privé, fonctionnaires, jeunes ou moins jeunes en insertion professionnelle… Il est exigeant aujourd’hui de militer, de négocier des droits, de gérer des systèmes de protection sociale, d’améliorer les conditions de travail, d’éviter un licenciement. Exigeant car nul ne peut aujourd’hui prétendre régenter par le haut, par la loi et par la norme des parcours professionnels désormais instables et des conditions d’activités de plus en plus intenses. Il est en effet loin le temps de ceux qui savent et pensent pour une classe ouvrière supposée unie et unique ! Il est loin le temps où obtenir des droits suffisait à améliorer la vie quotidienne professionnelle. Formation, pénibilité, précarité… Entre un accord national interprofessionnel et sa déclinaison au sein de l’entreprise, le chemin est long, complexe et demande beaucoup d’engagement aux acteurs pour transformer un acquis social en réalité sociale. L’énergie et l’optimisme militant se nourrissent alors de la proximité : négocier en entreprise, militer au plus proche de l’activité professionnelle, dialoguer avec les salariés. Le « pour eux » ne peut fonctionner sans le « avec eux ». C’est en tout cas ma conviction. La modernisation du dialogue social et le renouveau des espaces d’expression professionnelle semblent dessiner des modes militants exigeants en phase avec les salariés. Il se dessine ainsi un syndicalisme collaboratif, en phase et en écoute avec le « client final » qu’est le salarié.
Comment en effet parler de la qualité de vie au travail (QVT) sans s’intéresser au sens et à la finalité de l’activité pour celui qui travaille ? Le travail a pourtant été au cœur des préoccupations syndicales, de ses priorités aussi sans doute, mais sous l’angle des conditions de travail au sens générique (et donc un peu macroscopique du terme) plus que des conditions du travail (au sens des « conditions du faire ») pour celui qui le fait, l’exécute ou l’organise au quotidien. Le syndicalisme s’est aussi beaucoup penché sur les conséquences du travail sur la santé, la pénibilité et les risques psychosociaux. Il s’est penché sur la prévention des risques et la qualité de vie au travail. Mais sur le travail lui-même ? S’est-il penché sur la valeur d’usage (économique) du travail ? Sur ce que le salarié retire pour lui-même du travail ? Pour reprendre une analyse - exigeante pour nous tous - du sociologue Yves Lichtenberger, la finalité du travail n’est pas assez « travaillée » par les syndicalistes. De nombreux syndicalistes parlent du travail devenu invisible pour leur patron ou leurs dirigeants. Ils dénoncent leur distance avec les salariés, l’activité mais également ses bénéficiaires finaux. Les yeux rivés sur leurs tableaux de bord, ils ne laissent plus aucun regard sur le reste. Le travail n’est-il pas également devenu invisible pour certains syndicalistes ? Ce n’est pas la « valeur travail » véhiculée par le discours politicien qui nous intéresse mais la valeur économique de ce travail, la contribution à la valeur d’usage qui doit nous préoccuper, a fortiori dans une nouvelle économie qui sera celle des usages, des besoins, une économie de la qualité que la CFDT appelle de ses vœux pour un nouveau mode de développement.
Entendons-nous bien : la question n’est pas d’abandonner un angle pour un autre, mais de passer d’un angle mort au grand-angle avec une approche systémique qui nous est familière mais aussi singulière. Une telle approche doit nous permettre de prévenir les risques qui guettent le syndicalisme que sont le nombrilisme, la déconnexion et la prescription. Pour faire vite et sans doute de manière un peu caricaturale, mais avec un objectif démonstratif et pédagogique, le nombrilisme, c’est le risque du « dedans » et de l’entre-soi. On dépense beaucoup de temps et de l’énergie militante, on s’installe dans des mandats… Les heures de délégation s’écoulent au point parfois d’en oublier la finalité : le « pour quoi ? » et le « pour qui ? ». Le second risque est celui de la déconnexion. C’est l’absence du « avec eux », d’une proximité avec les salariés. On est parfois à côté de la plaque, en dehors de la cible. Une revendication ou une orientation que l’on pense bonne et juste sans se soucier du fait que les salariés n’en veulent pas, la rejettent ou l’ignorent simplement, faute de l’avoir construite préalablement avec eux. Le troisième risque est celui de la prescription, celle que l’on reproche si souvent à nos employeurs. Dans notre champ d’activité, c’est le travail syndical prescrit, en général par le haut, un peu comme dans les entreprises, avec toutefois une différence et un point commun. Le point commun, c’est le grand écart avec le travail réel de ceux du bas. La différence, c’est celle qui sépare l’impulsion pour faire (un accord sur la qualité de vie au travail par exemple) de l’injonction de faire selon la norme et avec obligation de rendre compte de la conformité. Le top-down permanent et le reporting incessant, comme on entend si souvent et que chacun dénonce. Ces risques pourraient s’amplifier si nous n’inversons pas nos priorités et nos proximités. La tâche n’est pas aisée, mais peut-on oser le changement, ou au contraire refuser l’obstacle ? Et si la période de transitions que nous vivons n’était pas une contrainte supplémentaire mais bien au contraire une opportunité pour revisiter nos pratiques, opérer notre propre mutation, notre propre transition ?
Ce rapprochement du syndicalisme avec l’activité professionnelle est une « re-connaissance » du travail. Cela signifie pour nous, syndicalistes, de ne plus se focaliser sur la seule relation entre l’employeur et le salarié mais de tenir compte de la finalité de l’activité : le client qui consomme ou l’usager d’un service public. Nous avons été absorbés par la question du lien de subordination et des conditions de travail. Le compromis fordiste « travail contre protection sociale » nous a éloignés des mutations économiques. En portant notre action sur la responsabilité sociale de l’entreprise, nous regardons désormais le travail et sa finalité. Si certains se posent encore la question de l’utilité et de la pertinence des espaces de dialogue professionnels figurant dans l’accord sur la qualité de vie au travail (QVT), la réponse est évidente, c’est bien cela qu’il faut mettre en débat et en dialogue. L’exigeante déclinaison de cet accord va mettre le focus sur l’activité, la compétence et l’expérience (au sens de la valorisation des acquis rarement formalisés, jamais transmis), pour apporter la bonne réponse, en garantir la qualité et la pertinence. On est là au cœur du travail, de sa reconnaissance, de la valorisation de l’expérience et de ses acquis. Il faut mettre en débat les dysfonctionnements organisationnels, les déficits de compétences, de qualifications ou de coopérations. Il faut du dialogue sur des sujets professionnels et un peu moins de prescription personnelle et individuelle. Il faut parler de l’organisation du travail, du management et de ce que l’on peut qualifier globalement de la professionnalité.
C’est précisément celle-ci qui n’est pas gérée, pas managée, aujourd’hui, ni par les RH qui s’intéressent à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mais pas de la gestion par les compétences, quand ils ne sont pas devenus des business partners. Ce déficit de gestion de la professionnalité concerne aussi les syndicalistes dans leur travail de proximité avec les salariés, mais aussi dans leur activité de négociateur des « conditions du faire le travail ». C’est pourtant ce qu’a fait la CFDT, une fois de plus bien seule et isolée, dans la négociation QVT pour impulser les espaces de dialogue professionnel. Le dernier terme est le plus important, car c’est bien l’entrée professionnelle, la question de la professionnalité qui doit être dominante. On est là dans ces espaces pour parler de son soi professionnel et non personnel (au sens de son espace privé, intime, ou des seules relations interpersonnelles). On n’est pas là simplement pour discuter, bavarder, ce n’est pas une conversation de salon, ni un bavardage autour de la machine à café pour parler de la pluie et du beau temps. Il s’agit d’un espace de dialogue professionnel, organisé même si la parole doit être libérée, mais sur le travail. Ces espaces de dialogue voulus dans l’accord sont différents du droit d’expression des salariés instaurés par les lois Auroux.
Les représentants patronaux et syndicaux de cet accord doivent respecter leurs engagements et aller au bout de la démarche en formant les managers de proximité. Formés pour animer ces espaces, mais aussi formés pour dialoguer avec les élus, les représentants des salariés afin que dialogue professionnel et dialogue social puissent s’articuler, se fertiliser. Ils doivent se compléter et s’articuler par le bas, pour éviter de reproduire un existant où le dialogue social se passe plutôt là-haut et le second plutôt en bas, une différence notoire, qui caractérise les grands écarts que j’ai évoqués. Entre dialogue professionnel et dialogue social, il faut un troisième dialogue entre élus et managers, cadres de proximité, pour remettre le professionnel au cœur du métier, et par là même éviter de se tromper de cible en désignant les managers responsables de tous les maux, en réconciliant cadre et syndicalisme. Les employeurs parlent d’incompatibilité, de conflit de loyauté, et continuent à dire « mes cadres, mes managers » comme si le lien de subordination était devenu un lien d’appartenance alors que l’autonomie réelle exige au contraire une insubordination, une loyauté qui ne saurait être aveugle, une responsabilité pleine et entière de ses choix, ses actes et conséquences de ceux-ci. La création d’un nouveau contre-pouvoir par le bas est un point de passage obligé, un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Attention à ne pas reproduire certaines dérives du passé pour faire de ces espaces de dialogue des seules boîtes à idées ou des cercles de qualité.
Lorsque les problèmes ou dysfonctionnements ne trouvent pas de solution par et pour le collectif de travail, lorsque le manager se trouve démuni ou lorsque le sujet ou l’objet dépasse les compétences, capacités ou plus simplement les pouvoirs des acteurs, ou encore parfois leur réelle volonté, alors la démocratie représentative doit prendre le relais de la démocratie participative. Le portage collectif doit se substituer à la demande individuelle et alimenter le dialogue social. Notre syndicalisme doit se nourrir du professionnel, des attentes et besoins des salariés mais aussi des usagers et du terrain. Il doit porter ces enjeux dans des lieux et espaces où il est plus souvent question d’outils et indicateurs de gestion, de stratégie concurrentielle, de restructurations et de pilotage par les coûts. Le canal syndical doit parfois prendre le relais d’un canal hiérarchique et managérial déficient. Il ne s’agit pas de les opposer, mais de les articuler à tous les niveaux. Pour le syndicalisme, c’est un enjeu et un défi d’un autre contre-pouvoir assis sur le « bas », le « terrain », les acteurs de la proximité au travail. Nous ne sommes pas angéliques. La mise en œuvre de ces espaces de dialogue ne sera pas une partie de plaisir. Les patrons n’en voulaient pas, deux autres organisations syndicales non plus, et ce au niveau national. Au niveau local, dans les entreprises, les mêmes ne manqueront pas de nous parler de contraintes, de temps perdu, de coût du travail et du temps de ces dialogues. Opposons-leur nos arguments sur la valorisation économique du travail. Osons leur rappeler qu’un compte d’exploitation a encore deux colonnes, celle des coûts, des dépenses, et celle des produits, des recettes. Osons leur dire, contrairement à tous leurs discours, que l’organisation du travail n’a rien d’un monopole patronal (totalement virtuel et idéologique), que ce ne sont pas eux qui organisent le travail au quotidien et que c’est d’abord l’affaire des salariés et des managers de proximité.
La montée en puissance d’un chômage de masse nous a conduits à nous focaliser sur le traitement social de l’emploi et du manque d’emplois. A délaisser la gestion économique de l’activité et du travail. La montée en puissance de la financiarisation de l’économie nous a conduits à nous focaliser sur les conséquences des pressions sur les conditions de travail, la santé au travail. A délaisser la gestion de la professionnalité. La judiciarisation a prolongé ce mouvement dans lequel les experts, les juges et les politiques se sont engouffrés pour être les derniers remparts de la défense réelle des salariés. Le rapport de force tellement déséquilibré qu’est le lien de subordination n’en finit plus d’être rééquilibré par des jugements, des arrêts de tous poils et autres réglementations qui continuent d’alimenter les flux vers le Code du travail, en empilant les couches, sans jamais traiter les stocks pour reprendre le juriste Jean-Emmanuel Ray. Tous ont-ils vraiment intérêt qu’il en soit autrement ? Le syndicalisme ne sort pas grandi d’une prescription éloignée du travail et sans écouter les salariés. C’est donc bien un autre contre-pouvoir qu’il nous faut inventer, non seulement pour eux mais avec eux, dans la double proximité aux professionnels et aux citoyens, usagers, consommateurs, clients. Une double proximité sur des espaces et des cibles qui ne sont pas le terrain de jeu naturel des patrons (là où ils ne sont guère à l’aise car trop loin) mais qui ne nous éloignent pas non plus des questions économiques.
En synthèse, réoccuper des espaces de proximité, où la création d’un contre-pouvoir sera beaucoup plus à notre portée, dès lors que l’on veut bien prévenir les trois risques évoqués plus haut. Et se donner les moyens de cette double proximité. La création d’un tel contre-pouvoir est un enjeu politique. Il doit nous permettre d’aller au bout de notre volonté émancipatrice, pour eux mais surtout avec eux, et ainsi relégitimer le dialogue social devenu trop instrumental et institutionnel. A nous de lui redonner ses lettres de noblesse et de parfois contribuer à re-légitimer le syndicalisme qui n’échappe pas à la crise des institutions et à la crise de responsabilités. Les organisations comme toute institution sont fragiles, donc mortelles. Nous avons la responsabilité collective de donner au syndicalisme un avenir et un horizon, et ce dans l’intérêt de celles et ceux que nous entendons défendre.