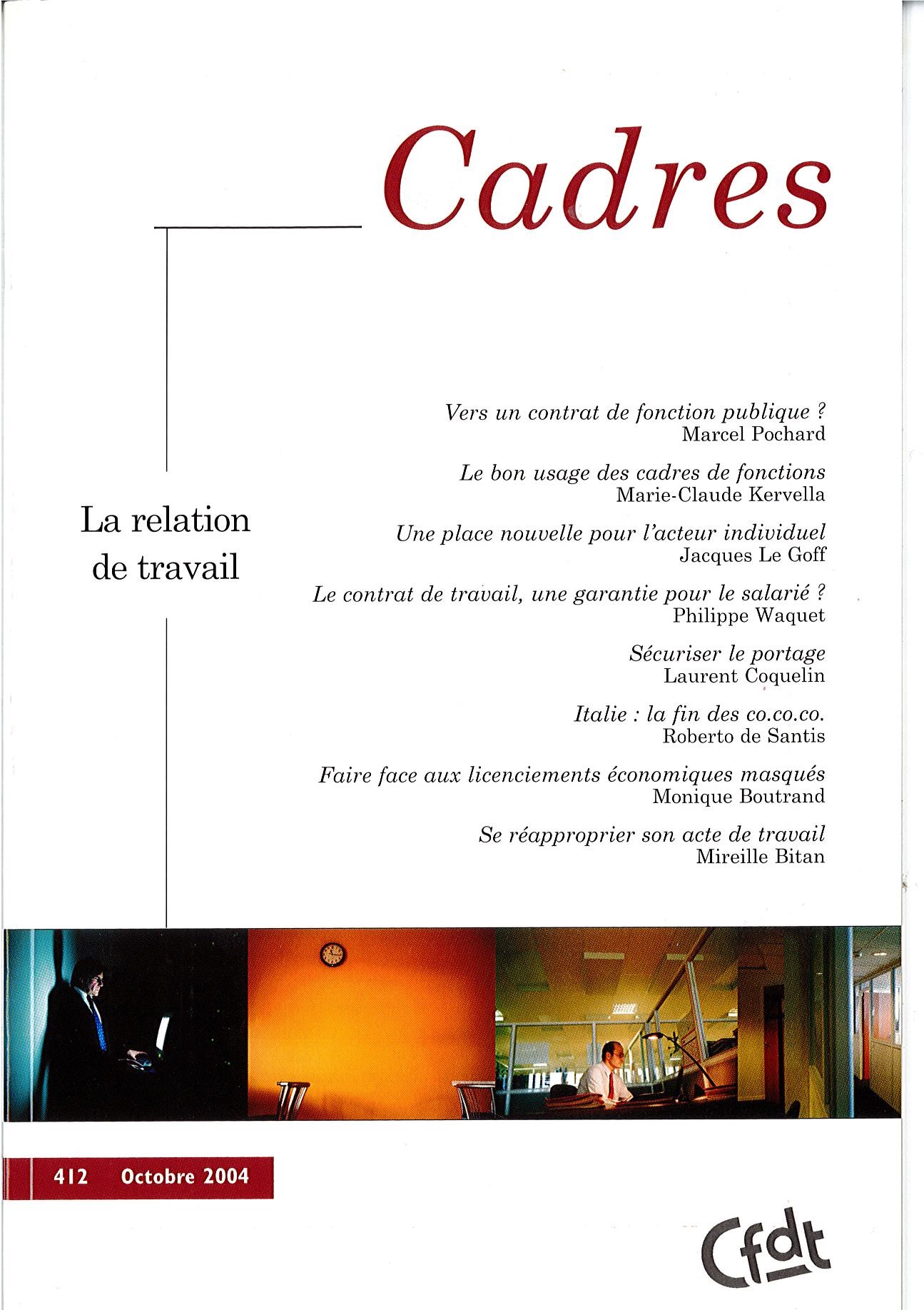Formuler une nouvelle critique du capitalisme, pour en tirer les éléments d’une politique sociale renouvelée : tels sont les objectifs, ambitieux, de l’ouvrage publié par notre ami Michel Aglietta et Antoine Rebérioux, son collègue à Nanterre. C’est sur le thème de la gouvernance qu’ont travaillé les deux économistes, en reprenant l’histoire des scandales récents à son origine : l’éclatement du compromis fordiste après les chocs pétroliers des années 1970.
Entre la fin des années 1940 et jusqu’au début des années 1980, les sociétés occidentales avaient su développer un compromis vertueux entre le capital et le travail ; en d’autres termes, entre les grandes entreprises qui formaient le centre des systèmes industriels, et leurs salariés. Les managers étaient la clé de voûte de ce système, qui avait vu, avec le modèle de la société anonyme dont les actions circulaient librement les propriétaires des entreprises se dessaisir d’une partie de leur souveraineté en échange d’une rémunération. C’est précisément le retour en force des actionnaires qui va contribuer à faire éclater ce modèle, au début des années 1980. Lié de près à l’émergence des fonds de pension, ce retour est préparé et théorisé par les juristes et les économistes libéraux, qui travaillent à rétablir les actionnaires dans leurs droits, en ramenant parallèlement les managers à leur place initiale : de simples exécutants, ne tirant leur légitimité que de leur capacité à remplir le programme tracé par les actionnaires. En l’occurrence, faire du profit. Comme le faisait remarquer Michel Aglietta dans l’entretien qu’il nous avait accordé dans notre numéro d’octobre 2003, la valeur boursière prend alors une importance fondamentale dans l’évaluation de l’entreprise. Quant au capital humain, en l’occurrence les salariés, il prend peu à peu la valeur d’une simple variable d’ajustement : un report de risque s’opère, de l’entreprise aux salariés. De fait, si l’on excepte les exceptions les plus médiatisées (France Telecom, Vivendi Universal), les taux de profit des entreprises du CAC 40 sont depuis une quinzaine d’années d’une constance remarquable, alors même que l’économie a connu des chocs considérables. Mais ceux-ci ont été absorbés par des réductions de charges – c’est-à-dire de personnel.
La régulation boursière du capitalisme est théorisée par les économistes libéraux comme la plus efficace et la plus juste ; or, répliquent Michel Aglietta et Antoine Rebérioux, la prépondérance des marchés boursiers est une perversion du système, porteuse de graves contradictions. Ce sont ces contradictions qui expliquent les crises régulières et autres bulles qui ont agité les marchés financiers, et avec eux les entreprises cotées, ces dernières années. Cette instabilité est notamment due à des effets de boucle : une action part-elle à la baisse, que l’actionnaire A va vendre, provoquant ainsi une nouvelle baisse qui va pousser l’actionnaire B à vendre lui aussi. A vrai dire, acheter ou vendre reste fondamentalement leur principal moyen d’intervention dans le système. Ces mécanismes sont connus depuis fort longtemps, mais ils ont connu avec les moyens d’information modernes et les nouvelles possibilités de financement une exacerbation sans précédent. La gouvernance par la Bourse fonctionne ainsi très mal, et elle a eu comme effet paradoxal d’augmenter le pouvoir des managers, certes placés sur un siège éjectable, mais toujours plus autonomes et dotés de salaires qui les éloignent chaque jour davantage du commun des mortels.
Plutôt que d’entrer dans le refus global du capitalisme qu’on retrouve chez les altermondialistes, Michel Aglietta et Antoine Rebérioux s’appuient sur ces constats pour proposer une rénovation du système, fondée sur un autre type de régulation. Leur idée est de revenir à son principe premier, la différence entre l’actionnaire et le propriétaire de l’entreprise.
L’actionnaire, au sens strict, n’est en effet propriétaire que de son apport financier, converti en parts sociales ouvrant droit à une rémunération. Mais d’autres participants de l’entreprise contribuent à fonder sa valeur, et au premier rang de ceux-ci les salariés. Les savoir-faire, l’expérience, la créativité, le style des produits ne gisent pas dans les comptes bancaires, mais dans les bureaux et les ateliers. Plus profondément, l'entreprise est une entité porteuse d’un intérêt collectif, celui de tous ses participants, et c’est cet intérêt qu'il faut défendre et prendre en compte. L’enjeu, dès lors, n’est rien de moins que de ramener la logique de marché sous le contrôle de la démocratie. C’est une question de logique, affirment les auteurs ; c’est aussi une question de justice.
Comment faire pour établir ce contrôle ? Michel Aglietta et Antoine Rebérioux suggèrent pour l’essentiel deux axes.
Le premier porte sur la gouvernance, avec le refus (au demeurant partagé par nombre d’entreprises européennes fidèles à un modèle rhénan plus soucieux de la pluralité des acteurs) de céder au modèle américain. Les auteurs notent toutefois que l’introduction des nouvelles normes comptables rend la chose de plus en plus malaisée. On remarquera par ailleurs que les entreprises les plus stables, celles qui échappent le mieux aux turbulences des marchés, sont celles dont l’actionnaire de référence est aussi le propriétaire historique : ainsi de Peugeot ou Michelin, en France. Ce qui contrevient franchement au distingo fondateur de la société anonyme, mais n’en constitue pas moins un type de régulation efficace, en réduisant efficacement le poids de la valeur boursière.
Le second axe d’intervention est plus audacieux : les deux auteurs proposent de créer, afin de contribuer à stabiliser les marchés financiers, un grand fonds d’investissement, contrôlé par l’Etat et investi sur le long terme, à partir des fonds de pension des entreprises et de l’épargne de capitalisation pour les retraites. Il s’agirait en somme d’une forme de socialisation du capital. L’idée est stimulante, même si l’on peut préférer l’idée d’acteurs plus nombreux, contrôlés par une forme de concurrence. Mais on peut aussi imaginer une forme de fédération de ces acteurs, sur le modèle de la Mutualité par exemple. On peut aussi s’interroger sur la pertinence économique de l’idée rooseveltienne d’investissements dans des projets d’utilité sociale. Elle est évidemment séduisante, si l’on se place sur un terrain politique ou social. Mais elle trouve aussi ses limites. Par exemple, il est évident qu’un projet comme le tunnel sous la Manche aurait eu vocation à être financé de cette façon. Mais, en dehors des jeux de yoyo d’une action Eurotunnel devenue pur objet spéculatif, pouvait-on parler d’un « investissement » ? Pour des Etats, sans doute. Pour des investisseurs, non. Peut-être alors faut-il opter pour une approche plus modeste. La labellisation sociale des projets économiques et des fonds de pension a elle aussi ses vertus, sans pour autant faire l’impasse sur le rendement de l’épargne des salariés. Mais la discussion s’ouvre à peine, et ce n’est pas le moindre mérite de cet ouvrage stimulant que de lancer le débat, en redonnant à la critique du capitalisme une vraie consistance et à l’idée de politique sociale une vraie marge de manœuvre.