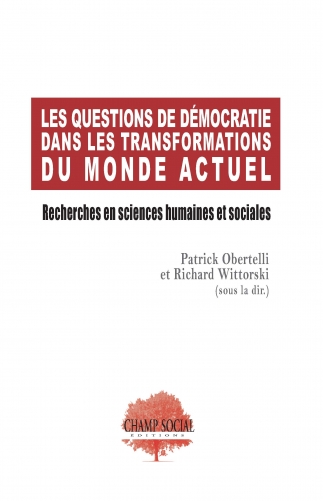La Contre-Démocratie (Seuil, 2006) explorait les formes de la défiance contemporaine à l’égard du politique, en analysant une dynamique « contre-démocratique » marquée par des pratiques de contrôle, de surveillance, de pressions… et symétriquement la fragilisation de la politique institutionnalisée, avec la question de l’abstention. Pierre Rosanvallon pointait le risque d’une « impolitique », qui verrait le « citoyen-surveillant » éclipser le « citoyen-électeur ». Or, celui-ci reste la figure centrale de la représentation politique, en théorie tout au moins. Ne faut-il pas alors revoir l’ensemble de ce modèle théorique ? Avec La Légitimité démocratique (Seuil, 2008), Pierre Rosanvallon poursuit sa réflexion en analysant une évolution encore impensée des sociétés démocratiques : le fait que la règle majoritaire ne suffise plus à asseoir la légitimité d’un pouvoir élu.
Quand la majorité ne suffit plus
Bernard Manin avait déjà noté dans ses Principes du gouvernement représentatif (Calmann-Lévy, 1995) l’importance du principe de délibération, tout aussi essentiel que l’élection pour assurer une bonne représentation. Raisonnant à la fois sur le plan des principes, qui est celui de Bernard Manin, mais aussi en historien et en sociologue attentif à la complexité du contemporain, Pierre Rosanvallon observe la montée en puissance de formes de contrôle et de validation désormais ressenties comme nécessaires pour compléter, mais aussi pour corriger l’expression majoritaire.
Deux phénomènes surtout sont sensibles. Des institutions apparaissent, comme les autorités indépendantes et les cours constitutionnelles, qui prennent un poids de plus en plus déterminant dans notre modèle républicain. Parallèlement, on voit émerger un art de gouvernement toujours plus attentif aux individus et aux situations particulières : la prise en compte nouvelle des minorités rejoint à cet égard l’attention particulière portée au « ressenti » des citoyens, envisagés non plus seulement dans leur dimension abstraite et universelle, mais dans leur existence quotidienne – ce que le sociologue anglais Anthony Giddens appelle life politics. Le « peuple », catégorie centrale de la sciences politique, s’appréhende de moins en moins comme un bloc, mais plutôt comme un ensemble disparate de situations spécifiques, caractérisant des groupes ou des individus.
Les démocraties, ainsi se complexifient. Une raison simple permet de commencer à l’expliquer : aucun parti ne peut plus prétendre incarner le peuple à lui seul, tout simplement parce que le peuple a plusieurs visages. Le parti vainqueur d’une élection peut représenter la majorité du « peuple électeur », mais ce « peuple électeur » ne recouvre pas exactement le « peuple social » (un ensemble de problèmes et d’aspirations encastrés dans l’époque et les situations particulières), pas plus qu’il ne coïncide exactement avec le « peuple principe » (constitué par les droits écrits qui forment le ciment de la vie commune). Ces trois versions du peuple ne peuvent être représentées simultanément, aucune instance ne peut prétendre les incarner complètement. Il n’y a donc pas de légitimité démocratique absolue.
Le problème est que nos institutions continuent à prétendre le contraire, ce qui entretient une frustration permanente vis-à-vis du politique.
La tradition républicaine française rêve une identification entre gouvernants et gouvernés, condamnant ainsi les gouvernants à s’épuiser dans la recherche d’un peuple introuvable (c’est le titre d’un précédent ouvrage de Pierre Rosanvallon), et les citoyens à rêver une représentation qui les déçoit continuellement.
Soucieux d’éviter tout malentendu, Pierre Rosanvallon prend soin de rappeler que le suffrage universel a constitué une extraordinaire conquête dans l’histoire des sociétés humaines. Mais il repère deux fictions fondatrices des régimes démocratiques, qui se sont fragilisées et sont aujourd’hui entrées en crise.
La première est une confusion entre la règle majoritaire, qui s’impose pratiquement comme une procédure de nomination, et un imaginaire de l’unanimité. Les sociétés démocratiques se sont construites sur l’ambition d’identifier la volonté générale, et elles ont adopté faute de mieux la règle de la majorité. Mais la distinction bien réelle entre pouvoir majoritaire et volonté générale n’a jamais été vraiment réfléchie : on a fait comme si le plus grand nombre valait pour la totalité.
Cette première confusion s’est immédiatement doublée d’une seconde, moins sensible au dix-neuvième siècle, une époque où le rythme du politique et l’évolution des opinions étaient plus lents qu’aujourd’hui : l’identification de la nature d’un régime à ses conditions d’établissement. Le moment de l’élection vaudrait pour la durée du mandat, le temps n’épuiserait en rien la légitimité de l’élu.
Certes, un député ou un président n’est pas moins député ou président le dernier jour de son mandat que le premier ; mais il n’en demeure pas moins que son crédit, et par là sa légitimité, est entamé. Or, si dans la pratique les élus savent qu’une fois passé l’état de grâce on prend garde à l’évolution de l’opinion, en théorie on fait comme s’il n’en était rien. De ce décalage naît une déception, le sentiment d’une perte de légitimité d’autant plus vive que cette perte est niée.
La question de la légitimité démocratique appelle donc un traitement plus rigoureux et plus complexe que la vision simpliste qui considère que la légitimité du pouvoir démocratique découle exclusivement de la volonté librement exprimée par le peuple.
L’administration publique entre expertise et impartialité
Une première crise de la démocratie s’ouvre dès les années 1880, précisément dans l’impensé de cette question de la légitimité. Un philosophe comme Nietzsche peut dès cet époque accuser la « tyrannie des faibles sur les forts », et plus généralement de la majorité sur la minorité, mais sa pensée ne se situe pas dans le cadre de la démocratie et ne peut donc la ressourcer. À cette époque, différents phénomènes suggèrent pourtant une crise de la légitimité électorale : Pierre Rosanvallon cite notamment l’antiparlementarisme, la dénonciation des partis, la critique du clientélisme, qui naissent sur les scandales comme celui du Panama. Plus profondément, même si la IIIe République récuse le spectre de la lutte des classes, le suffrage universel quitte la sphère de l’unanimité nationale pour devenir un moyen d’expression de la division sociale.
Cette crise bien réelle, et identifiée comme telle, ne va pas trouver de réponse durable, faute d’avoir posé précisément la question de la légitimité. En revanche, elle va donner naissance à une réponse historique qui va durer près d’un siècle, avant d’entrer en crise dans les années 1980.
Cette première crise de la légitimité électorale a conduit les démocraties, à partir des années 1920 et dans un contexte d’aggravation de la crise et de menace révolutionnaires, à mettre en place un système de « double légitimité », qui au régime de la légitimité électorale va adjoindre une seconde légitimité, avec la prise d’indépendance de l’administration publique et à sa montée en puissance comme incarnation à la fois de l’expertise et de l’impartialité. Aux États-Unis, c’est le modèle de l’administration rationnelle. En France, c’est la mise en œuvre progressive d’un imaginaire du service public, adossé à un statut qui garantit sa qualité. L’administration du dix-neuvième siècle avait été conçue comme dépendante du politique : le ministre commandait au préfet qui pouvait à sa guise révoquer un instituteur. Celle du vingtième siècle se verra conférer les moyens de rechercher et de garantir à sa façon le bien commun, de façon impartiale et désintéressée (le traitement des fonctionnaires n’est pas un salaire). Non pas à la place du politique mais en articulation avec lui.
Le suffrage universel reste central, mais est de plus en plus associé à une démocratie de la rupture : il est vu comme une technique de décision tranchant une alternative irréductible. Le référendum vient d’ailleurs, avec De Gaulle notamment, compléter l’élection tout en le principe de légitimité par majorité.
Le pouvoir administratif s’affirme quant à lui comme une incarnation de l’intérêt général tel qu’il a déjà été tranché par le politique, perpétuant la décision par une action menée dans un temps continu, à l’abri des influences partisanes mais aussi des contingences du moment.
Le pouvoir administratif acquiert ainsi au fil du siècle une légitimité nouvelle, loin de l’arbitraire qu’on dénonçait en lui au dix-neuvième siècle. Il incarne l’idée nouvelle que le peuple peut diversifier les voies de mettre en œuvre sa souveraineté, en promouvant d’autres moyens de réaliser l’intérêt général et de gérer le bien commun. La forme du concours comme voie privilégiée d’accès aux emplois publics marque bien cette recherche de légitimité.
Pierre Rosanvallon note d’ailleurs que chez les pères fondateurs des démocraties française et américaine, Sieyès et Madison, l’élection est initialement conçue comme une façon d’élever aux fonctions de directions les citoyens les plus capables. C’est de leur compétence intellectuelle et de leur intégrité morale qu’ils tirent leur légitimité ; l’élection n’est pas alors perçue comme un moment de choix entre deux programmes ou deux partis. C’est avec cette tradition, oubliée en cours de route, que renoue le concours.
La légitimité du concours peut paraître ambiguë, en retirant au peuple les moyens du choix. Le fonctionnaire français n’est pas élu (alors qu’aux États-Unis un certain nombre de fonctions demeurent électives), mais c’est précisément son détachement de la sphère politique qui lui permet d’exercer un pouvoir. Il tire ainsi sa légitimité, non du fait qu’il est désigné par le peuple, mais du fait qu’il sert le peuple, et qu’il le sert avec compétence – une compétence qui est le critère exclusif de son embauche. La notion de service public naît ainsi dans un moment de ressourcement de la légitimité démocratique.
Le système entre en crise dans les années 1980, sous la double pression d’un discours néolibéral qui promeut l’efficacité économique et la vérité des marchés au détriment des formes institutionnelles, mais aussi d’une société en évolution et dont les citoyens sont désormais mieux éduqués. Plus critiques, moins dociles vis-à-vis d’une compétence administrative qu’ils n’envisagent plus « d’en-dessous » mais d’en face (quand ils ne la prennent pas de haut), ils construisent leur rapport à l’administration comme aux élus sur un autre rapport au savoir, aux institutions, au monde en général. Défiance, contre-expertise, volonté de contrôle mais aussi de pression définissent les nouvelles pratiques citoyennes que Pierre Rosanvallon a décrites dans La Contre-démocratie.
Crise et renouveau
Ces citoyens expriment aussi des besoins et des aspirations (comme groupes, comme individus) que l’univers de la généralité démocratique, tel qu’il s’exprime notamment dans l’action de l’État, peine à embrasser. Pierre Rosanvallon parle d’un « nouvel âge de la particularité », qui se lit à la fois dans le champ de l’économie (désindustrialisation, transformations du marché du travail, montée du gré à gré et des figures de l’autonomie), dans celui du social (érosion des catégories générales comme « les ouvriers », « les cadres », émergence de nouvelles formes de rassemblement et de militantisme, valorisation de la négociation d’entreprise au détriment d’échelles plus larges).
Dans ce monde de la particularité, la forme de l’État et de l’administration publique est profondément remise en question : ses modalités d’intervention sont perçues, puis données explicitement comme trop générales, incapables de prendre en compte les particularités de la vie sociale, et donc peu efficaces. L’école républicaine offre une excellente illustration de cette crise : cette institution centrale, tout entière fondée sur l’idée d’une généralité, ne cesse d’être remise en question dans sa capacité à accueillir la différence et finit par vivre dans une réforme perpétuelle et dans un imaginaire de l’échec.
Si la légitimité administrative s’érode, la légitimité électorale subit de son côté de graves difficultés, que traduit notamment l’alternance systématique depuis 1981 ; l’élection présidentielle de 2007 étant la seule exception – encore le président élu l’a-t-il été sur le thème de la rupture.
Une des clés de cette perte de légitimité est ce que Pierre Rosanvallon appelle une « crise de la généralité », dont on peut suivre les traces dans les sciences sociales mais qui affecte au premier chef les formes politiques et institutionnelles qui ont trouvé leur légitimité dans l’expression de cette généralité. La démocratie est par définition le régime qui donne le pouvoir à la généralité sociale. Mais cette généralité est de plus en plus difficile à formuler et la règle de majorité, maillon faible du système, apparaît comme l’une des clés du problème. Les sociétés contemporaines se comprennent de plus en plus à partir de la notion de minorité. Alors que la démocratie moderne s’est construite en rêvant l’unité du peuple, le fait minoritaire s’impose de plus en plus comme essentiel dans l’horizon d’une bonne représentation.
Comment construire cette nouvelle représentation ? De nouvelles formes de la légitimité s’esquissent, dont Pierre Rosanvallon s’attache à tracer la cartographie : c’est le principal apport de cet ouvrage, sa principale avancée par rapport à ses travaux précédents. Trois figures se détachent, qui apparaissent à la fois comme des promesses de renouveau et comme des possibilités de perversion de l’idéal démocratique.
Trois figures de la légitimité
La légitimité d’impartialité s’impose comme la réponse à un problème qu’on pourrait formuler ainsi : il est difficile, voire impossible de constituer par l’élection un pouvoir réellement approprié par tous. La solution est alors d’organiser des institutions parfaitement indépendantes, en veillant à ce que nul ne puisse s’en emparer. C’est tout le mouvement de création d’institutions comme les autorités de surveillance ou de régulation, comme la Halde, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, l’Autorité des marchés financiers. Le cas de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (créée en 1978) permet de pointer qu’il ne s’agit plus d’administrations, mais qu’au contraire leur légitimité se construit à la fois contre celle du politique et celle de l’administration : un projet du gouvernement Barre visait à attribuer à chaque citoyen un numéro d’identité, afin d’interconnecter l’ensemble des fichiers administratifs ; face au risque politique sur les libertés publiques et privées, mais aussi au risque d’abus administratif, la CNIL fut créée afin d’offrir un recours. La déconnexion avec la sphère électorale et la position externe à l’administration permet à ce nouveau type d’institution de garantir une impartialité. Pierre Rosanvallon note bien que cette légitimité d’impartialité n’a pas pour enjeu de nier la nécessité d’arbitrages entre intérêts divergents ou de se substituer à la décision nécessairement partisane du fonctionnement de la démocratie. Mais elle offre une autre légitimité démocratique dans la supervision de certains domaines que l’on pense devoir échapper aux mécanismes partisans mais qui ne relèvent pas non plus d’une simple gestion administrative. Reste que comme le suggèrent les débats récurrents sur la BCE et son indépendance, ces autorités indépendantes sont encore mal intégrées à l’ordre démocratique. Il faudrait que leur mise en place fasse l’objet d’un réel consensus, que leurs membres aient été soumis à des épreuves de contrôle et de validation impliquant les différents partis, que leur indépendance soit garantie, qu’ils rendent publiquement des comptes...
Seconde forme de légitimité, la légitimité de réflexivité, qui s’incarne dans des institutions et des mécanismes voués à corriger et compenser les travers de la démocratie électorale. C’est le cas d’institutions comme le Conseil constitutionnel, qui font vivre la mémoire collective des droits fondamentaux et rappellent au pouvoir issu des urnes que le souverain ne se limite pas à son expression majoritaire. Leur enjeu est d’encadrer l’action des majorités, en activant une figure du peuple constituant qui ne coïncide pas exactement avec celle du peuple légiférant. Leur fonction est de rappeler les principes. Pierre Rosanvallon observe que les corps intermédiaires, les acteurs sociaux et les intellectuels sont des éléments structurants de cette légitimité de réflexivité, dont le Conseil économique, social et environnemental pourrait être l’un des modèles.
Dernière forme, et la plus confuse à ce jour, la légitimité de proximité traduit le besoin nouveau de la prise en compte du particulier et de la construction d’un lien de confiance entre les citoyens et les institutions. Elle trouve sa traduction aussi bien dans des formes administratives comme la police de proximité, mais aussi dans une nouvelle façon pour les politiques de gérer leur communication et de prendre en compte le particulier. Le risque, évident, elle alors une dérive compassionnelle qui empêche de donner de vraies réponses à des sujets sérieux – la loi DALO sur le logement en offrant un exemple caricatural.
L’idéal nouveau d’une interaction directe entre gouvernants et citoyens passe ainsi par une attention aux victimes, par une éthique de l’empathie ou par une valorisation excessive du terrain et du local. Il cherche encore ses formes et peut apparaître comme un dévoiement du politique, mais ne s’en impose pas moins comme l’une des trois figures émergentes de la légitimité. Pierre Rosanvallon considère même qu’il y a une véritable urgence à développer des formes de démocratie permanente, et à ne pas se contenter d’une démocratie intermittente, sur l’ancienne équation « légitimité = élection ». Comment ? En repensant la qualité du lien entre gouvernants et gouvernés : contraintes de publicité, plein exercice de la responsabilité avec des comptes à rendre, exigences de délibération, mais aussi consultation plus fréquente : primaires, place du référendum, nouvelles formes de délibération comme les jurys citoyens… L’enjeu est de ne pas laisser des formes démagogiques de type démocratie d’opinion investir l’espace de ces nouvelles attentes démocratiques.