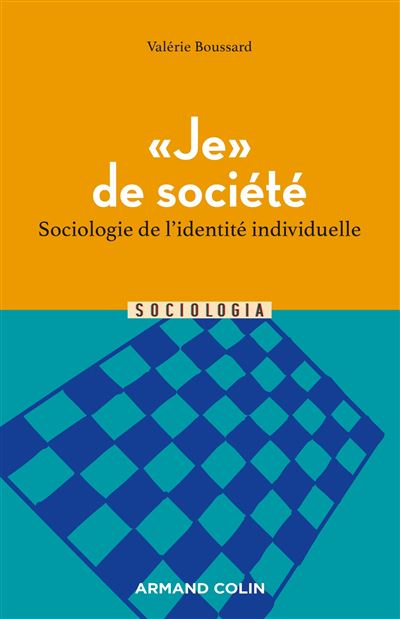L’ingénieur, celui qui au sens premier du terme met de l’intelligence dans la matière, est une figure pivot du développement industriel.
Né de l’autonomisation du savoir technique par rapport à, d’un côté le pur savoir scientifique plus tourné vers la connaissance que vers la réalisation, et de l’autre le pur savoir faire de l’artisan qui à l’inverse sait faire sans forcément savoir dire, l’ingénieur a acquis une identité et une reconnaissance comme corps social, en même temps que se déployait la volonté humaine de maîtriser la nature et la capacité à changer d’échelle dans l’organisation de la production, passant de l’atelier à l’entreprise, de l’équipe où tout le monde se connaissait et interagissait directement à la troupe organisée où chacun n’est plus relié à l’autre que par des procédures et règles impersonnelles.
L’ingénieur émerge comme l’indispensable pivot, point d’appui, point d’articulation autant qu’intermédiaire, entre sommet et base, entre nature et social, entre une volonté stratégique et un niveau de réalisation, autant qu’entre la maîtrise d’un processus de transformation de la matière et la conduite d’une d’organisation des forces sociales, individuelles et collectives pouvant y concourir. D’où sa double fonction d’expert et de cadre.
Figure emblématique de la rationalisation taylorienne du travail, l’identité de l’ingénieur se trouve aujourd’hui tiraillée entre trois figures et trois formes de performances: celle du manager chargé d’optimiser une stratégie, celle du scientifique chargé de la conception amont des produits et process et celle de l’organisateur et en particulier d’organisateur des ressources humaines au travail. « Ça va dans le bon sens ? » « Ça fonctionne ? » «C’est motivant et approprié par ceux qui sont en charge de le réaliser ?» Autant de registres d’évaluation jusque là intégrés et qui aujourd’hui tendent à se spécialiser et à s’autonomiser.
Lorsque la capacité d’innovation l’emporte sur la simple capacité d’exécution, lorsque l’innovation, aussi bien celle de rupture que l’innovation ordinaire au fil du temps, aussi bien celle concernant la stratégie que celle concernant la conception ou l’organisation, devient plus importante pour le devenir d’une entreprise que la simple capacité à faire tourner l’existant, la figure de l’ingénieur se brouille et se complexifie : il devient pivot de la mise en œuvre du changement.
L’ingénieur et le travail
Il n’y a dans l’Encyclopédie de Diderot d’ingénieur que pour la guerre, la marine et les ponts, s’y ajouteront fin XVIIIème les mines et les routes. Les grands précurseurs, d’Archimède à Léonard de Vinci, sont restés sans effet sur les façons de produire de leur époque. L’ingénieur est resté un étranger dans un mode de production dominé par l’artisanat où les savoirs sont enfermés dans les savoir-faire, comme englués dans les corps, et où l’innovation conceptuelle, la rationalisation et la commande externe de l’action ne peuvent se déployer.
La généralisation dans toute la production de corps d’ingénieurs, organisateurs à la fois experts et hiérarchiques, est une clé du développement industriel au XIXème siècle. Taylor en fera au début du XXème la figure majeure d’une organisation scientifique du travail (OST), capable, en extériorisant les savoirs des savoir-faire, de dissocier les processus naturels des processus sociaux pour mettre ces derniers sous contrôle hiérarchique des premiers.
On a suffisamment critiqué cette dissociation pour ne pas en rappeler l’aspect révolutionnaire : l’objectivation des process de transformation et leur rationalisation a révélé l’extraordinaire potentiel de productivité de l’organisation, à condition, Taylor y a maintes fois insisté, d’une part que les fruits en soient partagés sans quoi la hiérarchie perd sa légitimité et son pouvoir d’entraînement, d’autre part que les ingénieurs restent proches socialement des exécutants sans quoi ils perdent la vue sur les savoir-faire qu’ils sont chargés de définir et perdent la main sur la capacité de les faire évoluer.
L’OST, c’est pourquoi les ergonomes se sont toujours sentis plus proches de Taylor que de Ford, part d’une attention nouvelle portée au travail comme source de savoir. L’ingénieur est chargé à la fois d’extraire de la pratique des exécutants des connaissances industrielles (technologiques) qui se revendiquent comme scientifiques sans être académiques, et d’établir une cohérence entre organisation et individus et, pour cela, de donner sens à l’articulation du process et des activités.
Expert et cadre, déchargé à la fois des soucis marchands et sociaux portés par d’autres, l’ingénieur a acquis une position qui reste confortable tant que la productivité de l’organisation continue à s’appuyer essentiellement sur ses dimensions techniques.
L’industrie s’est imposée dans les secteurs où les produits et les process pouvaient être plus standardisés. A été suffisamment décrié comme signe des Temps modernes (Chaplin 1936) le modèle social qui l’accompagne de consommation de masse étroitement liée à une robotisation des travailleurs pour ne pas en comprendre la crise qui s’ouvre dans les années 60 : demande de reconnaissance de leur professionnalité de la part des exécutants («le prescrit n’est pas le réel », « la compétence déborde la qualification »), qui est aussi l’affirmation d’une capacité d’initiative jusque-là méconnue, voire bridée, ouvrant la voie à une organisation plus réactive, capable de s’ajuster sans faire exploser les coûts à des demandes plus variées.
Ce sera aussi un choc au lendemain de Mai 68 pour nombre d’ingénieurs, mal à l’aise dans leur rôle hiérarchique, qui se feront porteurs de nouvelles expérimentations de « gestion par les compétences » (Imphy-Sacilor) ou de « management participatif » (HP). Ce sera aussi un moment de basculement des ingénieurs dans un nouveau rôle, à l’articulation du technique, de l’économique et du social, rôle qui deviendra essentiel avec le durcissement des conditions de compétition internationale.
A partir des années 80 se généralise une concurrence par l’originalité et la différentiation des produits.
« Innover », faire ce qui ne se fait pas ailleurs tant dans les services produits que dans les modes de travail, devient le maître mot. Le service rendu prend le pas sur la simple matérialité du produit, la rentabilité par accroissement de la valeur d’usage (l’entreprise revisitée comme chaîne de valeur) sur le seul moindre coût, le pilotage « orienté client » remontant de l’aval sur la programmation amont par le technique, l’initiative et l’implication des salariés dans les solutions sur le seul respect des consignes.
Les mots changent de sens. L’« entreprise » définie par son unité de direction ne garde sa performance, et avec elle sa capacité à répondre de ses responsabilités juridiques à l’égard de ses salariés et de leur emploi, que comme partie d’un réseau. La pertinence de ses projets (qui est le sens premier du terme entreprise), sa lucidité stratégique et leur bonne mise en œuvre, détermine la stabilité de l’institution, alors que les droits sociaux construits à l’ère industrielle reposent sur l’idée inverse.
La bonne « organisation » antérieurement jugée a priori se mesure a posteriori : plus que l’organigramme et le programme définis a priori comptent pour la réussite, la mise en place d’un système de discussions et négociations entre collègues, niveaux hiérarchiques, services, corps et organisations professionnels, permettant leur ajustement permanent pour se saisir de l’imprévu.
L’entreprise «orientée client» concentrée sur son cœur de métier est une entreprise réseau en perpétuelle recomposition. Les niveaux du groupe et de l’établissement ne sont plus emboîtés de façon stable, ce qui rend l’emploi plus incertain et fragilise l’implication des salariés. La logique financière se dissocie de la logique productive; pourtant du point de vue du travail, jamais la réussite d’une stratégie d’entreprise n’a été plus dépendante de son appropriation par ses salariés à tous les niveaux.
Comme pour tout équilibre instable, l’entreprise ne tient plus que par les actions régulatrices qui en réajustent les forces : travail de redéfinition stratégique qui l’ajuste à son contexte, travail interne de réorganisation permanente qui font de cette stratégie un enjeu atteignable et partagé. L’ingénieur organisateur devient un réorganisateur permanent, metteur en œuvre du changement chargé de l’articulation entre l’économique, le technique et le social qu’il ne peut plus ignorer. Considérable enrichissement de sa tâche, mais position bien plus inconfortable que ce qu’on lui a appris !
Ingénieurs et besoin de syndicalisme
Rendre opérationnelle une stratégie « orientée client» se heurte à au moins trois difficultés :
- Celle d’accorder une autonomie suffisante -à la fois un cadre et des marges- à chaque niveau opérationnel comme condition d’initiatives et d’innovations. Cela vaut pour les établissements d’un groupe comme pour les services, les équipes, et au final les individus de chaque établissement. Mais il n’y a pas d’initiative et d’innovation sans remise en cause de l’existant, ce qui implique aussi que puisse être acceptée l’expression de conflits et que soient trouvés les dispositifs de concertation suspendant pour un temps les relations hiérarchiques de subordination,
- Celle de pouvoir décliner une stratégie en objectifs opérationnels appropriables à chaque niveau d’organisation. Une stratégie globale n’est pas en soi porteuse de sens permettant de prendre les bonnes décisions à chaque échelon. Bien sûr il faut toujours faire vite et bien de la façon la plus économe en temps et en moyen, mais entre « faire vite au mieux » et « faire bien dès qu’on peut » il y a le plus souvent à trancher, à faire un choix dont la pertinence dépend du destinataire du travail. Du coup la force d’une entreprise réseau réside souvent dans sa capacité à décliner ses objectifs « client » pour permettre une plus grande prise d’initiative dans l’apport de solutions opérationnelles. Elle implique la capacité à animer la discussion sur la « figure du client », client final et client intermédiaire pour donner sens au travail de chacun,
- Celle d’obtenir la coopération de ses subordonnés et/ ou de ses collègues à la réussite d’une tâche. Qu’il s’agisse d’un projet dont il est personnellement chargé ou d’une mission confiée à «son» équipe ou service, la réussite d’une tâche a toujours dans une entreprise une dimension fortement collective. La coopération, la libre implication à plusieurs autour d’un même objectif, est nécessaire là où la simple coordination, l’exécution séparée par chacun de sa tâche, ne suffit plus ; là où les interactions sont fortes et les ajustements réciproques nécessaires. Elle implique de savoir et pouvoir discuter et négocier.
Ces difficultés sont celles que rencontre l’ingénieur à la fois dans ses relations à sa hiérarchie et dans celles à ses subordonnés : acquérir distance et autonomie sur un plan personnel et en avoir les moyens dans ses relations aux autres, expliciter un sens du travail qui vous motive et peut vous motiver à agir avec d’autres, s’inscrire dans un développement personnel qui soit lié à un développement d’équipe et d’entreprise.
Autant de difficultés souvent traitées d’un point de vue psychologique et gestionnaire en en ignorant l’enjeu social, celui de la constitution d’identités professionnelles fières de ce nouveau rôle, en revendiquant à la fois les moyens et la reconnaissance. Devant ces difficultés, l’ingénieur se trouve souvent isolé, confronté à une hiérarchie qui se déleste sur lui sans qu’il y trouve de soutien et à des subordonnés qui attendent de lui ce qu’il ne peut donner, destiné à une carrière plus souvent marquée du sceau du diplôme initial, du statut d’embauche, de la technicité acquise que de la réussite professionnelle, non que celle-ci ne compte pas, mais qu’elle ne compte qu’en second rang.
On retrouve là ce qui historiquement a toujours été moteur dans la transformation du syndicalisme : né de l’affirmation d’une valeur particulière du travail il évolue avec elle. Passant d’un syndicalisme de métier défenseur de l’autonomie professionnelle à un syndicalisme de masse et de classe qui s’est détourné de l’action sur l’organisation du travail au profit de la consolidation de protection sociale, il peine aujourd’hui à réinscrire dans ses objectifs la défense d’une implication au travail comme source d’intérêt, de sens et de reconnaissance. Les ingénieurs y sont doublement concernés : comme catégorie particulière d’une part ayant besoin pour assurer leur rôle d’organisateur, qui est un des intérêts de leur travail actuel, de s’appuyer sur une force corporative leur permettant de mieux l’expliciter et d’être en position d’en négocier les moyens et la reconnaissance ; comme participant à une collectivité d’entreprise d’autre part élaborant sa propre vision de son utilité et de ses rapports à son environnement local social et écologique.
Il est frappant de constater combien dans les discussions à tous niveaux « entre collègues » reviennent les thèmes du « bon travail », celui dont on est fier ou qui simplement vous permet de mener la vie de votre choix versus les situations inacceptables qui devraient disparaître ; les thèmes des « bonnes manières », celles que l’on voudrait voir ériger en règles versus celles qui devraient être sanctionnées ; et les thèmes du « bon client », celui que l’on aime servir versus celui que l’on voudrait écarter. Et ce sans que ces sujets fassent l’objet de débats syndicaux.
C’est pourtant autour de tels thèmes, toujours chargés d’émotions, que se nouent des sentiments d’appartenance et des communautés d’intérêts qui traversent les appartenances catégorielles : « Avec celui-ci on ne s’entend pas !» « Avec celui-là on peut parler ! » sont des phrases souvent entendues, signes pour le sociologue à la fois d’un partage de valeurs et d’une recomposition en cours des identités professionnelles autour du sens du travail.
Plus que d’autres, l’ingénieur se trouve confronté à la complexité du travail aujourd’hui, à la multiplicité des dimensions à prendre à chaque instant en compte. Plus que d’autres parce qu’il ne peut rester spectateur ou critique ni s’abstenir de décider pour lui et pour d’autres, il ressent le manque de repères clairs, le manque d’appui sur des cultures professionnelles légitimes pour orienter l’action et trancher entre comportements acceptables et ceux qu’il doit sanctionner. Au nom de quoi peut-il le faire? De son savoir et de son expertise? Ils n’y suffisent plus ! De sa place hiérarchique ? Elle n’a pas de légitimité en soi, pas en tout cas dès qu’il y a le temps de discuter ! De son charisme, de la sympathie qu’il peut entraîner ? C’est épuisant, et à force d’attention aux autres il finit par ne plus se retrouver lui-même !
Il lui faut, lui aussi, pouvoir ne pas être un simple rouage, tiraillé entre haut et bas, entre injonction de productivité et condition de mise en œuvre. Il lui faut, lui aussi, pouvoir expliciter ce qui fait la valeur de son métier, faire une force de son rôle d’intégrateur de complexité, de metteur en œuvre du changement. Il lui faut, pour le dire et le faire valoir, pouvoir en parler, hors de toute pression hiérarchique (d’en haut ou d’en bas serais-je tenté d’ajouter). Il lui faut pour donner sa vraie dimension à son activité pouvoir, lui aussi, en confronter les valeurs avec celles des autres.
La question est où et quand ? N’est-ce pas là que se mesure une présence syndicale ?