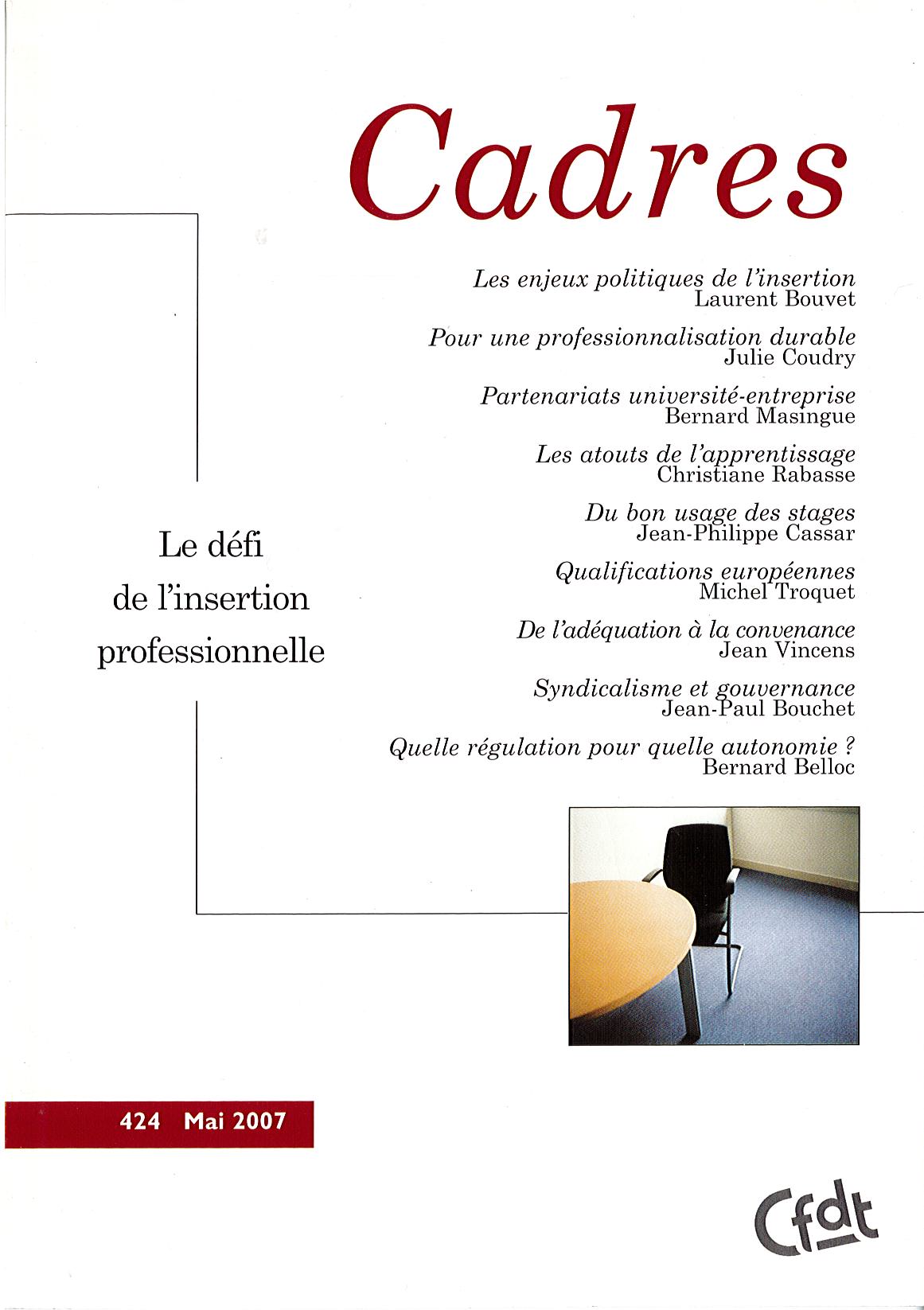Professeur à la Stern School of Business (New-York), Thomas Philippon propose dans cet ouvrage une interprétation originale de la « crise française du travail ». Les Français, explique-t-il, accordent plutôt plus d’importance au travail que les autres Européens, et les rigidités du droit et de la fiscalité ne peuvent expliquer à elles seules l’apparition et la persistance du chômage de masse.
L’analyse systématique des données disponibles suggère une forte corrélation entre la mauvaise qualité des relations du travail et le manque de dynamisme de l’économie française. Les relations sociales sont marquées dans notre pays par l’insatisfaction et la méfiance réciproques. Cette situation se traduit par un syndicalisme de contestation, mais elle est aussi le résultat d’un « capitalisme d’héritiers » dont les pratiques managériales sont conservatrices et peu satisfaisantes pour les salariés. On connaît depuis longtemps les travers du syndicalisme à la française ; c’est tout l’intérêt de cet ouvrage que de mettre en évidence la part patronale et managériale.
Le capitalisme français peine à promouvoir les plus créatifs et les plus compétents. Dans le recrutement de ses élites, il tend à privilégier l’héritage et la reproduction sociale. Ce phénomène issu d’une histoire longue et complexe a aujourd’hui un coût économique.
L’histoire patronale française, écrit Thomas Philippon, « oscille entre paternalisme et minutie bureaucratique, mais entretient toujours un goût immodéré pour la hiérarchisation des rapports sociaux ». Ce système caractéristique de la « société de rang » (Philippe d’Iribarne) entretient des relations de méfiance entre l’entreprise, l’État et les salariés. Le manque de coopération et de délégation est à l’origine de rigidités tout aussi pénalisantes que les rigidités institutionnelles.
Revenant sur l’évolution du capitalisme français, d’une conception familiale et paternaliste avant 1940 à un capitalisme bureaucratique après 1945, Philippon admet que la radicalisation des syndicats a rendu difficile la coopération et la délégation d’autorité au sein des entreprises, mais il observe que la prédilection du management français pour les hiérarchies rigides et les statuts prestigieux a certainement terni l’image des dirigeants. Cela pose dès lors un problème de confiance. Nous sommes ainsi pris dans un cercle vicieux qui alimente et entretient la méfiance. Du paternalisme autoritaire aux hiérarchies bureaucratiques, en passant par les interventions directes de l’État et en particulier les parachutages, les relations sociales à la française sont marquées par la distance. La promotion interne est sans doute la grande faiblesse d’entreprises et d’une économie qui se privent ainsi d’une force de renouvellement, au profit de la reproduction sociale de certains groupes, ceux dotés d’un capital économique ou d’un capital culturel. On retrouve ici des idées énoncées il y a des années par Pierre Bourdieu, mais dont personne n’avait vraiment exploité les vertus éclairantes en matière de performance économique.
Un défenseur hypothétique de la reproduction des élites aurait certes beau jeu de citer le Royaume-Uni, qui ne nous cède en rien sur ce terrain et dont l’économie est florissante. Sans même prendre la peine de passer la Manche, considérons nos grandes entreprises : les groupes dirigés par des héritiers patrimoniaux, comme Auchan ou Michelin, affichent des résultats remarquables qui interrogent sur la vertu d’un actionnariat stabilisé et incite à relativiser les travers du management d’héritiers. De leur côté, les groupes industriels tenus par des Gadz’arts ou les banques dirigées par des X Mines sont devenus en quelques dizaines d’années des champions mondiaux, les parachutés ont souvent bien tenu leur rang et si le management des anciens élèves des grandes écoles a évidemment ses défauts, il reste étonnamment efficace. Peu satisfaisant pour les collaborateurs, sans aucun doute, mais la performance économique des grandes entreprises en souffre-t-elle ? La bourse nous assure que non.
La question soulevée par Thomas Philippon semble donc valoir davantage pour l’ensemble de l’économie française qu’au sein de grandes entreprises dont les résultats sont souvent excellents. Leurs relations souvent impérialistes avec leurs sous-traitants, la difficulté de notre pays à faire surgir un tissu de PME innovantes apparaissent comme des points tout aussi sensibles et la problématique de Philippon peine à en rendre raison. Enfin, par-delà les relations internes au sein des entreprises l’amélioration des institutions du marché du travail est un chantier majeur si l’on veut suivre la piste ouverte par les Néerlandais et les Scandinaves.
Le livre de Philippon ouvre un débat essentiel et il éclaire assurément l’une des faiblesses économiques de notre modèle de société. On le lira avec attention, tout en prenant garde à ne pas réduire les problèmes économiques de notre pays au problème qu’il identifie.