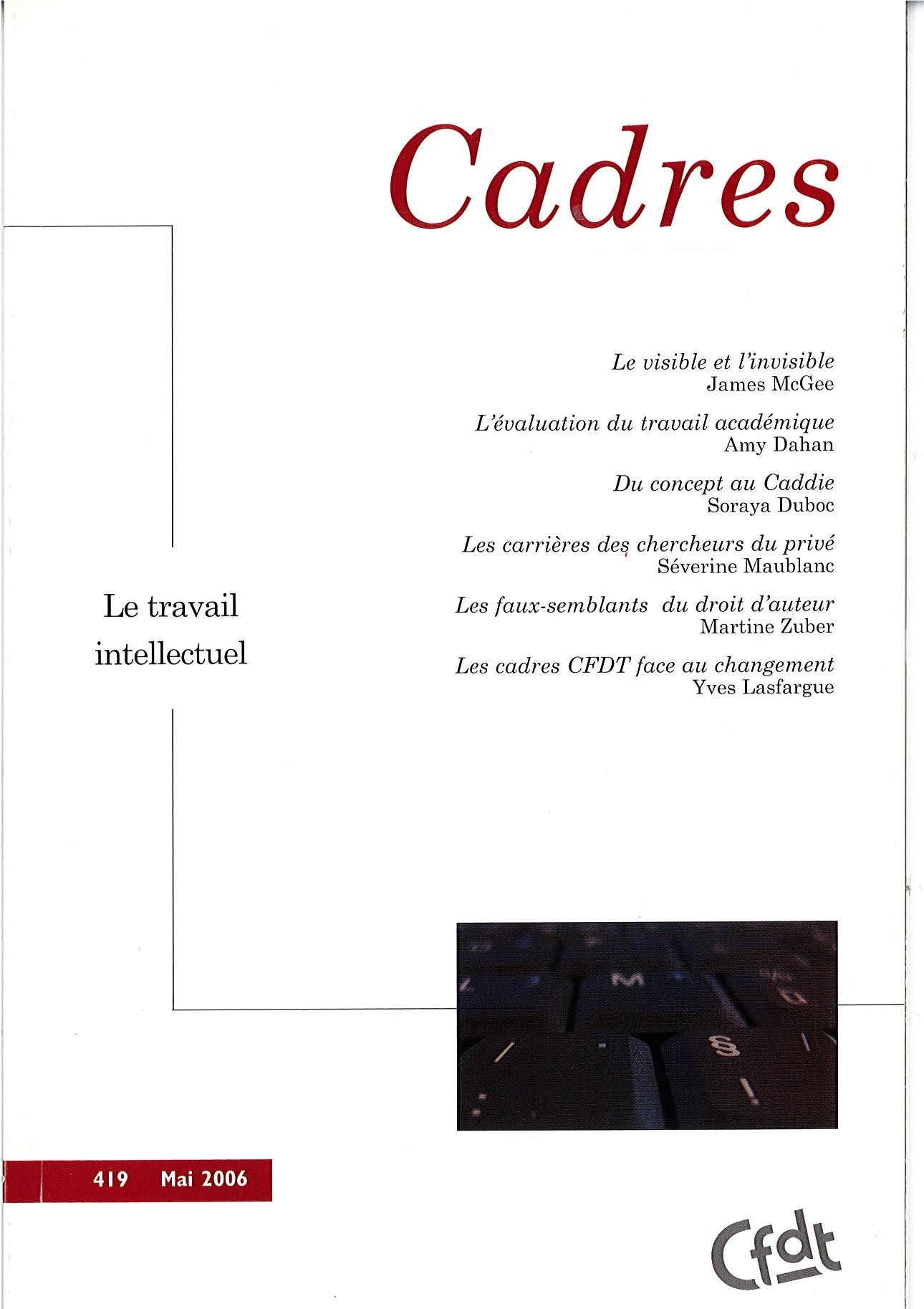Le premier est la mise à l’écart du droit du licenciement. C’est le scénario prévu par la circulaire du 8 mars 2006 envoyée aux parquets : pas d’obligation de mentionner un motif dans la lettre de licenciement ; pas de contrôle de l’existence d’une cause réelle et sérieuse par le juge ; s’il s’agit d’un motif économique, pas d’obligation de reclassement pour l’employeur. Cependant, des dispositions particulières n’ont pas été écartées par l’ordonnance (protection des représentants du personnel, des femmes enceintes, interdiction de mesures discriminatoires…).
En dehors de ces cas, la rupture du CNE peut faire l’objet d’une demande en réparation pour abus de droit. Cette possibilité résulte d’un principe général du droit. De surcroît, l’article 1780 du Code civil prévoit la possibilité d’une telle réparation. Il faudra donc exhumer la jurisprudence sur l’abus de droit, en matière de licenciement, d’avant 1973 (date à laquelle l’exigence d’une « cause réelle et sérieuse » est entrée en vigueur).
Cependant, la circulaire du ministère de la Justice laisse de côté plusieurs questions qui ne manqueront pas de se poser, même si la thèse qu’elle soutient l’emporte. La plus sensible concerne la question de la motivation du licenciement.
Le Code de procédure civile prévoit que « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ». Lorsque le salarié attaquera la rupture du CNE, il demandera naturellement à l’employeur d’alléguer un motif, et, si celui-ci s’y refuse, se tournera vers le juge pour que celui-ci ordonne à l’employeur de s’expliquer. On voit mal le juge refuser une telle demande, tant la connaissance du motif de la rupture est utile pour statuer sur l’abus de droit.
L’autre question concerne l’application des conventions collectives. Le CNE est un contrat à durée indéterminée, comme le précise l’article 2 de l’ordonnance. La rupture du CNE est un licenciement. L’ordonnance de 2005 n’a pas prévu de soustraire ce licenciement aux dispositions des conventions collectives en vigueur. Prenons par exemple l’article 13 de l’accord national interprofessionnel sur la sécurité de l’emploi, modifié en dernier lieu en 1994 ; en cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, il impose la convocation du salarié à un entretien préalable et l’indication du motif dans la lettre de licenciement. Les accords de branche comportent fréquemment, de leur côté, des dispositions relatives aux licenciements.
Le deuxième scénario est la prévalence de la convention n°158 de l’OIT sur les dispositions de l’ordonnance. C’est à la Cour de cassation qu’il incombera de « préciser le régime applicable à la rupture du CNE ». Or la France a ratifié la convention n° 158 de l’OIT, qui dispose (art. 4) qu’un « travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ». En outre, d’après l’article 7, « un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées ».
D’après l’article 55 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure aux lois. Les conventions de l’OIT sont des traités.
La convention n°158 est d’effet direct, ce qui veut dire qu’elle peut être invoquée par un salarié devant un tribunal français. Cependant, son article 2b permet d’écarter de l’exigence du motif valable « les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable ». Il faudra donc que la Cour de cassation détermine si le délai de deux ans est « raisonnable ».
La Cour pourrait ainsi assujettir la rupture du CNE à toutes les obligations de la convention ou bien, comme le suggérait le Commissaire du gouvernement M. C. Devys dans ses conclusions devant le Conseil d’État, disjoindre les questions.
Troisième scénario, la Cour de cassation combine les normes applicables. C’est à mon avis la solution la plus élégante. Elle s’adapte bien à une application partielle de la convention.
Au lieu d’opposer l’ordonnance et la convention de l’OIT, la jurisprudence ferait application simultanément des deux. C’était l’une des hypothèse envisagée par M. Devys pour écarter l’illégalité de l’ordonnance : « Si… vous considérez que les deux notions de motif valable et de motif réel et sérieux ne sont pas a priori identiques, vous devrez constater que, si l’ordonnance du 2 août 2005 a entendu déroger à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, elle ne peut être regardée, dans le silence du texte et conformément à la hiérarchie des normes, comme ayant écarté l’exigence d’un motif valable au sens des stipulations de l’article 4 de la convention n°158 et que, dès lors, elle n’a pas dérogé à ces stipulations ».
Le caractère très vague de l’article 1780 du Code civil peut inciter à aller dans ce sens. D’après ce texte, « la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. Pour la fixation de l’indemnité à allouer, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé ».
Ce texte vise l’abus de droit, quoique le terme ne soit pas employé. Cela étant, le contenu de la notion d’abus de droit varie suivant les cas où l’on en fait application.
Il est possible d’exhumer la jurisprudence antérieure à 1973. Cependant, la France a ratifié la convention n°158 après cette date (1989). On pourrait donc revisiter la notion de licenciement abusif à la lumière de cette convention. Serait abusif, une fois écoulée la période d’essai, tout licenciement sans motif valable (à moins que l’exigence plus forte d’une cause réelle et sérieuse ne s’applique).
Il faudra du temps pour que la jurisprudence se fixe. C’est pourquoi des avocats patronaux et certaines organisations d’employeurs conseillent de licencier les salariés sous CNE en respectant la loi de 1973.