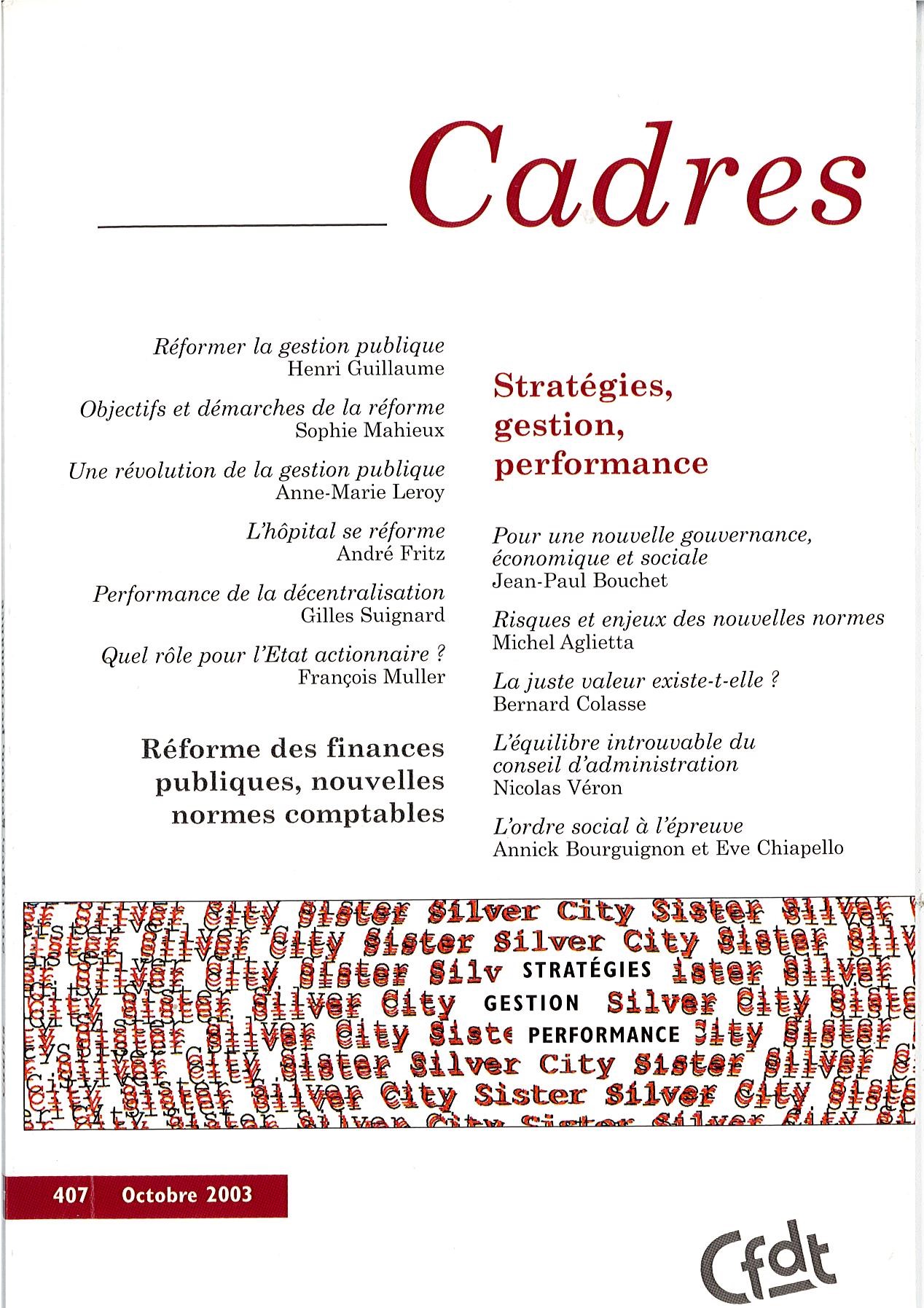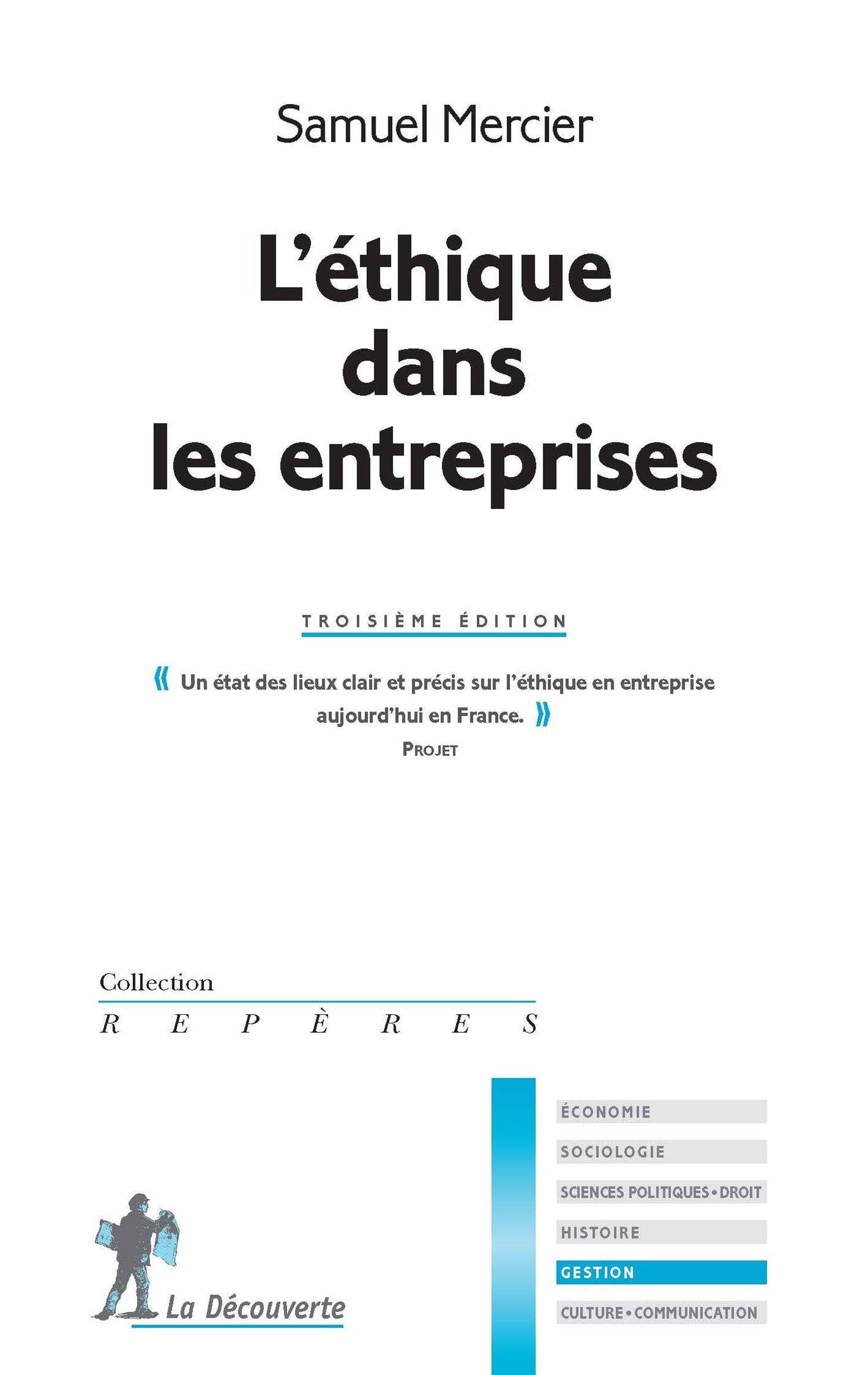Un nouveau modèle de gestion publique
L’ambition de la gestion de la performance est de substituer à la logique traditionnelle de consommation des moyens budgétaires par les administrations une culture de résultats, de transparence et d’évaluation. Schématiquement, un système de gestion de la performance est un mode de pilotage et de contrôle de l’action publique qui s’articule autour des fonctions suivantes :
L’explicitation des objectifs des politiques publiques et l’identification des structures administratives responsables de leur mise en œuvre ;
La définition de normes de performance traduisant un engagement des responsables sur le degré de réalisation de ces objectifs et sur les moyens qui y sont consacrés ;
La mesure des résultats obtenus et leur reporting ;
L’octroi de souplesse de gestion aux responsables administratifs en contrepartie de leurs engagements sur les résultats (contrat de performance) ;
L’intégration des données de performances dans les décisions d’affectation des ressources, l’élaboration de budgets de résultats ;
Les modalités d’audit et d’évaluation ; le contrôle a posteriori des structures administratives.
Précisons d’emblée que nulle part ce dispositif d’ensemble ne fonctionne dans cette pureté théorique, ni de façon totalement intégrée. En revanche, la plupart des composantes de ce système sont opérationnelles dans les administrations étrangères les plus avancées. Je renvoie à cet égard à une enquête internationale menée dans huit pays sur l’implantation pratique d’un système de gestion de la performance1.
Plutôt que de me livrer à une analyse détaillée de ces nouveaux outils de gestion, je me propose de mettre l’accent sur les facteurs favorables à leur mise en place et sur les enseignements à en tirer pour l’expérience française.
Les moteurs de la réforme
Tout d’abord, nulle part l’administration ne s’est réformée de l’intérieur. Pour que les choses bougent, il a fallu une impulsion politique très forte. La continuité de ce soutien, qui souvent a transcendé les clivages partisans, a été décisive. Quelles ont été les raisons de cette implication du politique ?
Les réformes reposent sur la vision selon laquelle l’intervention de l’Etat ne peut être légitimée auprès des citoyens que si elle est efficace. Elles ont visé à répondre aux critiques croissantes des citoyens et des parlementaires sur l’opacité de l’administration et sur la nécessité de mieux contrôler son action. Certains pays ont donc tenté de développer un nouveau modèle de gouvernance plus ouvert, impliquant une claire définition de la responsabilité qu’exercent les ministres et les hauts fonctionnaires sur les organisations qu’ils dirigent, et leur imposant de rendre réellement compte de leurs actions devant l’opinion et le Parlement2.
Les gouvernements ont également dû faire face à une attitude plus consumériste des contribuables à l’égard des services publics. C’est le thème anglo-saxon de la « value for money » qui dans certains pays est devenu un véritable slogan politique. Ainsi la volonté d’équilibre entre la qualité et le coût des services publics caractérise bien le « new public management » que Bill Clinton a eu pour ambition de promouvoir dès le début de son premier mandat. Dans plusieurs pays, l’attention portée à la qualité des services publics s’est traduite par l’instauration de normes formalisées dans des chartes, replaçant l’usager au cœur de l’action publique.
A ces raisons politiques s’ajoute bien entendu la volonté de maîtriser les dépenses publiques. Les politiques néolibérales des années 1980 ont développé avec force la thématique du « moins d’Etat » et suscité de nombreuses initiatives pour réduire le coût de fonctionnement de l’Etat. Mais plus prosaïquement, c’est la dégradation des finances publiques survenue au début des années 1990 qui a relayé cette vague idéologique et constitué l’élément déclencheur des processus globaux de réforme, notamment au Canada, en Italie, en Finlande et en Suède. Ces contraintes financières ont conduit partout à un examen des finalités, du contenu et de l’utilité des dépenses publiques, ainsi que de l’efficience des structures administratives.
L’examen des programmes lancé en 1994 par le gouvernement canadien constitue l’exemple le plus emblématique de ce type de démarche. Il a consisté à évaluer au premier dollar la pertinence de l’ensemble des dépenses au regard de l’intérêt public afin de réduire le financement des programmes non prioritaires et des unités administratives inefficientes. Cet exercice, loin d’être formel, a produit des économies budgétaires importantes qui ont permis un redressement rapide des finances publiques. Il a aussi favorisé la diffusion de la culture de performance dans les administrations.
La vigueur de l’engagement politique de ces gouvernements s’apprécie mieux si l’on rappelle que certains d’entre eux ont, en deux ou trois ans, réduit de plusieurs points leur déficit public, sans affecter par ailleurs leur potentiel de croissance économique à moyen terme3.
De ces exemples étrangers, deux leçons peuvent être tirées, apparemment de bon sens, mais qu’il n’est pas aisé d’admettre. La première est que la mise en place d’un système de gestion de la performance serait un coup d’épée dans l’eau sans un assainissement des finances publiques4. La seconde est qu’il est indispensable de donner une légitimation politique forte, et pas seulement verbale, à la recherche de l’efficacité de la gestion publique. Ce qui implique en particulier de ne plus considérer comme évident que pour faire mieux, il faut obligatoirement plus de moyens, argument qui est souvent le paravent du corporatisme et du maintien des situations acquises ou l’alibi avancé par certaines structures administratives pour refuser la remise en cause de modes de fonctionnement obsolètes. En d’autres termes, le calcul économique et la recherche de la productivité ne s’arrêtent pas aux portes de l’administration.
Le système de gestion de la performance n’est pas sorti du néant
Le développement de la gestion de la performance s’inscrit dans la continuité de politiques de modernisation de la gestion publique qui ont souvent été engagées de très longue date, parfois depuis les années 1970.
La rénovation des procédures budgétaires a presque partout (sauf aux USA et en Italie) consolidé le redressement des finances publiques. Tous les pays ont opté pour un contrôle global de la dépense. Le modèle budgétaire qui prévaut aujourd’hui est celui d’une chaîne descendante d’enveloppes globales qui après un cadrage macroéconomique, sont fixées au niveau des ministères, puis des agences et des autres organismes publics. A l’intérieur de son plafond qui est parfois pluriannuel, le ministre gestionnaire devient son propre ministre des finances. Il dispose de la latitude de ventiler ses crédits selon ses propres priorités et, innovation importante, il n’est plus astreint à un contrôle détaillé a priori de l’usage de ses crédits. La contrepartie de cette responsabilité nouvelle est bien entendu le strict respect du plafond impératif de dépenses, discipline qui est rigoureusement respectée.
L’identification des centres de responsabilité est la clef de voûte d’un système de gestion de la performance. Elle suppose d’abord un arbitrage explicite entre les activités assumées en direct par l’Etat, transférées aux collectivités territoriales ou sous-traitées au secteur privé. Au sein de l’Etat, on assiste à une séparation effective entre la fonction de conception et de contrôle des politiques qui revient à l’administration centrale et leur exécution qui est transférée à des structures dont les missions et les responsabilités sont clairement définies. C’est le cas des agences au Royaume-Uni ou dans les pays scandinaves. Mais ces agences n’ont pas forcément la personnalité morale comme les établissements publics en France ; il s’agit le plus souvent d’unités administratives employant des fonctionnaires mais bénéficiant d’une très grande autonomie de gestion. Dans cette nouvelle séparation fonctionnelle, les directions d’administration centrale n’exercent plus de tâches de gestion en direct.
Dans le cadre d’un contrat de performance, le responsable de l’« agence » s’engage sur la réalisation de ses objectifs et sur la mise en place d’un contrôle de gestion. En retour, il bénéficie d’une très grande liberté : fongibilité totale des crédits au sein d’une enveloppe globale, suppression des contrôles a priori et très grande latitude dans la gestion des ressources humaines. Ce dernier élément est fondamental pour la réforme. Que les pays soient organisés en termes d’agences ou de ministères, on observe une très forte décentralisation de la responsabilité des politiques de ressources humaines vers l’échelon d’exécution. Qu’il s’agisse de la nature des recrutements, des profils d’emploi, voire dans certains cas des négociations salariales ou d’une rémunération au rendement (qui concerne essentiellement les cadres dirigeants). Cette décentralisation de la responsabilité est même effective dans les pays où les ministères restent forts. C’est ainsi que les Pays-Bas, qui avaient comme nous un ministère de la Fonction publique, ont séparé la gestion de leur fonction publique ministérielle en huit secteurs, considérant que les problèmes de ressources humaines des enseignants ne sont pas les mêmes que ceux des magistrats ou des policiers. Chaque ministre, dans le respect de son plafond de dépenses et d’un cadrage global de la part du gouvernement, négocie sa politique salariale.
Enfin, tous les pays ont consenti des efforts importants et de longue haleine pour rénover l’information comptable et financière et améliorer la connaissance des coûts de l’action publique. L’implantation de systèmes de comptabilité analytique a permis de progresser dans l’évaluation des coûts des structures administratives, mais également par type de programmes et de fonctions assurées par l’administration. L’enrichissement de l’information comptable par des éléments de nature bilantielle est partout en chantier, avec un passage à la comptabilité d’exercice.
L’introduction de la gestion de la performance a bénéficié de l’acquis de ces réformes qui ont défriché le terrain et créé les conditions favorables à son implantation. Le système de gestion de la performance s’est efforcé ensuite de dépasser les problématiques sectorielles de ces réformes, centrées sur des dimensions spécifiques, afin de viser l’efficacité globale de l’action publique.
En définitive, les conditions du succès sont à la fois politiques et techniques. Il s’agit de concilier un projet politique clairement revendiqué, si possible lisible par le citoyen, et ce que j’appellerai une ingénierie de la réforme, c’est-à-dire un pilotage structuré au niveau gouvernemental du développement et de la mise en place des nouveaux outils de gestion.
Les acquis réels de la gestion de la performance
Les systèmes de gestion de la performance sont intellectuellement séduisants et font d’ailleurs l’objet de politiques de marketing particulièrement efficaces qui ont parfois tendance à enjoliver la réalité. Leur véritable impact sur les comportements et les procédures est encore difficile à apprécier. Il est évident en outre que la sophistication des méthodes ne suffit pas à elle seule à garantir un bon service public. On peut prendre a contrario la situation du Royaume-Uni, où l’investissement et l’innovation dans les méthodes de gestion ont été remarquables, mais ne sont pas de nature à compenser des années de sous-investissement dans le secteur public. Ce contre-exemple ne doit pas conduire néanmoins à assimiler, selon une pente bien française, la gestion de la performance au dernier avatar de la pensée libérale : en transposant les méthodes du privé, l’objectif serait de remettre en cause les services publics en ouvrant un faux débat sur leur efficacité.
En réalité, on l’a vu, le système de gestion de la performance n’a pas servi d’outil de régulation budgétaire. Il a certes permis dans certains cas des gains d’efficience ou d’empêcher par des gains de productivité que la contrainte budgétaire détériore la qualité des services. Mais dans tous les pays, les données de performances ne sont utilisées que de manière marginale pour les grands arbitrages budgétaires, sauf pour le pilotage interne des agences.
Les acquis des expériences étrangères résident en fait dans la réalisation de leurs objectifs politiques : améliorer la transparence sur les coûts et la qualité des services publics, renforcer la responsabilité des gestionnaires. Des avancées incontestables ont été réalisées sur ce plan : diffusion progressive d’une culture de résultats et d’évaluation à tous les échelons de l’administration, accroissement de la lisibilité et de la mise en cohérence de l’action publique, rénovation des modalités du contrôle démocratique.
C’est ainsi que la définition des missions et des objectifs explicite la dimension politique de l’action menée par les ministères. Elle s’appuie sur un renouveau de la planification stratégique au sein de l’Etat. Ces plans stratégiques déclinent les programmes mis en œuvre et ont une traduction annuelle dans un plan de performance. Loin d’être un exercice technocratique, ils marquent un véritable engagement personnel des ministres. Au Canada, les rapports sur les plans et les priorités sont associés à la loi de Finances ; au Royaume-Uni, les Public Service Agreements constituent en quelque sorte l’agenda politique du gouvernement pour les trois prochaines années.
La mise en place de nouveaux systèmes d’information sur les coûts et les résultats contribue aussi à la plus grande transparence du débat public. Les indicateurs de qualité de service ont ainsi une place importante dans les contrats de performance. Ces données sont généralement publiques et accessibles sur Internet. Le Royaume-Uni est allé jusqu’à poser l’obligation de publication systématique des résultats des divers échelons de service, y compris locaux (écoles, hôpitaux…)
Mais la conséquence la plus tangible de l’introduction de la gestion de la performance a été la transformation en profondeur de la conception et du contrôle de l’action publique. La clé du dispositif est la confiance et l’autonomie accordées aux gestionnaires administratifs en échange d’engagements sur les résultats. L’importance de leurs nouvelles marges de manœuvre a déjà été soulignée. La suppression de tout contrôle a priori, de nature financière ou juridique, a entraîné la mise en place d’un dispositif complet d’audits comptables et financiers et d’évaluation de la performance. L’obligation de rendre compte, notamment par de véritables rapports d’activité, fait désormais partie de la culture administrative.
En conclusion, si les expériences étrangères sont loin d’être la panacée, elles mettent en lumière les faiblesses du débat démocratique en France sur ces questions et l’urgence d’une rénovation profonde de notre gestion publique.
1 : H. Guillaume, G. Dureau et F. Silvent, Gestion publique. L’Etat et la performance, op. cit. Ce livre a été chroniqué dans le n°401-402 de la revue.
2 : Le concept anglo-saxon d’accountability a constitué un principe directeur des réformes.
3 : On mesure les années-lumière qui séparent ce constat de la culture politique et administrative française. Il est vrai que pour un pays qui n’a pas connu une seule fois l’équilibre de ses finances publiques depuis 25 ans, une réduction du déficit de 0,5 point de PIB apparaît, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, une tâche insurmontable et de nature à susciter un psychodrame national.
4 : Par exemple l’élimination à moyen terme du déficit structurel de l’Etat, c’est-à-dire en éliminant les effets de la conjoncture économique. Pour mémoire, il est de l’ordre de 2% du PIB en France.