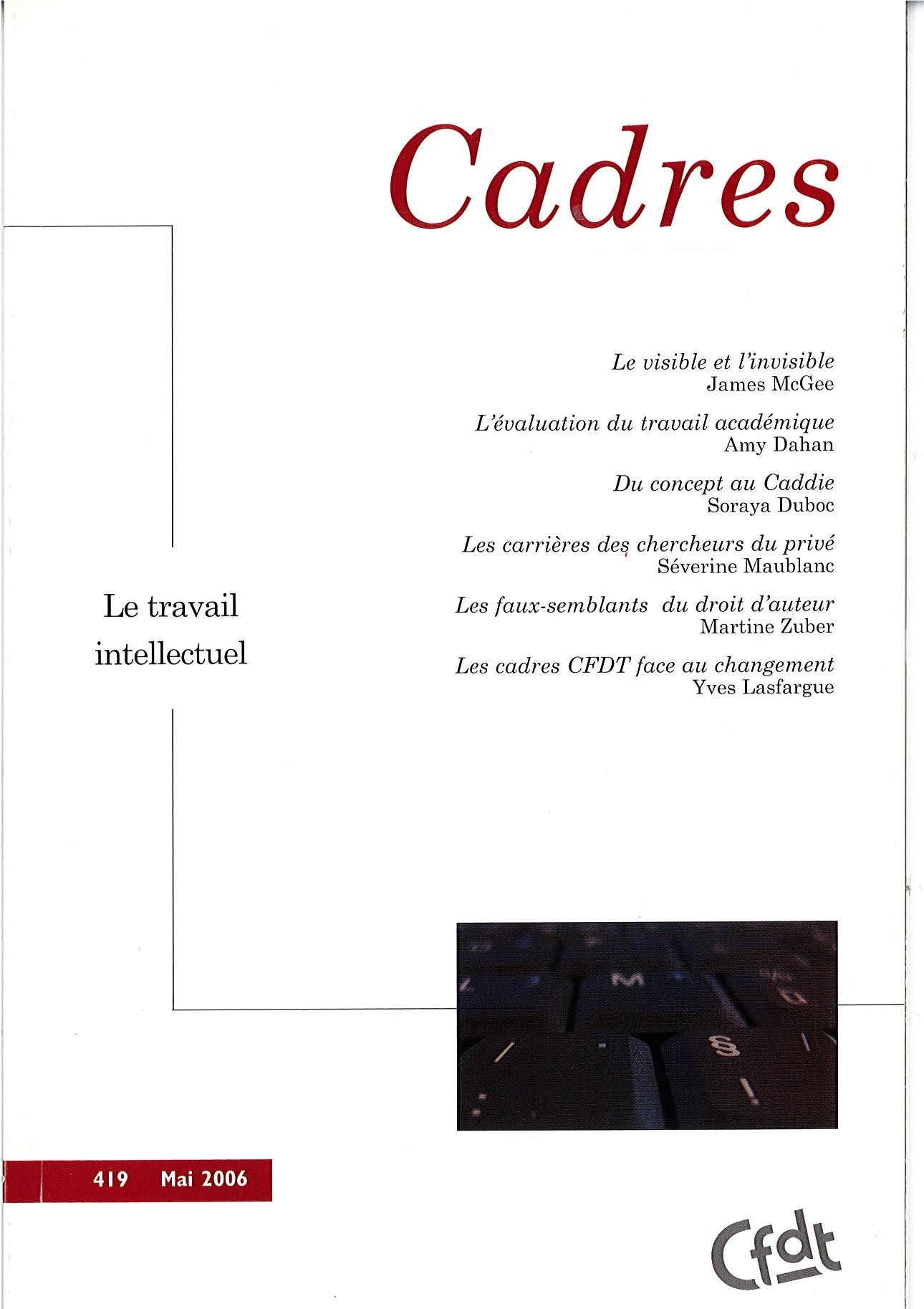Le modèle social français est-il soluble dans la mondialisation ? Revenant sur une « étrangeté française » qu’il avait déjà explorée dans La Logique de l’honneur (Seuil, 1989), Philippe d’Iribarne tente ici une mise en perspective dont l’enjeu n’est ni d’accabler le modèle français, ni de le sacraliser, mais bien d’en saisir la singularité. Si des réformes s’imposent aujourd’hui, si l’idéal républicain ne trouve dans la réalité sociale qu’une caricature de ce qu’il rêverait d’être, ce n’est pas pour autant qu’on peut jeter aux orties le fonds culturel et historique qui lui a donné naissance. Et ce pour une raison très simple : nos manières mêmes de penser, de concevoir des notions aussi universelles que la justice ou la liberté, inscrivent toute réforme, toute « normalisation » dans des codes de comportements, des habitudes sociales et un cadre intellectuel dont on ne sort pas en claquant des doigts. La mise au jour méthodique de cette spécificité se joue dans ce livre à travers un jeu de comparaisons faisant ressortir d’autres modèles, non dans leur universalité mais dans leur différence. Il existe en effet en Europe et dans les sociétés d’origine européenne des conceptions très contrastées de ce qui caractérise le citoyen libre d’une société démocratique : dans l’univers anglo-saxon, c’est le propriétaire libre de négocier sa participation à des oeuvres communes, en Allemagne, le membre d’une communauté qui décide collectivement du sort de tous, en France, celui qui est traité avec les égards dus à son rang. Ces modèles, Philippe d’Iribarne en trace les contours en faisant jouer, dans une culture donnée, les opposés, afin de mieux mettre en valeur ce qui les réunit : le révolutionnaire Sieyès et le démocrate Tocqueville en France, l’universaliste Kant et le nationaliste Fichte en Allemagne, le libéral Locke et le conservateur Burke en l’Angleterre.
Ces différences marquent profondément la vision des rapports de travail. La variété des figures de l’homme libre va de pair avec une égale variété des contraintes, donc des formes de régulation sociale, qui sont jugées supportables. Dans le monde anglo-saxon, on est proche de rapports commerciaux entre un fournisseur (le salarié) et un client (l’entreprise). En France, on n’est pas à vendre, et on exige un statut associé à un ensemble de droits.
La France décrite par Philippe d’Iribarne reste fondamentalement marquée par sa passion pour les hiérarchies, ce qui dans un contexte républicain soumet la société à une tension permanente entre la place qu’elle accorde aux questions de rang et son idéal d’égalité. Elle s’est efforcée de résoudre cette contradiction en donnant à tout le monde un statut qui permette à chacun de se sentir respecté, que ce statut soit petit ou grandiose. La force grandissante des diplômes, les effets de caste bien connu des grandes écoles aussi les hiérarchies traditionnelles au sein des métiers et des corps, illustrent à des degrés divers cette passion française pour le statut. Dans un tel univers, l’irruption d’une logique de marché, une logique « anglo-saxonne » dans laquelle la valeur attachée au statut n’a plus cours, a des effets particulièrement déstabilisateurs. L’une des clés de la réticence française à cette « troisième révolution industrielle » (Daniel Cohen) qu’on appelle aussi mondialisation se trouve donc dans son atteinte à ce statut, entendu non pas seulement au sens des économistes – un statut envisagé comme protection juridique et garantie économique – mais bien plus profondément en un sens sociologique, voire anthropologique : la place que l’on a dans la société, dans le groupe, la dignité attachée à cette place, l’estime et le respect accordés par le corps social à cette dignité.
C’est pourquoi une remise en jeu des statuts, et au-delà des modèles sociaux, ne peut se faire sur une seule base économiste ou gestionnaire. Ni la voie américaine, qui combine un chômage bas et une forte proportion de travailleurs pauvres, ni la solution danoise, dans laquelle la société prend tout le monde en charge mais exige, en retour, des demandeurs d’emploi qu’ils soient prêts à accepter des tâches sans rapport avec ce qu’ils estiment être leur métier, ne semblent praticables dans la société française, marquée par l’opposition perpétuelle entre ce qui est digne et noble, et ce qui ne l’est pas.
Il ne s’agit pas de faire de ces traits un dogme, et d’en appeler à surtout ne rien changer. Mais l’ouvrage de Philippe d’Iribarne a cette vertu d’appeler le réformisme à une forme de réalisme, un réalisme qui est sans sa marque de fabrique sur le plan économique mais ne l’est pas toujours lorsqu’il envisage les réalités humaines et sociales. En l’occurrence, le réalisme sera ici une réelle prise en considération de cette aristocratie égalitaire qui fait la singularité française, et qu’il est trop facile de réduire à du corporatisme. Cela vaut aussi bien pour les réorganisations au niveau des entreprises que pour des réformes plus générales.
Dans les entreprises et les administrations, car comme le montrait Loup Wolff dans un article publié dans notre dernier numéro, quand on passe d’une organisation en six niveaux à une organisation en quatre niveaux, certaines marches deviennent trop hautes, et c’est dans ce cas non pas seulement une aspiration au mieux économique, mais au rang hiérarchique qui se trouve niée.
Pour des réformes d’ensemble, car même s’il est de plus en plus patent que notre société demande à être réformée, que son modèle craque et demande une remise à plat, on ne pourra négocier de nouvelles garanties, de construire de nouvelles solidarités et de sécuriser les parcours en tenant pour négligeable cette passion française pour les titres, le rang, le respect. Il s’agit aussi bien pour nous de l’identifier comme une contrainte, que d’être capable de formuler différemment ses enjeux ; non à la façon rudimentaire de certaines organisations syndicales arc-boutées sur le seul statut, mais en étant capable de faire résonner dans la « promesse » de nouvelles sécurités ou solidarités une dimension de statut. A la fois sous la forme de garanties, d’un « socle » sur lequel chacun puisse monter, et sous la forme d’un espoir – celui d’une amélioration, de ce que l’économie fordiste nommait carrière et que l’on pourrait aujourd’hui définir comme des possibles.
On ne le sait que trop, l’identité ouvrière est aujourd’hui en défaut, ce « statut » imaginaire, cette appartenance qui permettait de tenir son rang, d’appartenir à une caste et d’être fier de cette appartenance. La question aujourd’hui touche en fait à la « classe moyenne », cette identité sociale qui fut majoritaire et dont on peut se demander aujourd’hui si elle n’est pas menacée. Qu’en est-il de ces espoirs, qui à en croire Thomas Friedman (The World is Flat. The Globalized World in the Twenty-First Century, Penguin, 2006) sont bien davantage encore que la situation économique la marque de la classe moyenne ?
Si certains statuts étouffent, si leur logique est devenue discriminante, l’idée même du statut, l’espoir du statut ou du rang reste une donnée de base de la société française. On ne la réformera pas sans parler son langage.