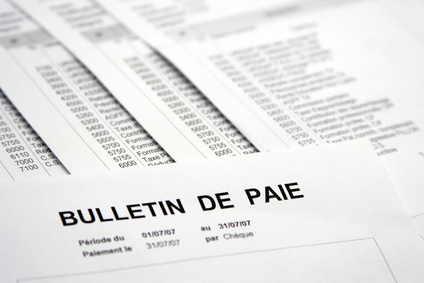Car, pour lui comme pour Mounier, l’existence ne prenait sens que par la constante recherche de l’accord entre convictions et pratique. Lorsqu’il définit l’éthique comme « le souhait de vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes », c’est bien la règle de sa propre vie qu’il énonce. Pour l’avoir rencontré un certain nombre de fois, à Quimper et à Châtenay-Malabry, je dois dire qu’il m’a toujours impressionné par sa modestie et son extrême attention à l’autre selon la maxime de son ami Lévinas : « Avant le cogito, il y a le bonjour ! » A la différence de tant de « grands intellectuels » stratosphériques, Ricœur se montrait soucieux du petit détail, souvent de forte portée symbolique. « Ce qui me frappe dans tous les petits services quotidiens, dans les rencontres de toutes espèces, les dîners, les conversations, c’est l’absence complète de relations de domination […]. De cela résulte une impression de service joyeux, comment dirais-je, d’obéissance aimante qui est tout le contraire d’une soumission et tout le contraire d’une errance1 ». Il aimait raconter que s’étant rendu chez Jean Nabert, le philosophe admiré, dans sa maison de vacances de Loctudy, il avait trouvé porte close. « Eh bien, pour me consoler j’ai cueilli quelques… pensées en fleur dans son jardin ». Et il éclatait d’un rire juvénile avec une pointe d’espièglerie. Ou encore, ce souvenir de mai 68 à Nanterre dont il avait accepté d’être doyen sans jamais avoir posé de candidature et où il sera coiffé d’une poubelle par un étudiant qui, 20 ans plus tard, lui demandera pardon et, bien sûr, l’obtiendra. Cohn-Bendit l’apostrophe au cours d’une assemblée générale : « Ricœur, d’où tirez-vous votre pouvoir ? » Et lui de répondre, non sans dit-il « avoir été décontenancé » : « Eh bien, je tire mon pouvoir de ce que… j’ai lu plus de livres que vous ! » Et ajoutait-il dans un merveilleux rire en cascade : « Il n’a rien trouvé à répliquer ! » Ainsi était-il. Et il me semble que cette sagesse lui venait de sa capacité à se décentrer pour se placer dans une disposition d’accueil et d’étonnement permanent qui se retrouve de bout en bout dans son œuvre. « Le bonheur, dira-t-il, c’est l’admiration ». Sans doute était-ce là, avec sa foi profonde matrice de confiance, l’une des sources de sa joie si légère, si communicative. J’ai rencontré peu d’hommes aussi joyeux.
Son œuvre océanique2 est tout entière portée par le souci de penser l’« être humain comme être agissant et souffrant » dans sa « fragilité, entre un pôle d’infinitude et un pôle de finitude ». Car il s’agit bien de saisir l’homme en situation, dans l’épaisseur de son monde tel qu’il lui est donné à assumer et à transformer. Ce qui le conduit à reprendre les intuitions de Mounier sur la « personne » comme « centre d’orientation du monde objectif » en les déplaçant sur le terrain de l’identité. Il n’a cessé de creuser l’énigme du « je » au cœur de la philosophie réflexive : quand je dis « je », qu’est-ce que je sous-entends ? Immense question qui l’amènera, dans un inlassable dialogue sous tous les horizons, à s’interroger sur le statut du langage, du temps, de l’histoire et de la mémoire comme lieu de déploiement de ce qu’il nomme « l’identité narrative » qui fait que chacun reste soi-même alors même qu’il change au fil du temps. Comme si l’identité se frayait un chemin dans un jeu de tensions d’une infinie complexité liée à la distance intérieure qui nous fait déjà percevoir Soi-même comme un autre3 à l’obsédant écart de l’altérité exposée au risque du mal interindividuel mais aussi économique ou politique. Aucun aspect de l’existence individuelle et collective n’a échappé à sa vigilante attention conformément à l’exhortation de son maître de khâgne, au lycée Chateaubriand de Rennes : « Ricœur, lorsque vous rencontrez un obstacle ne le contournez jamais. Affrontez-le ». Et c’est ainsi qu’il en viendra tardivement, à près de 70 ans, à s’intéresser au droit et à la justice et à leur consacrer des textes majeurs une fois encore marqués du sceau de cette admirable honnêteté intellectuelle qui n’a cessé de l’amener à argumenter pour rendre raison de ce qu’il pensait être la vérité d’une situation, d’un événement, d’une dimension de la condition humaine. Dans l’exercice intellectuel comme dans son existence, il ne cessait de s’étonner et c’est ce qui conférait à son approche sa fraîcheur, son originalité et sa puissance d’entraînement. Lorsqu’il parlait, sans nul effet rhétorique, il faisait naître le silence par la justesse, l’obstination et la force de vérité de sa parole.
Il n’a d’ailleurs cessé de s’étonner de la puissance de cette parole dont il a défendu les droits dans un article d’une étonnante actualité paru dans Esprit en 1953. Il s’intitulait « Travail et parole4 ».
Il s’interroge sur la pertinence et la légitimité de la notion de « civilisation du travail » élaborée dans l’enthousiasme par l’économiste H. Bartoli et le sociologue G. Friedmann. Le souci de ces auteurs est de restaurer le travail humain dans sa grandeur et sa centralité à la fois comme valeur fondatrice et creuset d’un être-ensemble renouvelé contre l’emprise de la machine et du mode de production taylorien.
Paul Ricœur accueille avec sympathie « la découverte ou la redécouverte de l’homme comme travailleur » dans laquelle il voit « l’un des grands événements de la pensée contemporaine ». Mais, c’est pour immédiatement s’inquiéter de la menace d’un pan-travaillisme qui conduirait à reconnaître au travail une valeur et une place excessives finissant par inclure pratiquement toutes les activités en tant qu’elles supposent un travail, y compris celles qui en paraissent les plus éloignées dans le loisir, la méditation, la contemplation. « La notion de travail s’enfle, écrit-il, jusqu’à englober toutes les activités scientifiques, morales et spéculatives et tend vers la notion très indéterminée d’une existence militante et non contemplative de l’homme […]. Cette apothéose du travail m’inquiète. Une notion qui signifie tout ne signifie plus rien », au risque d’un complet brouillage des catégories au profit de la logique du « faire », de la fabrication comme si l’homme était en tout « faber », voué à la seule utilité.
Cette critique de l’impérialisme du travail ouvre la voie à celle que développera Hannah Arendt dans son grand livre Condition de l’homme moderne. Elle se demande si son contemporain, à dominante homo faber et peut-être simplement homo laborans c’est-à-dire dépendant du travail placé au cœur de sa condition est encore capable de s’en détacher pour se tourner vers la vita contemplativa, vers des pans d’existence non voués au faire, à la possession et à la transformation des choses – la poiësis – , mais au contraire tournés vers la contemplation de l’être, la gratuité dans la disponibilité. Son pronostic est pessimiste : « C’est l’avènement de l’automatisation qui en quelques décennies probablement videra les usines et libérera l’humanité de son fardeau le plus ancien et le plus naturel, le fardeau du travail, l’asservissement à la nécessité... Il semblerait que l’on s’est simplement servi du progrès scientifique et technique pour accomplir ce dont toutes les époques avaient rêvé sans jamais pouvoir y parvenir ». Mais « le souhait se réalise comme dans les contes de fées au moment où il ne peut que mystifier. C’est une société de travailleurs que l’on va délivrer des chaînes du travail et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté [...].Ce que nous avons devant nous c’est la perspective d’une société de travailleurs sans travail c’est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire5 ».
Pourtant les voies d’Arendt et de Ricœur divergent assez nettement. Arendt pense vita activa et vita contemplativa sur un mode d’extériorité, d’antagonisme, d’exclusion réciproque. C’est l’une ou l’autre, c’est le travail ou le non-travail étant entendu que pour elle, on l’a compris, l’idéal se situe du côté de la vie contemplative, émancipée de la nécessité comme à Athènes dont les citoyens étaient interdits de travail.
L’analyse de Ricœur est moins radicale. Elle ne vise pas à limiter du dehors le travail par la parole comme s’il s’agissait de deux sphères étrangères l’une à l’autre. Elle n’accorde pas non plus de privilège absolu à la vie contemplative. D’abord parce que ce contre-pôle du travail lui semble par trop « vague, chimérique et extérieur à la condition humaine ». Ensuite, parce qu’une telle vue lui semble imprégnée d’un aristocratisme qu’il ne partage en rien.
En réalité, « il n’y a pas un règne du travail et un empire de la parole qui se limiteraient du dehors, mais il y a une puissance de la parole qui traverse et pénètre tout l’humain, y compris la machine, l’outil et la main ».
Mais alors comment le travail et la parole s’articulent-ils ? Pour l’essentiel, Ricœur défend l’idée que si la parole n’est pas étrangère à la sphère du travail, elle ne saurait s’y réduire.
Car si la parole relève aussi de l’ordre de l’efficacité (et plus que jamais dans la société d’information et de communication), jamais elle ne coïncide totalement avec l’action. Parce qu’elle est toujours en « excès » (thème cher à Ricœur), elle la déborde et « file devant », légère, sauvage à la fois critique, corrosive mais aussi anti-cipatrice et inventive. Toujours inattendue, surprenante, importune, sauvage, elle dit la liberté humaine. « La culture, insiste Ricœur, c’est aussi ce qui désadapte l’homme, le tient prêt pour l’ouvert, pour le lointain, pour l’autre, pour le tout ». Ne pas oublier qu’« une civilisation qui perd cette sorte de respiration entre la fonction critique et poétique de la parole et la fonction efficace du travail est condamnée à terme à la stagnation ».
Une réflexion dont l’actualité, dans l’entreprise comme ailleurs, saute aux yeux.
1 : Conférence donnée en 2000 à l’Association Ad Homines / Conversations essentielles.
2 : Pour découvrir l’homme et l’œuvre, cf. P. Ricœur, La critique et la conviction, Entretiens, Calmann-Lévy, 1995 ; O. Mongin, P. Ricœur, Seuil, 1994; F. Dosse, P. Ricœur. Les sens d’une vie, La Découverte, 2001.
3 : Seuil, 1990.
4 : Janvier 1953, repris dans Histoire et vérité, Seuil, 1955, p. 210sqq.
5 : Condition de l'homme moderne, Calmann-Lévy, 1961, p. 11.