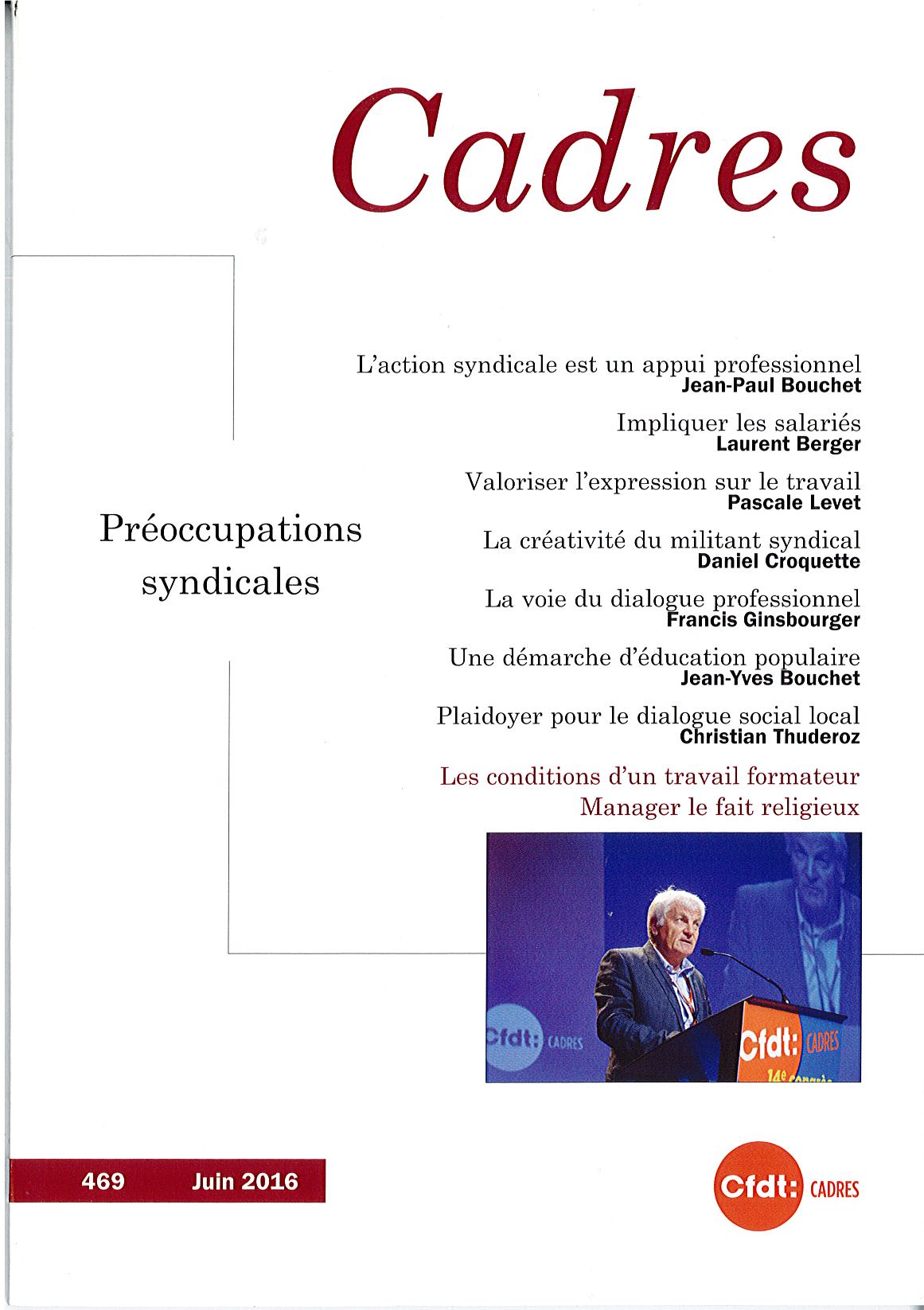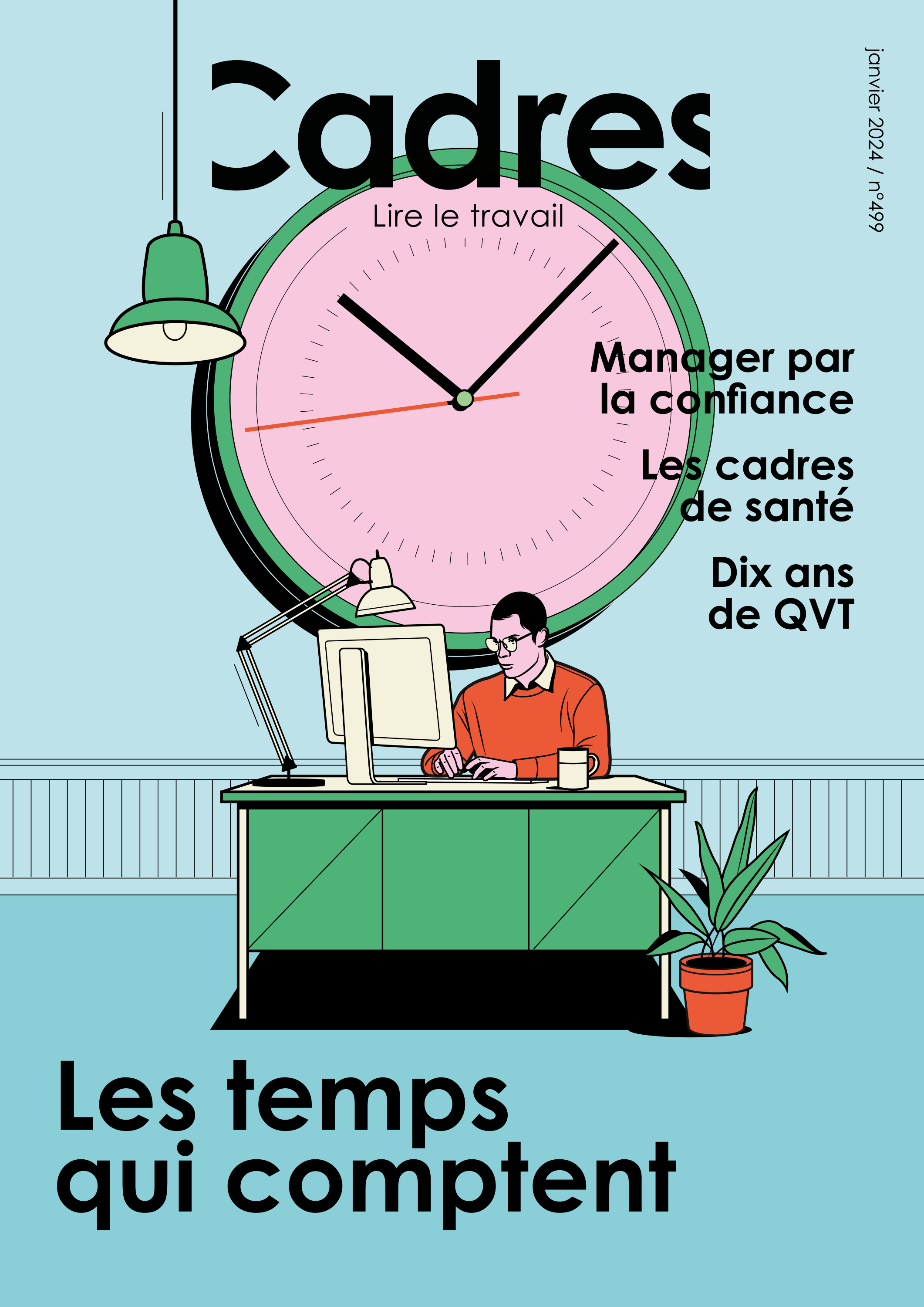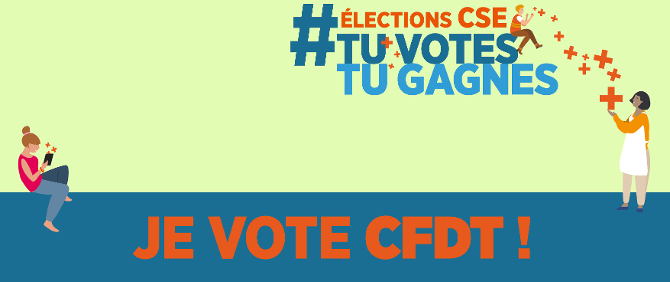Les organisations productives (de biens ou de services, secteur public ou concurrentiel) laissent moins d’autonomie à leurs salariés qu’elles ne le prônent pourtant vigoureusement. On a beaucoup parlé des injonctions contradictoires que subissent les salariés, des changements incessants d’organisation, des tensions entre la prescription du travail et sa réalité, mais également de réduction des questions organisationnelles sur des problèmes interpersonnels.
L’exigence de performance économique envisage le travail d’abord comme un coût et l’emploi comme une variable d’ajustement. Le souci des conditions de travail est celui des conditions d’emploi, ce qui n’est pas tout à fait une mise en discussion sur le travail. On peut dire que l’emploi supplante le travail.
La négociation sur le travail a pourtant connu ces toutes dernières années un certain regain dans les entreprises. D’abord canalisée en grande partie dans le champ des risques psychosociaux, du stress et de la souffrance au travail, cette orientation a posé de nombreuses questions de fond : comment en est-on arrivé à être si démuni sur les questions du travail ? Faut-il miser sur la souffrance et le catastrophisme pour développer des revendications susceptibles de faire entendre la voix du travail ? Comment renouveler la négociation sur le travail sachant que l’organisation tend à rester l’objet de la prérogative privée de l’employeur ?
Depuis les années quatre-vingt-dix, les sujets de négociation foisonnent et intègrent de nouveaux ingrédients tels que la santé psychique, donnant lieu à une sorte de « dérive hygiéniste et compassionnelle » (Yves Clot). Ce déport sur l’individu se déplace depuis quelques années sur l’enjeu de la parole. On engage résolument les entreprises à négocier, en partant de l’hypothèse que l’expression de la souffrance et des risques psycho