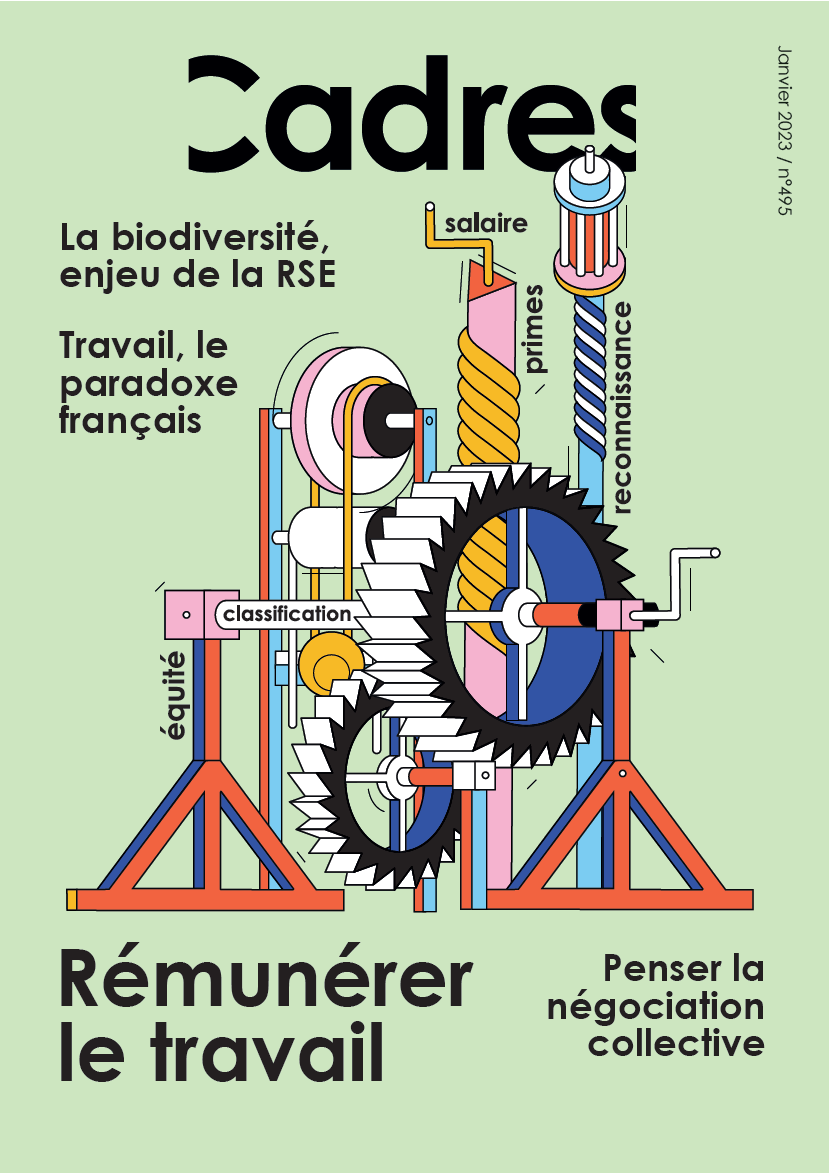Deux qualifications opposées du travail mettent en avant respectivement sa fonction instrumentale (monétaire) et sa valeur expressive (non monétaire)[1]. Le travail conçu comme un moyen et non comme une fin caractérise l’engagement de l’énergie individuelle dans des conditions physiques et psychologiques plus ou moins difficiles : le revenu qui en est tiré est le prix et la compensation de l’effort. À l’inverse, pour être porteur de sens, au-delà de sa valeur instrumentale, le travail doit permettre la réalisation de soi par l’acte productif. La sémantique du travail exprime cette dualité quand elle oppose le labeur à l’œuvre, la charge à l’accomplissement.
Il paraît aisé de définir la valeur négative du travail comme cet ensemble de contraintes et d’efforts pénibles qui entravent la libre disposition de soi, et qui usent l’individu. Il est moins facile de définir la valeur d’autoréalisation personnelle par le travail. Dans le passé, une solution avait été proposée quand il s’était agi de promouvoir l’émancipation sociale par le travail plutôt que par les loisirs À partir de la fin du xviiie siècle, l’essence même du travail avait été localisée par les philosophes et par les penseurs du progrès social (Hegel, Saint-Simon, Fourier, Marx, notamment) dans sa nature productive, dont le travail créatif était considéré comme la quintessence. Le travail créatif est celui qui échappe à la routine et dont le résultat est, au moins partiellement, imprévisible. C’est dans cette mesure que le travail doit pouvoir apprendre à chaque individu de quoi il peut être capable et en quoi son activité détient en elle-même un potentiel formateur. Aujourd’hui, le principe de l’autoréalisation individuelle est largement identifié à une somme de paramètres de bien-être au travail et de qualité de l’emploi, dont l’importance varie tant selon les préférences et les compétences des individus que selon les métiers et les types d’entreprise. On trouve une caractérisation de ces paramètres dans les grandes enquêtes nationales et internationales sur les conditions de travail et dans les études et sondages qui évaluent la désirabilité des différentes professions[2].
Un troisième niveau de signification a été ajouté au concept de travail à partir de la fin du xixe siècle, avec le développement du modèle de l’État-providence, et avec l’allocation progressive des moyens de protection sociale et des droits attachés aux relations de travail. Cette doctrine « welfariste » proclamait que le travail est le vecteur de la prospérité humaine, principalement à travers ce que procure la croissance économique, l’évolution des revenus, les carrières salariales, le pouvoir de consommer par-delà ses besoins primaires, et l’allocation des biens sociaux essentiels (santé, éducation, sécurité, gestion des âges).
Mais peut-on empiler les trois dimensions instrumentale, expressive et sociale du travail aussi simplement que trois stades d’évolution qui cumulent leurs effets ? L’interaction des deux premières dimensions semble à première vue assez évidente. Le contenu ou la fonction instrumentale (monétaire) et expressive (non monétaire) du travail sont positivement corrélés, comme le résume Galbraith : « Ceux qui aiment le plus travailler sont, notons-le, presque universellement les mieux payés. C’est accepté. »[3] Cependant, cet alignement de la quantité et de la qualité du travail avec sa rémunération a ses propres limites. L’approche welfariste du travail peut-elle corriger ou contrebalancer l’effet hiérarchique de la corrélation entre les valorisations instrumentales et expressives du travail ? Pour répondre, examinons le modèle français : qu’on puisse s’appuyer sur cet examen et en tirer des leçons pour parvenir à une compréhension plus générale de la valeur actuelle et future du travail peut être discuté, bien sûr, si l’on considère, comme nous autres Français le faisons nous-mêmes si volontiers, qu’il y a une exception française, et que c’est en tant que telle qu’elle vaudrait modèle.
À l’examen, ce modèle français renferme, de fait, un paradoxe souvent souligné. Selon l’indice « Better Life » de l’OCDE, les Français déclarent disposer d’un niveau de bien-être qui paraît comparativement enviable. Pourtant, il existe un sentiment français d’insatisfaction permanente, qui engendre des tensions et des changements politiques ainsi que des appels récurrents à des « réformes structurelles », c’est-à-dire radicales, notamment dans le contexte de la zone euro[4]. Ce paradoxe est notamment ancré dans l’attitude à l’égard du travail. Selon de nombreuses enquêtes internationales, les Français font en effet partie de ceux qui attachent le plus d’importance au travail et qui le considèrent comme un moyen d’épanouissement personnel. Dans le même temps, ils comptent parmi ceux qui souhaitent lui consacrer le moins de temps, et qui expriment une forte insatisfaction à l’égard des salaires et des perspectives de carrière. Distinguons quatre approches possibles de ce paradoxe français.
Le travail en quantités
S’agissant de l’interaction entre le sentiment de bien-être et la valeur accordée au travail, la première caractéristique du modèle français est la réglementation du temps de travail et de l’âge de la retraite. Le nombre annuel moyen d’heures travaillées par les salariés à temps plein en France est le plus faible de l’Union européenne. Mais c’est exactement l’inverse concernant les indépendants non-salariés. Par ailleurs, l’âge moyen des travailleurs français qui quittent le marché du travail et prennent leur retraite reste parmi les plus bas de la zone OCDE. Les comparaisons ont certes leurs limites et les arrangements sociaux et politiques sur le travail et l’emploi varient beaucoup selon les pays : pour ne citer qu’un exemple, le temps partiel, notamment féminin, est une évidence non problématique aux Pays-Bas alors qu’il est rejeté comme discriminatoire plus au nord de l’Europe. Et la place que prend l’État dans l’organisation des rapports sociaux et économiques du travail (la part des emplois publics, la complexité du droit du travail, la demande de protection face aux crises) est très variable dans les espaces géographiques sur lesquels sont déployées les comparaisons.
Il reste que l’Europe, avec sa construction politique et socio-économique si laborieuse, est un espace permanent de comparaisons, et que la question revient sans cesse : y a-t-il une « ontologie sociale » européenne ou n’y a-t-il que des « ontologies sociales » nationales qui alimenteraient des écarts élevés, voire grandissants, dans la gestion des protections sociales et, pour ce qui nous concerne ici, dans le rapport au travail ?
Le dualisme du marché de l’emploi
Le modèle français a cherché à écarter le « modèle » du travailleur pauvre, celui des actifs évoluant au voisinage du seuil de pauvreté. Le salaire minimum est parmi les plus élevés des pays de l’OCDE et, au cours des 25 dernières années, il a augmenté plus vite que le taux d’inflation. La France a en effet une politique redistributive qui réduit les inégalités de revenus et qui parvient à limiter la part des personnes sous le seuil de pauvreté. Le modèle est celui d’une compression des salaires qui résulte de deux mécanismes distincts. Pour la partie inférieure de la distribution des salaires, le niveau élevé du salaire minimum a considérablement réduit l’inégalité entre les premiers déciles. Pour la partie supérieure de la distribution, c’est le rendement des diplômes et des compétences qui est comprimé. Il en résulte une insatisfaction à l’égard des salaires, notamment de la part de celles et ceux qui ont fait des études longues. Ce que l’on appelle la fuite des talents est entretenu par ce rendement déséquilibré de l’investissement éducatif.
On s’inquiète désormais de plus en plus de la place que peut prendre le modèle des travailleurs pauvres en France, et du coût des dispositifs de soutien pour l’amortir. La polarisation du marché du travail ouvre la voie à une inégalité structurelle croissante. Les emplois se concentrent aux deux extrémités : emplois qualifiés et bien rémunérés dans les secteurs innovants ; emplois non qualifiés et mal rémunérés dans les services plus traditionnels. Dans les pays de l’OCDE, le chômage atteint principalement les individus faiblement qualifiés. Pour augmenter le taux d’emploi et réduire le taux structurel de chômage, il faut donc créer des emplois faiblement qualifiés, notamment dans les services. Or ces emplois sont à faible salaire. Ce qui suggère que si on crée de l’emploi faiblement qualifié à bas salaire, les inégalités de revenus vont augmenter. C’est ce qu’on peut appeler la « malédiction d’un fort taux d’emploi » : susciter un niveau d’inégalité plus élevé pour obtenir un taux d’emploi plus important. Cette malédiction peut-elle être évitée ? Il apparaît que la plupart des pays de l’OCDE qui ont un taux élevé d’emploi et de faibles inégalités de revenus après redistribution (Scandinavie, Autriche, Pays-Bas) sont dotés non seulement d’importantes politiques redistributives, mais aussi d’une main-d’œuvre mieux formée, en raison de meilleurs systèmes éducatifs et de systèmes plus efficaces de formation professionnelle et de formation continue.
Un chômage qui baisse lentement
Notre haut niveau de protection sociale, comparativement aux autres pays de l’OCDE, devrait atténuer les inquiétudes. Au contraire, lorsqu’on leur demande s’ils sont confiants dans leur capacité à conserver leur emploi au cours des prochains mois, les Français sont parmi les plus nombreux à répondre qu’ils ne le sont pas. Certes, le chômage en France est élevé depuis trois décennies. Pourtant, il frappe principalement les personnes peu qualifiées, dans une plus large mesure qu’aux États-Unis ou au Royaume-Uni, en raison du rejet français du « modèle » des travailleurs pauvres. Et dans le même temps, les allocations de chômage et la durée d’indemnisation du chômage restent encore parmi les plus élevées d’Europe.
La combinaison d’une législation stricte en matière de protection de l’emploi et d’une assurance chômage un peu plus généreuse a favorisé une forte dualité qui oppose les insiders (les titulaires de CDI bien insérés dans des carrières assez stables) aux outsiders (CDD, intérimaires, travailleurs aux carrières discontinues) sur le marché du travail. Une caractéristique frappante de cette structure dualiste est le modèle français de « flexicurité » : des travailleurs en nombre croissant, principalement des travailleurs non qualifiés et des travailleurs des services, alternent des emplois de courte durée avec des périodes de chômage indemnisées, comme le permet le dispositif d’activité réduite des demandeurs d’emploi. En conséquence, la catégorie des travailleurs en chômage récurrent a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie.
Des relations professionnelles trop rigides
La comparaison internationale des systèmes de management et des relations professionnelles montre que le score global de la France en matière de qualité du management n’est pas mauvais, mais que le sens de la hiérarchie et de la centralisation y favorise certainement une atmosphère de confrontation dans les relations de travail[5]. L’organisation particulière des relations sociales y contribue. La France a l’un des taux de syndicalisation les plus faibles de l’OCDE et pourtant l’un des taux de couverture salariale et de négociation collective les plus élevés, en raison de la procédure d’extension qui entraîne l’application générale des conventions collectives. Cela a un impact sur la manière dont les syndicats se comportent : ils adoptent principalement un mode d’action conflictuel. Or nous savons que de meilleures relations de travail, plus coopératives, ont une corrélation positive avec le taux de syndicalisation.
Quelles voies pour dépasser ce paradoxe ?
Face aux quatre composantes de ce que nous avons désigné comme un paradoxe français, quelles sont les options qui s’offrent aux actifs ? Transposons à notre enquête les termes de la typologie fameuse d’Hirschman : « exit, voice and loyalty ? »[6].
-
Voice
L’option « voice » consiste à protester et à exiger de pousser sur tous les leviers qui font la singularité de la société salariale française, en allant plus loin dans la réduction de la quantité travaillée (dans la semaine, dans l’année et au long de la vie professionnelle), en augmentant fortement le salaire minimum, en comprimant davantage encore les écarts de revenus du travail, et en investissant massivement dans l’enseignement public, mais sans en réformer la gestion. Elle se double désormais d’une variante, l’injonction à la décroissance, qui met directement en tension le revenu tiré d’activités productives et le niveau de vie individuel et collectif, d’un côté, et les arguments de bien-être obtenus par la compression du travail et l’expansion du loisir, de l’autre. Dans sa forme la plus simplificatrice et la plus politisée, cette option est populiste.
-
Exit
Quant à l’option « exit », elle consisterait à transformer radicalement la société salariale, ce qui peut prendre deux formes différentes : celle du basculement vers le travail indépendant, non salarié, ou vers une forme encore inexistante de salariat désubordonné, et celle de l’invention d’un État-providence transformateur qui engloberait le travail salarié et le travail indépendant. Que contient le travail indépendant pour qu’il soit mentionné ici ? Il permet d’approfondir le débat sur la valorisation du travail dans un contexte d’autonomie, de travail à distance, et de recherche de sens dans l’activité, mais en faisant apparaître les contreparties de la plus grande autonomie.
D’un côté, la construction de la protection sociale et la préservation de la rémunération individuelle contre les fluctuations à la baisse de l’activité de l’entreprise ont consolidé l’expansion du salariat, du moins dans la modalité typique du contrat d’emploi à durée indéterminée. Mais quand la subordination salariale se réduit à l’assignation rémunérée à des tâches fortement routinières, que l’horizon d’évolution dans une carrière est trop limité, et qu’une polarisation croissante des qualités et des quantités de travail augmente les risques de fragmentation du continent salarial, un nombre croissant d’actifs s’interrogent sur la contrepartie du lien de subordination salariale ; pour eux, la chance s’éloigne d’obtenir de leur travail la promesse d’un développement personnel, qui ne se trouve que dans la variabilité des tâches et la valeur formatrice de la diversité de celles-ci. L’autre voie de l’alternative ressurgit : comme le montrent les grandes enquêtes internationales, les individus au travail veulent plus d’autonomie. Mais vont-ils jusqu’à l’autonomie la plus complète, en exerçant une activité en indépendant ? Nous n’examinons pas ici la situation du nouveau précariat des non-salariés faiblement qualifiés, dans l’économie des services à la personne, mais l’indépendance dans les métiers qualifiés.
Le travail qualifié non salarié est par définition autonome, plus exigeant en compétences multiples, et plus formateur. Il place le professionnel dans un horizon long de développement, tant que son activité est soutenable. Mais, par définition aussi, le travail indépendant est plus risqué économiquement. Chaque indépendant comprend immédiatement les dimensions de ce risque personnel d’échec et d’interruption de son activité. Sa rémunération et ses chances de persister dans l’activité indépendante et entrepreneuriale sont directement fonction de sa position sur un marché de biens ou de services, de l’intensité de la demande et de l’intensité de la concurrence pour le type de production ou de prestation qu’il propose, de sa quantité d’effort, du niveau et de la vitesse d’obsolescence des compétences qu’il a acquises dans et depuis sa formation initiale, de la valeur de l’expérience qu’il accumule, de sa capacité à mobiliser continûment des capitaux d’investissement et des ressources, souvent familiales, de soutien, de son état de santé, et de facteurs aléatoires (une bonne ou une mauvaise conjoncture générale, des innovations transformatrices ou destructrices, des crises sanitaires, etc.). Le résultat d’ensemble est connu. Nous savons que la dispersion et la variabilité des revenus sont plus élevées, et de loin, dans la population des indépendants. Nous savons aussi que l’intensité du travail dans le travail indépendant est beaucoup plus élevée, tout comme l’emprise du travail sur la vie personnelle.
Voici donc l’équation de l’activité indépendante qualifiée : un travail plus autonome, plus formateur, plus attractif, plus intense et plus risqué. C’est la combinaison de ces facteurs de signes différents qui explique que le travail indépendant, si séduisant qu’il apparaisse, n’a pas fait retour massivement pendant que le continent salarial commençait à se fragmenter. Les préférences, les inégalités de ressources, l’attitude envers le risque, la tolérance plus ou moins élevée à l’effort agissent pour limiter l’expansion de l’indépendance. Il faut alors retourner le questionnement : comment expliquer la persistance des indépendants à demeurer indépendants ? À quoi les indépendants acceptent-ils de renoncer pour s’affranchir de la subordination et pour augmenter leurs chances de donner du sens à leur travail ?
-
Loyalty
Le comportement « loyalty » est réformiste et prône la confiance dans le modèle français tout en plaidant pour son adaptation. Cette adaptation n’est pas une solution de facilité, car les défis sont multiples : élever graduellement la quantité totale d’emploi et de travail tout en reconstituant des carrières salariales, décentraliser les relations et les négociations de travail, soutenir l’esprit d’entreprise, investir dans une meilleure gestion de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, instaurer la confiance dans un jeu social qui ne soit plus de totale et omniprésente confrontation mais qui devienne un jeu à somme positive si un niveau plus élevé de croissance structurelle augmente le bien-être collectif, sous les conditions nouvelles de soutenabilité de cette croissance, et si un lien tangible peut être retissé entre croissance, innovation et mobilité sociale. Il s’agit là de défis majeurs qui font débat depuis longtemps : leur intérêt est nié dès qu’on leur applique la grille protestataire des relations sociales. Cette voie réformiste et gradualiste est parcourue par à-coups, au gré des oppositions suscitées par le réflexe qui assimile toute transformation sociale à un jeu à somme nulle, où il n’existe que des gagnants et des perdants.
Autonomie, donation de sens, prise de risque, sécurité : peut-on les conjoindre ?
Il y a quinze ans, j’ai publié un petit livre, Portrait de l’artiste en travailleur[7], qui peut être lu aujourd’hui comme l’exploration d’une activité qui est plus formatrice, plus variée, moins prescrite que le travail subordonné sans qualités, mais qui est aussi plus exposée à l’imputation personnelle d’échec. En généralisant, on remarquera que les métiers qui, dans les enquêtes sur la valeur du travail, sont jugés comme les plus désirables, et parmi lesquels figurent les professions artistiques, ne sont certainement pas les mieux payés, même si ce n’est vrai qu’en moyenne, puisque les écarts de gains entre les professionnels y sont considérables. Pour comprendre l’attractivité des métiers et des formes d’activité qui imposent des arbitrages individuels entre l’autonomie, le revenu, le risque d’échouer, le développement de soi et la nature formatrice d’une activité non routinière, il faut entrer dans le labyrinthe de ce qu’on appelle les « différences compensatrices » et dont le résumé le plus simple est donné par l’espérance d’utilité du revenu. La notion s’applique à ces situations professionnelles imprégnées d’incertitude sur leur évolution. Elle désigne la valeur (l’utilité) attachée au revenu monétaire qui est attendu au long du cycle de vie professionnelle, moyennant un coefficient d’incertitude qui conduit à pondérer la valeur de ce revenu par les probabilités de l’obtenir. C’est par la comparaison avec un flux de revenu certain que l’on obtient le prix implicite de la valeur expressive (l’utilité non monétaire) du travail exercé.
Ce que nous apprennent l’analyse du travail indépendant et sa comparaison avec le travail salarié ne peut pourtant pas se résumer à un raisonnement sacrificiel qui retournerait la formule attachée à la définition purement négative et instrumentale du travail (« perdre sa vie à la gagner ») et qui affirmerait l’excellence d’un nouveau principe, en quelque sorte frugal : « accomplir sa vie au risque de ne pas pouvoir la gagner autant qu’on le voudrait ». Dans le travail indépendant, l’horizon de l’activité et de ce qui en est attendu et obtenu est très différent de celui du travail salarié. La quantité d’heures travaillées, certes très supérieure chez les indépendants, est évaluée très différemment dès lors que l’activité est située dans un horizon d’accumulation. L’évaluation du travail est le produit du mécanisme positif d’implication – il existe des gains cumulatifs à l’engagement durable dans l’activité autonome – et du mécanisme contraignant d’emprise – on n’organise pas le rythme, la pression, la discontinuité, les temps de suspension dans le travail indépendant comme dans une vie rythmée par des règles conventionnelles et légales d’emploi. Au total, quand l’expérience et l’implication dans le travail indépendant cumulent leurs effets, le rendement de l’ancienneté professionnelle est plus élevé pour les indépendants que pour les salariés, une fois contrôlées les chances de maintien dans l’activité indépendante.
Peut-on rapatrier dans l’horizon du salariat les dimensions les plus attractives du travail indépendant ? L’une des réponses tient à l’organisation des carrières professionnelles, pour conserver cette valeur essentielle d’un horizon de développement individuel. Mais faire carrière aujourd’hui ne se résume plus à une accumulation d’ancienneté et à une progression hiérarchique dans une entreprise ou une organisation, selon un schéma entièrement prévisible de marché interne des emplois. Les besoins de formation continue sont d’autant plus pressants que les innovations technologiques font apparaître l’intelligence des machines et algorithmes. L’impératif de conciliation entre vie professionnelle et vie privée fait entendre sa voix avec plus d’insistance. L’engagement dans des activités à forte implication sociétale et environnementale constitue aujourd’hui une modalité plus visible de donation de sens à l’activité professionnelle. Les mobilités entre le salariat, l’indépendance, l’entrepreneuriat et les formes hybrides de statut d’emploi telles que le portage seraient expérimentées plus aisément si elles n’étaient pas pénalisantes pour l’organisation d’une carrière à horizon long. Au lieu de considérer ces dimensions comme des variables séparées de l’évolution du travail, un État-providence réinventé dépasserait la partition classique entre des statuts distincts et entre des choix exclusifs pour opérer l’intégration des séquences[8]. Le défi n’est pas mince. Du côté des employeurs, le problème est double : comment motiver les salariés tout en sophistiquant la technologie d’évaluation des performances ? La réponse est dans la qualité du management : des travaux récents d’analyse empirique et de comparaison internationale des pratiques de management montrent que la France n’est pas idéalement située. Il s’agit également de dépasser la partition classique des carrières professionnelles et des vies individuelles entre des états séparés (formation, emploi, congé parental, chômage, reconversion, engagement bénévole, etc.) et entre des sphères disjointes (privée, familiale, associative, publique, professionnelle), afin d’inventer un nouvel État-providence flexible.
Particulariser la gestion des situations individuelles de travail, les niveaux de couverture assurantielle, les droits de tirage sur la politique publique ou partenariale de lutte contre le chômage, la longueur de l’activité professionnelle et les transitions, au long du cycle de vie, entre un nombre accru d’états (insertion, emploi, formation, congé parental, chômage, reconversion, préretraite…), c’est décomposer le travail en une configuration élargie de paramètres et les carrières en des combinaisons plus nombreuses d’états : le défi auquel sont confrontés le droit et l’organisation du travail est évidemment d’enchâsser ces différents états et les transitions qui les lient dans un horizon de carrière où l’individu au travail peut être assuré de ne pas subir chaotiquement un report immaîtrisable des risques d’emploi, au moment même où ses investissements dans le développement continu des compétences doivent être accrus. Il s’agit en somme d’inventer une nouvelle professionnalité du travail.
[1]- Pierre-Michel Menger, Le travail créateur, Points Seuil, 2014. [2]- Voir, par exemple, Eurofound and Cedefop (2020), European Company Survey 2019: Workplace practices unlocking employee potential, European Company Survey 2019 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg, p. 127-129 ; E. Maurin, C. Torelli, C. Chambaz, « L’évaluation sociale des professions en France. Construction et analyse d’une échelle des professions », Revue française de sociologie, no 39-1, 1998, p. 177-226 ; Hélène Garner, Dominique Méda, « La place du travail dans l’identité des personnes », Insee, Données sociales, 2006, p. 623-630. [3]- John K. Galbraith, The Economics of Innocent Fraud: Truth For Our Time, Houghton Mifflin, 2004. [4]- OCDE, Comment va la vie ? Mesurer le bien-être, 2015. [5]- Nicholas Bloom, Christos Genakos, Raffaella Sadun, John Van Reenen, Management Practices Across Firms and Countries, NBER Working Paper n°17850, 2012. [6]- Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Harvard University Press, 1970. [7]- P.-M. M., Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Seuil, 2002. [8]- Voir Alain Supiot (dir.), Au-delà de l’emploi, Flammarion, 2e éd., 2016 ; P.-M. Menger, « Travail instrumental et travail expressif. À quelles conditions le travail peut-il revêtir une valeur pleinement positive ? », in P. Musso et A. Supiot (dir.), Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement humain ?, Hermann, 2018.